Votre création d'entreprise à 0€, difficile de faire moins cher ! J'en profite

Le report d’une Assemblée Générale
L’assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’approbation des comptes de l’entité doit se tenir dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de clôture de l’exercice social. Cependant, il est possible de proroger la date de la tenue d’assemblée Générale en effectuant une requête auprès du Président du Tribunal de Commerce.
Comment effectuer sa requête ?
L-Expert-Comptable.com vous offre la création de votre entreprise Prenez rendez-vous pour discuter avec nos conseillers
Le guide ultime pour créer sa boîte sans problèmes.

Télécharger
- Assemblée générale : formalisme et utilité
Aides à la création : Créez votre société gratuitement avec L-Expert-Comptable.com !
Nos équipes vous conseillent et vous renseignent sur toutes les aides disponibles pour la création de votre entreprise.
- Démarches initiales
- Formalités déclaratives
- Reconnaissance d’utilité publique
- Financer votre association
- Gérer les collaborateurs de votre association
- Faire évoluer votre association
- Loi du 1er Juillet 1901 et liberté d’association
- Les différentes formes d’association
- Personnes mineures dans l’association
- Responsabilité pénale et civile
- Foire aux questions (FAQ)
- Ressources de l’association
- Réglementation comptable
- Fiscalité applicable aux associations
- Droits d’auteur, presse associative et déclarations nécessaires
- Gestion des conflits et médiation
- Locaux de l’association
- Manifestations et voyages
- Numérique pour les associations
- Démarches administratives
- Groupements d’employeurs
- Soutiens aux associations employeuses
- Définition du bénévolat
- Assurances et protection sociale
- Bénévolat des étudiant·es
- Compte d’Engagement Citoyen
- Congés et autorisations d’absence au bénéfice du bénévole
- Cumul des statuts
- Formation continue (CFGA et VAE)
- Remboursement des frais et chèques repas
- Structures au service des associations et des bénévoles
- Guid’Asso
- Rentrée des associations
- Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA)
- Compte d’Engagement Citoyen (CEC)
- Simplifications associatives
- Soutien de l’Etat hors AAP
- VAE Bénévole
- Appels à projets de l’Etat
- Affectation sociale de biens immobiliers confisqués
- JeVeuxAider.gouv.fr par la Réserve Civique
- Accompagnement en territoire
- Etudes & Rapports
- Exemples inspirants
- Outils et méthodes
- Parcours « Alliances & Territoires »
- Actualités juridiques
- Actualités du monde associatif
- Financements privés
- Institutions et acteurs associatifs au niveau européen
- Subventions, marchés publics et aides d’état
- Association européenne
- Vie du HCVA
- Avis rendus par le HCVA
- Les subventions aux associations
- Le fonctionnement de votre association
- Les mesures pour les associations employeuses
- Les mesures en matière d’engagement
- Les mesures spécifiques
- Le kit gratuit pour votre association
- Guides pratiques
- Travaux de l’INJEP
- Essentiels de la vie associative
- DataAsso, pour tout connaitre sur les associations
- Travaux des autres producteurs de données
- Vie associative
- Info-coronavirus
- Report ou tenue des instances associatives (AG, CA...) : un schéma pour (…)
Report ou tenue des instances associatives (AG, CA...) : un schéma pour comprendre
Publié le : mercredi 29 avril 2020 - Modifié le : mardi 1er juin 2021
Les ordonnances prises en application de la loi d’urgence covid-19 ont permis aux responsables associatifs de reporter ou de modifier les modalités de tenue des réunions des instances associatives. Une nouvelle ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 a reconduit ces mesures jusqu’au 31 juillet 2021 et a proposé de nouvelles possibilités. Un schéma explicatif résume ces ordonnances.
Le décret n°2020-925 du 29 juillet 2020 a prorogé la durée d’application de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 jusqu’au 30 novembre 2020. Il a porté également prorogation jusqu’à la même date du 30 novembre 2020 de la durée d’application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19.
En application de la loi d’urgence n°2020-1379 du 14 novembre 2020, une nouvelle ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 a reconduit ces mesures jusqu’au 1er avril 2021 et a proposé de nouvelles possibilités. Le décret n°2021-255 du 9 mars 2021 les proroge jusqu’au 31 juillet 2021.

Télécharger le schéma applicable à compter du 12 mars 2020 (format pdf)

Télécharger le schéma applicable à compter du 3 décembre 2020 (format pdf)
Depuis le 19 mai 2021 , les AG peuvent se dérouler :
– en présentiel si elle se déroule dans un ERP autorisé à accueillir du public (ex : salle des fêtes ou de réunions), en respectant une jauge réduite (35% de la capacité d’accueil jusqu’au 9 juin, 65% entre le 9 et le 30 juin), avec un public assis (1 siège sur 2 laissé libre), dans la limite de 800 personnes et en respectant le couvre-feu ;
– à distance si l’organisation en présentiel ne permettrait pas de respecter ces mesures et gestes barrières,
– via une consultation écrite (nouvelle mesure entrée en vigueur au 3 décembre 2020 jusqu’au 30 septembre 2021).

Télécharger le schéma "réunir ses instances statutaires entre mai et septembre 2021" ou le schéma "comment organiser mon assemblée en présentiel en mai 2021
Les modalités : le PV doit mentionner le recours aux facultés dérogatoires prévues par les ordonnances. Dans le cadre d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, il est toujours possible de prévoir le vote par procuration avec instruction de vote même si les statuts n’ont pas prévu cette possibilité de mandat.
Les risques des moyens de télécommunication :
- prouver la participation à distance de membres qui ne signent pas une feuille de présence ;
- authentifier les membres qui participent à une consultation électronique par main levée virtuelle, écrite, ou visible en visio conférence ;
- garantir la sincérité des décomptes et donc des résultats ;
- justifier que l’absence de débats oraux n’a pas altéré la compréhension et le consentement des membres.
Dans ces cas, les associations peuvent s’inspirer des pratiques développées par les grandes sociétés (contenu du formulaire de vote à distance à envoyer, documents annexes, bulletin de vote, délais d’envoi, etc.). Il existe des prestataires spécialisés dans l’organisation pratique d’un tel vote (ex : alphavote, LegaVote, neovote, gs-vote.fr, easyquorum, slibvote, gedicom.fr, survey monkey, ...). Le risque mesuré a donc un coût.
recommander
Saisir une adresse email au format [email protected]
Recommander
Dans la même rubrique
Passe vaccinal et associations, les restrictions sanitaires en janvier 2022 : adaptation des activités associatives, associations et crise covid-19, associations employeuses, crise du coronavirus.

Association : comment reporter une assemblée générale ?
Au vu des mesures sanitaires relatives à l’épidémie de coronavirus, est-il possible de reporter une assemblée générale d’association ? Si oui, comment procéder ?

Chaque année, les 6 premiers mois sont une période décisive pendant laquelle sont prises des décisions importantes pour le fonctionnement et la gestion d’une association. En effet, c’est lors de ce premier semestre qu’ont lieu les assemblées générales d’association. Cependant, en raison de la situation sanitaire liée à la Covid-19, certains organismes rencontrent quelques difficultés quant à la tenue de leur assemblée générale. Heureusement, des ordonnances légales leur permettent, soit de reporter, soit de modifier les modalités de tenue de ces réunions importantes.

Organiser une assemblée générale en présentiel
Il est possible d’opter pour une organisation en présentiel d’une assemblée générale d’association. Toutefois, pour ce faire, il existe quelques règles à respecter.
Tout d’abord, l’assemblée générale doit avoir lieu dans un espace privé ou dans un établissement disposant d’une autorisation d’accueillir du public.
Ensuite, l’accueil est limité à 800 personnes. Aussi, il est essentiel de respecter la distanciation physique ainsi qu’une jauge réduite.
Enfin, il existe des gestes barrières à respecter, notamment le port obligatoire de masque, un lavage régulier des mains ou encore la limitation de contact physique.

Organiser une assemblée générale à distance
Pour une assemblée générale d’association à distance, il est possible d’avoir recours à l’une des deux options suivantes :
- Une réunion en visioconférence ou en audioconférence en utilisant WhatsApp, Skype ou encore Zoom ;
- Une réunion par voie de consultation écrite ou par voie de message électronique.
Pour cette seconde option, il est impératif que le texte de proposition de décisions, le bulletin de vote ainsi que tout autre document nécessaire à la tenue de l’assemblée générale soient parvenus aux membres avant ou avec la convocation à l’assemblée générale.
En ce qui concerne le système de vote, les associations peuvent faire appel à des prestataires qualifiés dans ce domaine. On cite, entre autres, LegaVote, alphavote, easyquorum ou encore slibvote. Ces logiciels de vote à distance ont, en effet, l’avantage d’être sécurisés, ce qui limite les risques pouvant être rencontrés en ayant recours aux moyens de télécommunication classiques. En d’autres termes, ils permettent de garantir la sincérité des résultats, la confidentialité du vote ainsi que l’authentification des membres.
Enfin, il convient de noter que si l’association opte pour des modalités de tenue de réunion à distance, le procès-verbal doit indiquer le recours à l’application des ordonnances dérogatoires. Il doit aussi mentionner une fiche de présentation du logiciel utilisé ainsi que son mode de fonctionnement
Ma mission : démocratiser la Démocratie.
Derniers articles
.jpg)
Le calendrier des élections de la délégation du personnel du CSE en 8 étapes
Le CSE doit être mis en place depuis le 1er janvier 2020. Retrouvez le calendrier détaillé des élections de la délégation du personnel du CSE étape par étape.

Procédure des élections CSE : Check-list étape par étape
Retrouvez la procédure des élections CSE en "Check-list" détaillée des opérations à réaliser étape par étape : phase préparatoire, 1er tour et 2nd tour... Cette liste vous permet de sécuriser et d'organiser sereinement les élections.

Prorogation du délai d'approbation des comptes
Une assemblée générale ordinaire des associés doit être convoquée une fois par an, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice social, pour approuver les comptes sociaux. Ensuite, les comptes sociaux peuvent être déposés au registre du commerce et des sociétés, selon que les dispositions réglementaires l’exigent. Le dépôt de ces comptes doit être fait dans le délai d’un mois après la tenue de l’assemblée générale.
Si l’assemblée n’a pu se réunir dans le délai légal, il est possible d’obtenir une prorogation de ce délai de six mois en adressant une requête au président du tribunal de commerce.
Exception :
Depuis la loi n° 2005-882 du 02 août 2005 en faveur des PME, cette procédure d’approbation des comptes sociaux n’est plus obligatoire pour les Entreprises Unipersonnelles à Responsabilité Limitée (EURL) lorsque l’associé unique est l’unique gérant de la société; en ce cas, cette formalité est réputée accomplie par le dépôt au registre du commerce et des sociétés des comptes sociaux, de l’inventaire et du rapport de gestion dûment signés.
Délais :
Il est recommandé de faire la demande de prorogation avant l’expiration du délai légal de six mois. Mais, en tout état de cause, c’est au Président du Tribunal qu’il appartient d’apprécier la recevabilité de cette demande.
Textes : Articles L 225-100 et R225-64 du Code de commerce.
Comment déposer la requête
- La requête doit être déposée en 2 exemplaires originaux, datés et signés par le représentant légal
- La requête doit être présentée par le représentant légal de la société
- Il convient d’y joindre la copie du bilan et du compte de résultat de l’exercice précédent et, si il est établi, le bilan prévisionnel de l’exercice en cours
- La requête peut être adressée au greffe 1 quai de la Corse - 75198 Paris cedex 04 ou déposée à nos guichets accueil du greffe - rez de chaussée - horaires d'ouverture: 9 h -17 h (9 h -12h et 13 h -17 h en juillet et août)
N.B : il est préférable de proposer une estimation du délai de report souhaité, en prenant en compte le rythme de la vie sociale de l’entreprise et la période de vacances.
Télécharger le modèle de requête
Pour connaître le coût de la requête, cliquer ici
Prise de rendez-vous
Prendre rendez-vous en ligne
Registre du commerce
Comment effectuer vos formalités au registre du commerce et des sociétés
Entretien avec un juge - Conciliation - Mandat ad'hoc
Fond - Référés - Requêtes - Injonctions de payer - Difficultés des entreprises
Accès réservés
Juges - Professionnels du droit - Clients en compte
Payer une facture
Payer une facture par carte bancaire
Espace commande
Commander des documents officiels : K bis, comptes annuels, actes de sociétés, jugements ...

- Blog Mon Asso Facile
- Assemblée générale : règles, organisation et déroulement

Le guide complet pour organiser son assemblée générale d’association en 2024

L'Assemblée Générale n'est probablement pas la première chose à laquelle vous avez pensé en créant votre association. Pourtant, il s'agit d'un moment privilégié pour la vie démocratique de votre projet associatif.
C'est en effet l'occasion pour vos membres de se réunir et de décider collectivement des grandes orientations . Dans cet article, découvrez nos conseils pour bien la préparer et faire de votre AG un rendez-vous apprécié de toutes et tous. Au programme :
- Le caractère obligatoire de l’Assemblée Générale
- La question de l’AG à distance
- Les règles de convocation à une AG d’association
- Le déroulé d’une Assemblée Générale
- Les clés d’un PV d’AG efficace
C’est parti !
Est-il obligatoire pour une association d’organiser une Assemblée Générale ?
La loi de 1901 n’oblige pas les associations à organiser d’Assemblée Générale , cependant, les statuts prévoient généralement sa tenue, ne serait-ce que pour approuver les comptes annuels.
Bien qu'elle ne soit pas obligatoire d’un point de vue juridique, l'Assemblée Générale reste un moment primordial pour la vie de l'association.
L’ensemble des règles de l’AG (son caractère obligatoire, ses participants, ses modalités, etc.) sont donc définies dans les statuts de l'association .
Peut-on tenir une Assemblée Générale à distance ?
La crise sanitaire a révélé l'importance de pouvoir collaborer à distance et l’utilité de savoir organiser efficacement une Assemblée Générale en ligne.
Lorsque la distance n'est plus un obstacle, tout devient en effet plus simple ! Les outils numériques facilitent désormais le travail collaboratif, y compris pour les associations.
Quelques conseils pour votre AG à distance :
- Choisissez une solution de visioconférence fiable et facile à utiliser pour tous que vous pouvez tester au préalable
- Envoyez une invitation avec un lien de connexion à l'avance
- Préparez une présentation des rapports accessibles en ligne pour tous les membres
- Veillez à ce que chacun puisse s'exprimer lors des échanges
- Prévoyez un vote électronique sécurisé pour les prises de décision
En suivant ces recommandations, votre AG à distance se déroulera sans accroc !
Comment convoquer une Assemblée Générale d’association ?
Quels membres peuvent organiser une assemblée générale .
Ce sont, comme souvent, les statuts qui désignent la personne habilitée à convoquer une AG . Il peut s'agir du président, du secrétaire, du bureau, du conseil d'administration ou même d'un certain nombre de membres.
C’est le président qui se charge généralement de convoquer l'assemblée. Deux types d’AG peuvent ensuite avoir lieu :
- Les Assemblées Générales Ordinaires (AGO) , qui ont lieu en principe chaque année, le plus souvent en mars ou décembre. Chaque association est libre de choisir le calendrier qui lui convient ;
- Les Assemblées Générales Extraordinaires (AGE) , qui sont quant à elles convoquées de manière ponctuelle lorsque des décisions importantes doivent être prises et qui ne peuvent attendre l’AGO (comme une modification des statuts, par exemple).
Notez qu’un groupe de membres peut demander la tenue d'une AG Extraordinaire. Le nombre minimum requis doit être indiqué dans les statuts. Si le Président refuse malgré cette obligation, un membre du CA peut la convoquer à sa place .
Qui est invité à participer à une Assemblée Générale ?
Sauf mention contraire, tous les membres de l’association doivent être convoqués . En effet, la loi de 1901 définit une association comme un groupement de personnes unies dans un but commun. Chacun doit donc pouvoir participer aux décisions importantes.
Par ailleurs, il est d'usage d'inviter le commissaire aux comptes si votre association en a un, bien que cela ne soit pas une obligation légale.
Que doit contenir la convocation à l'Assemblée Générale ?
La convocation est un moment crucial pour garantir la validité et la réussite de votre Assemblée Générale. Voici les étapes à ne pas négliger dans la création de votre convocation :
- Commencez par rédiger un document mentionnant le nom de l'association, la date d'envoi, ainsi que la date, l'heure et le lieu précis de l'Assemblée.
- Détaillez ensuite l'ordre du jour , c'est-à-dire les sujets qui seront abordés. Cela permet aux participants de préparer leurs questions ou interventions.
- N'oubliez pas d'indiquer le nom et la fonction de l'auteur de la convocation , et de faire signer le document .
Une fois cette base rédigée avec soin, il ne vous reste plus qu'à diffuser la convocation auprès de tous les membres, par le moyen et dans le délai prévu dans vos statuts (courrier, email, affichage, etc.).
En suivant ces recommandations, vous garantissez le bon déroulement de votre Assemblée Générale.
Comment gérer l’organisation d’une Assemblée Générale ?
Comment se déroule l'assemblée générale le jour j .
Il est recommandé de détailler le déroulement de l'AG dans les statuts , pour plus de clarté. On peut notamment y préciser :
- Les participants autorisés,
- Le quorum requis pour la validité des délibérations,
- Le délai entre la convocation et la tenue de l'AG.
Cela représente un important travail d’anticipation, mais peut s’avérer important pour éviter, par exemple, que n’importe qui puisse convoquer une AG. Une rédaction soignée des statuts est donc primordiale pour le bon fonctionnement de votre association !
Comment animer votre AG d’association ?
L'animation de l'AG peut vite devenir compliquée si les discussions s'enflamment. Pour éviter d’en arriver là, nous vous proposons quelques conseils pour garder la main :
- Clarifier en amont le rôle de chacun : CA, bureau, président, trésorier, etc.,
- Définir précisément les missions de ceux qui interviennent pendant l'AG,
- Fixer des règles claires pour les prises de parole et les temps de discussion,
- Adopter un ton convivial pour que l'AG reste un moment agréable,
- Préparer un ordre du jour et une durée précis ,
- Recentrer les débats si nécessaire et faire des synthèses régulières.
Vous pourrez ainsi mener les échanges sereinement et prendre les décisions importantes dans de bonnes conditions. Votre AG n'en sera que plus constructive !
Comment rédiger un procès-verbal d'Assemblée Générale ?
Pourquoi soigner vos pv d’ag .
Lors de votre Assemblée Générale, des décisions essentielles peuvent être prises : budgets, renouvellement des dirigeants, nouveaux projets, etc.
Bien que la rédaction d'un procès-verbal ne soit pas toujours obligatoire, il est fortement recommandé de produire un PV à chaque fois.
Le procès-verbal permet de vérifier que les décisions ont été prises régulièrement . Ne pas en rédiger ou le faire de manière imprécise expose l'association à des contestations et autres désagréments.
Prenez donc le temps, pendant l'AG, de bien consigner toutes les délibérations dans un procès-verbal complet. Vous éviterez ainsi tout litige ultérieur .
Sachez que la rédaction est obligatoire si l'association est reconnue d'utilité publique, soumise à l'impôt sur les sociétés ou a contracté un emprunt.
Quelles mentions doit contenir un PV d'AG ?
Bien que les mentions obligatoires ne soient pas nombreuses, celles-ci existent. Ainsi, un procès-verbal doit impérativement mentionner :
- La date et le lieu de l'AG,
- La signature du représentant légal.
En plus de ces informations, il reste également recommandé d'y ajouter :
- L'ordre du jour,
- Toutes les résolutions adoptées pendant la séance, résolutions qui doivent être validées par les personnes habilitées,
- Les signatures de plusieurs membres qui permettent d'équilibrer les pouvoirs, même si ce n'est pas obligatoire.
En suivant ces conseils, vous faciliterez la rédaction du PV et formaliserez correctement les décisions de votre AG. Un modèle de PV peut vous aider à respecter toutes les mentions nécessaires.
En somme, le bon déroulement de votre Assemblée Générale repose avant tout sur des statuts clairs et complets. C'est là que doivent être définies toutes les règles : participants, convocation, ordre du jour, comptes rendus, etc.
Consacrez donc le temps nécessaire à leur rédaction. Une fois ce socle posé, vous pourrez aborder sereinement toutes les étapes : convocation des membres, animation des débats, et prises de décisions essentielles pour le présent et l’avenir de votre association.
Votre AG deviendra alors un véritable moment d'échanges constructifs et de démocratie participative. Les statuts guideront et sécuriseront le déroulement, pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel : la vie de votre projet associatif.
Associations : êtes-vous redevable de la Sacem ?

Le guide pour tout comprendre au journal officiel des associations

Tout comprendre sur la fonction de président d’association
Mon asso facile.
- Mon Asso Facile Liberté
- Mon Asso Facile Performance
- Mon Asso Facile Réseaux
- Nous contacter
- Qui sommes-nous ?
- CGUV / CGVPS
- Politique de confidentialité
- Mentions légales
Tous droits réservés © 2024 Mon Asso Facile
AssoConnect
34 rue du Sentier
75002 PARIS

L’assemblée générale (AG) : Les règles et obligations
La tenue d’assemblée générale annuelle a pour objet d’approuver les comptes de l’association. La loi du 1901 n’oblige pas une association à se réunir lors d’une assemblée générale tous les ans, sauf si les statuts de l’association le prévoient.
En règle générale, les statuts mentionnent que « les comptes sont approuvés annuellement » ce qui impose la convocation d’une assemblée générale annuelle.
Dès lors, cette assemblée générale devient une procédure obligatoire que l’organisme associatif doit réaliser. En effet, d’importantes décisions relatives au fonctionnement de l’association se prennent lors d’une assemblée générale annuelle. C’est pourquoi il convient de ne pas négliger son organisation. Règlementation, convocation, déroulement…, découvrez donc tout de suite ce qu’il faut savoir sur le sujet.
Assemblée générale annuelle : Règle juridique
Peu importe la nature de son activité, selon les décisions prises dans les statuts de l’association, une association loi 1901 a tout intérêt à programmer une assemblée générale annuelle .
Pour certaines associations, l’assemblée générale annuelle est obligatoire.
On y retrouve :
- les associations reconnues d’utilité publique,
- associations rémunérant un des dirigeants,
- celles percevant des subventions publiques,
- celles agréées par les ministères, de pêche et de protection du milieu aquatique et départementales.
Les modalités de l’organisation et de déroulement figurent d’ailleurs dans ses dispositions statutaires. À l’instar du mode de convocation, de la date de l’assemblée ainsi que des participants. Raison pour laquelle il est essentiel d’y prêter une attention particulière au moment de la rédaction des statuts .
En tout cas, le règlement intérieur de l’organisme peut aussi donner un maximum de précisions sur certains points. Et ce, si les statuts n’en font pas mention ou s’ils ne les détaillent pas. Il en est ainsi notamment de la délibération : quorum, mode de scrutin, nature de la majorité. Quant à la date de tenue de l’assemblée générale ordinaire, elle dépend avant tout des besoins et du type d’association. Mais, en général, elle a lieu en mars ou bien en décembre.
Pour ce qui est des personnes autorisées à y participer, ce sont également les statuts qui les identifient. Ces derniers posent aussi les conditions (âge, statut dans l’association…) pour l’assistance à cette réunion. Par contre, il peut arriver qu’ils ne comportent aucune clarification concernant la composition de l’AGO. Dans ce cas, il faudra convoquer tous les membres de l’association, quel que soit leur statut (fondateurs, simples adhérents, etc.) .
Toutefois, si l’organisme possède un commissaire aux comptes , il fait le plus souvent partie des participants. Il ne s’agit pas d’une obligation légale, mais plutôt d’une pratique relevant de la déontologie.
- J’accepte.
Le point sur la convocation d’une assemblée générale annuelle
Une fois les participants connus, qui est responsable de la préparation et de l’envoi des convocations à une assemblée générale annuelle ? Eh bien, ce sont les statuts (ou le règlement intérieur) de l’association 1901 qui désignent l’organe en charge de ces missions. Il peut ainsi s’agir d’ un membre du bureau (président, secrétaire…) ou du conseil d’administration .
En revanche, si ces documents de référence ne donnent aucune piste en la matière. Alors, l’initiative de la convocation revient généralement au président . De fait, c’est la personne qui dispose des pouvoirs les plus étendus. Néanmoins, l’initiative de se réunir en AG peut tout aussi bien venir de l’ensemble des membres de l’association.
Les modalités de convocation de l’assemblée générale ordinaire d’une association loi 1901
Les statuts (ou éventuellement le règlement intérieur de l’association) fixent les modalités de convocation à une assemblée générale . Délai, mode d’envoi, forme et contenu, il ne faut rien laisser au hasard. Aussi, en ce qui concerne le délai, il doit permettre aux participants de prendre connaissance de l’ordre du jour. Mais également de laisser le temps aux organisateurs de préparer la réunion. Un délai de 15 jours à un mois est dès lors suffisant. Relativement au mode d’envoi, plusieurs options sont possibles : Courrier postal (lettre simple ou recommandée) ou électronique, annonce dans la presse, publication sur le site de l’association, affichage… Cet élément varie en fonction du type d’association et de sa taille.
Le contenu d’une convocation à une assemblée générale annuelle d’un organisme associatif
Encore une fois, vous devez vous référer aux dispositions statutaires de l’association ou à défaut à son règlement intérieur . Mais, d’une manière générale, la convocation à l’assemblée générale annuelle doit comprendre :
- Le nom de l’organisme associatif
- La date de la convocation
- La date, l’heure et le lieu de la réunion
- L’organe qui a pris l’initiative de la tenue de l’AG ordinaire
- L’ordre du jour
- La signature de l’auteur de la convocation et son identité
Des outils 100% gratuits
Collecte de dons, bulletins d’adhésions, campagne de crowdfunding, boutique en ligne, billetterie… des outils 100% gratuits pour vous accompagner au quotidien ! Grâce à notre modèle économique alternatif, HelloAsso met à disposition à plus de 300 000 associations des outils 100% gratuits !
Comment se déroule une assemblée générale annuelle d’association ?
Une assemblée générale annuelle d’association loi 1901 s’opère en plusieurs étapes :
Qu’il y ait ou non un discours d’introduction par le président de la séance (souvent le président de l’association), il faut commencer par faire signer la feuille de présence par les participants. Effectivement, cela permet de savoir si le nombre de membres présents et représentés atteint le quorum exigé. Dans le cas contraire, l’assemblée générale n’a pas lieu d’être. D’ailleurs, si un ou plusieurs membres se retirent durant la réunion amenant ainsi au non-respect du quorum, la suspension de la séance est inévitable.
À noter que le président de la séance doit s’assurer du respect de l’ordre du jour.
Lors de cette AG, peuvent notamment être présentés le rapport moral et le rapport financier de l’association pour l’année écoulée.
La délibération accomplie, l’heure est au vote. Comme mentionné plus haut, ce sont les statuts qui définissent ses modalités de réalisation :
- Le mode de scrutin : vote à main levée ou à bulletin secret
- Les conditions de majorité : relative, absolue, qualifiée ou unanimité
La rédaction du procès-verbal
Que les dispositions statutaires de l’association loi 1901 fassent ou non mention de la rédaction d’un procès-verbal , il est vivement conseillé d’en établir un. Et pour cause, ce document permet de prouver en cas de contestation le respect :
- De l’ordre du jour
- Des exigences de quorum
- Des conditions de majorité
- De la légitimité et de la légalité de l’ensemble des décisions votées et adoptées lors de l’assemblée générale
Par ailleurs, il faut que le procès-verbal de l’AG annuelle soit consultable sur demande des membres et disponible à tout moment sur place. Si l’organisme possède un site internet, sa publication est préconisée.
Nous vous recommandons aussi :
- Comment organiser une assemblée générale extraordinaire d’une asso ?
- Comment organiser une assemblée générale ordinaire d’une asso ?
- Menu de premier niveau
- Identification
- Espace dédié
- Contenu principal
- Liens rapides
S'identifier
Fonctionnement d'une association
Fonctionnement de l’assemblée générale
Le fonctionnement de l’assemblée générale s’organise autour de 3 temps fort ; la convocation, la tenue de l’ AG et les suites de l’ AG . Chacune de ces étapes répond à des règles strictes qu’il faut impérativement respecter.
La convocation
L’auteur de la convocation.
La convocation à l’assemblée générale de l’association doit être préparée et envoyée par la personne ou l’organe désigné par les statuts (voire par le règlement intérieur) : président, secrétaire, bureau, conseil d’administration, voire, plus rarement, une certaine proportion de sociétaires, par exemple le dixième ou le quart... Dans le silence des statuts, l’initiative de la convocation semble revenir au président, mais on peut également concevoir – en pratique uniquement dans les petites associations – que tous les membres prennent spontanément l’initiative de se réunir en assemblée.
En revanche, même dans le cas d’une association collaborant avec les pouvoirs publics et investie d’une mission de service public, la convocation ne peut jamais émaner de l’autorité de tutelle.
Il s’agirait là, en effet, d’une ingérence, inconcevable pour une collectivité publique, dans le fonctionnement d’une personne morale de droit privé.
Bon à savoir
En l’absence de convocation de l’assemblée générale dans le délai prévu par les statuts, les sociétaires peuvent passer outre la carence de l’organe chargé de la convoquer en demandant en justice, au juge des référés, la désignation d’un administrateur provisoire qui procédera à cette convocation.
Les destinataires de la convocation
En principe, et dans le silence des statuts, tous les membres de l’association ont vocation à participer à l’assemblée générale et sont donc destinataires de la convocation.
Mais les statuts peuvent subordonner l’accès à l’assemblée générale au respect de certaines conditions (ancienneté de l’adhésion, âge minimum, paiement d’une cotisation, etc.) ou le réserver à certaines catégories de membres seulement. Seuls les membres ou catégories de membres remplissant les conditions statutaires sont alors convoqués.
Par ailleurs, dans les associations dotées d’un commissaire aux comptes, ce dernier est obligatoirement convoqué aux assemblées générales, et pas uniquement à celle qui statue sur l’approbation des comptes de l’exercice écoulé C. com., art. L. 823-17 .
Bien entendu, celui-ci ne vote pas, mais a toutefois vocation à faire valoir son point de vue lorsque toute question entrant dans son champ d’intervention est évoquée en assemblée.
Enfin, les statuts peuvent valablement ouvrir l’assemblée à des personnes qui participent à l’activité de l’association sans avoir la qualité de membre actif : salariés, amis de l’association, anciens sociétaires... Même si elles aussi ne votent pas, la convocation doit quand même leur être adressée.
Les modes de convocation
Les convocations peuvent être adressées aux participants à l’assemblée générale :
- par lettre simple,
- par lettre recommandée, éventuellement avec accusé de réception,
- par insertion dans un bulletin de liaison interne, ou dans la presse nationale ou régionale,
- par affichage,
- par courrier électronique ou par mention sur le site internet de l’association,
- voire par télex ou télécopie, même si ces modes de communication tendent à tomber en désuétude.
Peu importe le mode de convocation dès lors qu’il est prévu par les statuts, voire par le règlement intérieur . Toutefois le mode choisi doit être adapté à la situation de l’association en permettant à tous les membres concernés d’être effectivement informés de la tenue de l’assemblée générale. Ainsi, dans les grandes associations, une annonce dans la presse nationale ou sur le site internet de l’association constitue probablement le mode de convocation le plus opportun. Si de nombreux membres de l’association résident à l’étranger, le courrier électronique est sans doute le procédé le plus simple et le plus efficace. Ce mode de convocation semble être d’ailleurs de plus en plus utilisé ; il faut dire qu’il présente l’avantage de ne (pratiquement) rien coûter à l’association.
En revanche, la convocation verbale est à proscrire, en ce qu’elle ne permet pas à l’association de prouver que tous les membres de l’association ont effectivement été convoqués.
Il est également possible de prévoir des modes de convocation différents en fonction des membres, par exemple que les convocations à l’assemblée générale sont en principe adressées par courrier simple, et par courrier électronique pour ceux des membres qui en font la demande ou qui ont donné leur accord à ce mode de convocation. En pratique, la convocation par voie de courrier électronique, se pratique de plus en plus.
Le délai de convocation
Le délai de convocation à l’assemblée générale doit être suffisant pour laisser aux participants le temps de préparer la réunion, en particulier de prendre connaissance de l’ordre du jour ainsi que des documents qui y sont joints. Il est en général compris entre quinze jours et un mois. Le mieux est de prévoir un délai de convocation dans les statuts. Le défaut de respect de ce délai peut entraîner l’annulation de l’assemblée qui s’est déroulée prématurément, à moins que tous les membres aient pu être présents ou représentés à celle-ci.
Il a été jugé, en matière de sociétés – mais la solution est transposable aux associations –, que en cas de convocation par courrier postal , le délai de convocation des associés court à compter de la date d’expédition de la lettre (en l’occurrence une lettre recommandée) et non de sa réception par ses destinataires.
Cass. Ch. mixte, 16 déc. 2005, n° 04-10.986
Le contenu de la convocation
- l’identification de l’association ;
- la date de la convocation ;
- la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale ;
- l’ordre du jour de la réunion, afin que chaque sociétaire puisse prendre connaissance des questions qui seront débattues au cours de l’assemblée et se préparer utilement aux débats. L’ordre du jour a un caractère impératif. En principe, il ne devrait pas être modifié en cours de séance, sauf pour la révocation du mandat d’un administrateur qui peut être décidée par l’assemblée générale bien que non prévue à l’ordre du jour. Par ailleurs, le président de séance ne saurait décider de ne pas soumettre au vote une question régulièrement inscrite à l’ordre du jour ; c’est le principe de l’intangibilité de l’ordre du jour ;
- l’identification de l’organe qui en a pris l’initiative et la signature de son auteur.
Les dirigeants de l’association ne peuvent commettre de discrimination entre les membres d’une même catégorie, par exemple en ne convoquant aux assemblées générales que certains d’entre eux. Ainsi, la convocation individuelle est sans doute le meilleur procédé pour que tous les membres soient effectivement informés.
Si l’association préfère recourir à la convocation collective par voie de presse, éventuellement en ligne, la publication retenue doit avoir une diffusion suffisamment large ou être susceptible d’être lu par le plus grand nombre. Son lectorat doit également correspondre à la cible visée par la convocation ; ainsi peut-on concevoir, par exemple, qu’une association d’actionnaires publie la convocation collective de son assemblée générale dans un organe de presse économique ou financier. De même, l’affichage dans le local associatif ne peut être envisagé que si l’on est certain que tous les membres sont amenés à s’y rendre régulièrement. Ces considérations sont à prendre en compte au moment de la rédaction des statuts puisque dans tous les cas, ce sont eux qui déterminent le mode de convocation.
L’ordre du jour doit être suffisamment précis : les membres doivent pouvoir clairement comprendre la portée des décisions qu’on leur demande de prendre, sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents.
Les « questions diverses » ne sont pas une « session de rattrapage » en cas d’oubli d’un point à l’ordre du jour. Il s’agit uniquement d’informations ne nécessitant pas une délibération.
L’assemblée ne peut délibérer que sur des points figurant à l’ordre du jour, sous peine d’annulation de la résolution adoptée. Mais il y a quelques exceptions : en particulier, l’assemblée doit pouvoir se prononcer sur la question de la révocation des dirigeants, même non inscrite à l’ordre du jour, en vertu de la règle jurisprudentielle, inspirée du droit des sociétés, dite des « incidents de séance ».
Si les statuts prévoient des règles de convocation pour l’assemblée générale, celles-ci doivent être impérativement respectées. Dans une affaire récemment jugée, le nouveau vice-président d’une association a convoqué l'assemblée générale, au cours de laquelle le président a été révoqué de ses fonctions de membre et d'administrateur. Mais celui-ci a contesté en justice la régularité de ces convocations et délibérations. Avec un certain succès, d’ailleurs, puisque les juges d'appel ont prononcé la nullité de la réunion du conseil d'administration et de l'assemblée générale ainsi que des délibérations qui y ont été prises, sur le fondement d'une clause des statuts qui permet la réunion du conseil d'administration sur convocation verbale seulement si tous les membres en exercice sont présents ou représentés et sont d'accord sur l'ordre du jour. L'arrêt d'appel est cependant cassé, car les juges d'appel auraient dû rechercher si les irrégularités constatées étaient expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou si elles avaient eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations. C'est donc seulement si les statuts de l'association précisent que la violation des règles de convocation qu'ils imposent emporte nullité des décisions concernées que cette sanction est automatique.
Civ. 1 re , 20 mars 2019, n° 18-11.652
Sanctions relatives au non-respect des règles statutaires
Les irrégularités constatées lors de la formalité de convocation à l’assemblée générale peuvent entraîner l’annulation de toutes les décisions prises au cours de la séance.
Il en est de même des irrégularités constatées lors de la tenue de l’assemblée générale, et notamment en cas de violation des règles limitant les mandats, de non-respect de l’ordre du jour, etc.
Conseil : Il est inutile de multiplier les contraintes statutaires qui ne peuvent pas matériellement être respectées par l’association, au risque de voir les réunions d’assemblée ne pas pouvoir se tenir ou les délibérations annulées.
La tenue de l’assemblée générale
La vérification du quorum.
Dès le début de la réunion, il appartient au bureau de séance désigné de s’assurer que l’assemblée générale peut régulièrement se tenir et notamment que le quorum éventuellement prévu par les statuts est réuni. Le quorum est le pourcentage (50% par exemple) de sociétaires dont la présence ou la représentation peut être requise par les statuts pour que l’assemblée puisse valablement délibérer. La fixation d’un quorum est destinée à garantir la représentativité et l’autorité des assemblées en évitant que les décisions soient prises par une trop petite fraction des membres.
À cette fin, prévoyez une feuille de présence. Le quorum doit être respecté pendant toute la durée de l’assemblée (la conséquence est qu’il est possible de quitter l’assemblée au cours de celle-ci, mais uniquement si les conditions de quorum demeurent remplies à la suite de ce départ).
Le quorum peut être calculé sur le nombre de membres présents uniquement ou sur le nombre de membres présents ou représentés (membres votant par procuration) ; de même, peuvent être réputés présentes les personnes qui participent à l’assemblée par voie de visioconférence. Ces éléments doivent être prévus par les statuts ou, à défaut, par le règlement intérieur.
Aucune obligation relative au quorum n’est imposée par la loi du 1 er juillet 1901, ni par son décret d’application. Mais si les statuts ont institué des règles de quorum, leur respect constitue alors une condition substantielle de validité des délibérations adoptées. Toute décision adoptée sans que le quorum requis par les statuts n’ait été respecté est susceptible d’être annulée.
Versailles, 1 re ch., 30 juin 2011, n° 10/03018
Le mode de scrutin
Le vote a-t-il lieu à main levée ou à bulletin secret ?
Il appartient aux statuts de définir le mode de scrutin pour l’adoption des délibérations par l’assemblée générale.
Il est possible de réserver le vote à bulletin secret à l’élection ou à la révocation des administrateurs, à l’exclusion des autres délibérations, ou si un ou plusieurs membres le requièrent.
Le vote doit avoir lieu sur tous les points figurant à l’ordre du jour (sauf sur ceux qui n’appellent pas de vote). Le président de séance ne saurait écarter des débats et du vote certains points de celui-ci ou lever la séance avant que l’ordre du jour ne soit épuisé.
Dans le silence des statuts, le vote par procuration est de droit. À l’inverse, le vote par correspondance (éventuellement via Internet) doit être prévu par les statuts pour pouvoir être mis en œuvre.
Cependant, dans le contexte de la crise sanitaire, l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 avait temporairement (jusqu’au 30 septembre 2021) écarté cette exigence.
Dans une affaire se posait la question de savoir s’il était possible pour un parti politique – constitué sous forme d’association – de recourir au vote par correspondance pour supprimer un article 11 bis de ses statuts instituant une présidence d’honneur.
L’article 24 des statuts prévoient que « les assemblées peuvent être tenues ordinairement et extraordinairement » et que « pour toutes les assemblées, la convocation peut être faite individuellement ou par voie de presse au moins quinze jours à l’avance ». Quant à l’article 26 de ces mêmes statuts, relatif aux travaux de l’assemblée générale ordinaire, il stipule que « toutes les délibérations de l’assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents ou votant par correspondance », tandis que l’article 27 énonce que « l’assemblée générale extraordinaire statue sur toutes les questions urgentes qui lui sont soumises » et qu’ « elle seule peut apporter toutes les modifications aux statuts ».
Pour la Cour de cassation, il résulte de ces stipulations claires et précises que les statuts de l’association en cause ne prévoyaient le vote par correspondance que pour l’assemblée générale ordinaire, et non pour l’assemblée générale extraordinaire. Dès lors, l’organisation d’un vote par correspondance portant sur l’approbation de nouveaux statuts constitue un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés pour suspendre l’assemblée extraordinaire organisée par voie postale jusqu’à la tenue d’une assemblée nouvelle dans les formes conformes aux statuts de l’association.
Civ. 1 re , 25 janv. 2017, n° 15-25.561
La majorité requise
C’est le nombre de voix nécessaire pour qu’une proposition soit adoptée. Les statuts peuvent instaurer plusieurs types de majorité, en fonction de l’importance des décisions soumises au vote des sociétaires, à savoir :
- Majorité simple (ou relative) : la décision est adoptée lorsque les votes favorables l’emportent sur les votes défavorables, quel que soit le nombre de voix exprimées.
- Majorité absolue : la proposition doit obtenir au moins la moitié des voix plus une.
- Majorité qualifiée : elle requiert, par exemple, les deux tiers ou les trois quarts des suffrages. Elle n’est généralement retenue que pour les assemblées générales extraordinaires décidant de la modification des statuts ou de la dissolution de l’association.
- Unanimité : elle crée un droit de véto au profit de n’importe quel membre ; le droit de véto peut également n’être accordé par les statuts qu’à un membre particulier de l’association ou à une catégorie de membres. Il vaut mieux que l’exigence de l’unanimité ne soit prévue que pour des cas de délibérations très limités (ex. changement d’objet) sous peine d’aboutir à une paralysie du fonctionnement de l’association.
Les statuts doivent indiquer clairement lorsqu’ils exigent l’unanimité pour la prise de décision, si cette unanimité s’entend de la totalité des membres de l’association ou seulement de ceux présents ou représentés à l’assemblée. Dans le silence des statuts, et si l’on se réfère à la jurisprudence rendue en matière de droit des sociétés, c’est la première alternative qui doit être privilégiée.
Com. 19 déc. 2006, n° 05-17.802
Prévoyez dans les statuts, lorsque le quorum n’est pas atteint , la réunion d’une seconde assemblée quelques jours plus tard, qui pourra statuer sur le même ordre du jour et avec un quorum plus faible, voire sans condition de quorum.
En cas de carence des personnes qui ont statutairement le pouvoir de convoquer, les sociétaires doivent avoir recours au juge (en principe, lors d’une instance en référé devant le tribunal judiciaire). Ce dernier ordonnera alors la réunion d’une assemblée ou procédera à la désignation d’un administrateur provisoire chargé de réunir cette assemblée et de veiller au respect de la procédure statutaire. Mais il ne peut pas convoquer lui-même cette assemblée.
En pratique, les statuts ne prévoient pas toujours les règles de majorité applicables , y compris pour les décisions de l’assemblée générale ayant pour objet la modification des statuts.
À cet égard, la Cour de cassation a jugé que : « dans le silence des statuts d’une association, seules les modifications statutaires ayant pour effet d’augmenter les engagements des associés doivent être adoptées à l’unanimité ». La difficulté est qu’il n’est pas toujours facile d’identifier ce qu’il faut entendre par décision augmentant les engagements des membres d’une association. La Haute juridiction semble favorable à une approche restrictive de celle-ci.
En effet, selon elle, la modification des statuts, qui a pour effet de permettre l’exclusion d’un adhérent sans motif disciplinaire et sans possibilité d’être entendu ne constitue pas une hypothèse d’augmentation des engagements des membres.
Civ. 1 re , 1 er févr. 2017, n° 16-11.979
Le quorum est le nombre minimum de membres dont la présence est requise pour que l’assemblée générale puisse valablement délibérer : si ce nombre n’est pas atteint, aucune décision ne peut être prise ; le conseil d’administration est ajourné.
On prend généralement en compte dans le quorum, outre les membres de l’association physiquement présents, ceux qui sont représentés par un autre membre ; encore faut-il que les statuts le prévoient. Le quorum peut être fixé au quart, au tiers, à la moitié ou plus des membres de l’association. Il est généralement plus faible lors de la seconde réunion d’une assemblée, c’est-à-dire lorsque que l’assemblée convoquée sur première convocation n’a pu se tenir faute de respect des conditions de quorum. Il est également possible de prévoir que la seconde réunion se tiendra sans condition de quorum. En revanche, les règles de majorité sont identiques selon que la réunion de l’assemblée se déroule sur première ou deuxième convocation.
Conseil : Il est inutile de multiplier les contraintes statutaires qui ne peuvent pas matériellement être respectées par l’association, au risque de voir ses délibérations annulées.
Les suites de l’assemblée générale
L’établissement du procès-verbal.
L’établissement d’un procès-verbal n’est en principe pas obligatoire. Il est pourtant fortement recommandé, notamment pour pouvoir prouver la teneur des résolutions votées et ainsi obtenir leur exécution. . Il peut même parfois s’agir d’une obligation statutaire (ou du règlement intérieur).
Un banal conflit entre anciens et nouveaux dirigeants d'une association a donné l’occasion à la Cour de cassation de prendre position sur le formalisme devant être respecté pour l’établissement du procès-verbal de l'assemblée générale d'une association. Elle juge que l’assemblée qui n'a pas donné lieu au procès-verbal signé de la présidence imposé par les statuts n'est pas nulle, faute de sanction statutaire en ce sens, dès lors qu'un procès-verbal de constat d'huissier complet relatif à l'assemblée a été dressé.
Civ. 1 re , 16 juin 2021, n° 19-22.175
Communication et publicité
Sauf si les statuts l’imposent, le procès-verbal de l’assemblée générale n’a pas à être communiqué par écrit aux adhérents de l’association. Il est cependant généralement consultable sur place et sur simple demande par tout adhérent ; il peut alors en être délivré copie moyennant remboursement des frais occasionnés. Il peut être également consultable sur le site internet – voire sur l’intranet pour que seuls les membres y aient accès – de l’association.
Une publicité à la préfecture du procès-verbal est requise pour rendre opposables aux tiers certaines délibérations de l’assemblée dont il fait état :
- les modifications des statuts ;
- les changements de nom et de siège ;
- et les changements dans les organes d’administration et de direction.
L. du 1 er juillet 1901, art. 5, al. 6
Enfin, n’oubliez pas de communiquer à votre banque tout changement dans la liste des personnes habilitées à gérer les comptes de l’association.
Compétences de l’assemblée générale
Fonctionnement d’une association, kit assemblée générale.
- Comment nous rejoindre
- Micro-Entreprise
- Association
- Choix Statut
- Services B2B
- SASU et EURL
- Bilan et liasse fiscale
- Déclarations de TVA
- Devis et Facturation
- Services Conseils
- Synchoronisation bancaire
- Tableau de bord et pilotage
- Domiciliation Entreprise Votre adresse prestigieuse à Paris
- Modifications de Statuts Procédure 100% en ligne
- Dissolution d'entreprise Traitement sous 24h
- Agent commercial
- Agent immobilier
- Bâtiments et Travaux Publics
- Boulanger, pâtissier, biscuitier
- Chauffeur de taxi et VTC
- Coach sportif et fitness
- Développeur web
- Métiers de la santé
- Restauration
- Services à la personne
- Transport de marchandises
- Webdesigner
- Autres activités
- 100 conseils pour créer
- La création d’entreprise
- Réflexion préalable
- Idée de création
- Business model
- Construire son projet
- Analyser l’entreprise
- Négocier le rachat
- Location-gérance
- Commerce organisé
- Se faire accompagner
- Étude de marché
- Préparer son business plan
- Prévisionnel financier
- Valider son Business Plan
- Faire son Business Plan en ligne
- Préparer son dossier
- Aides à la création
- Apports en capital
- Compte courant d’associé
- Financements bancaires
- Outils de trésorerie
- Investisseurs
- La micro-entreprise
- L’entreprise individuelle
- L’EURL
- L’association
- Régimes fiscaux
- Sécurité sociale
- Choix du statut juridique
- Local professionnel
- Autres choix de création
- Statuts de société
- Annonces légales
- Dépôt du capital social
- Immatriculation
- Création en ligne
- S’implanter en France
- Contrats commerciaux
- Conditions commerciales
- Communication
- Comptabilité
- Facturation
- Gestion financière
- Comptes annuels
- Assemblées générales
- Modification de capital
- Transfert de siège
- Transformations
- Autres modifications
- L’impôt sur le revenu
- L’impôt sur les sociétés
- Les crédits d’impôts
- La CFE et la CVAE
- Autres impôts et taxes
- L’embauche du salarié
- Les contrats de travail
- La gestion de la paie
- La mutuelle d’entreprise
- La rémunération du dirigeant
- La rupture du contrat de travail
- Groupes de sociétés
- Cession de fonds
- Cession de titres
- Fiscalité des cessions
- Fermer son entreprise
La demande de prorogation du délai d’approbation des comptes annuels
En principe, les sociétés disposent d’un délai de 6 mois à compter de la fin de leur exercice social pour faire approuver leurs comptes annuels . Malheureusement, ce délai ne peut parfois être tenu, pour différentes raisons. Dans ce cas, il existe une procédure spéciale qui permet à la société d’obtenir une dérogation et un report . On parle de prorogation du délai d’approbation des comptes annuels . Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet.

L’approbation des comptes annuels en quelques mots
Toutes les sociétés doivent, chaque année, établir des comptes annuels. Ils se composent d’un bilan, d’un compte de résultat et parfois d’une annexe. Ils sont arrêtés à une date spéciale appelée la date de clôture de l’exercice comptable.
Dès lors, les représentants légaux doivent convoquer les associés afin qu’ils statuent sur les comptes. Ils décideront alors de les approuver , ou non. Au passage, ils affecteront le résultat, en respectant certaines règles, notamment en cas de distribution de dividendes .
Ainsi, une assemblée générale ordinaire annuelle des associés doit être convoquée dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice social. Une fois tenue, la société dispose d’un délai d’un mois pour déposer ses comptes au greffe .
En principe, ce délai de 6 mois ne bénéficie d’aucun aménagement. Toutefois, il peut arriver qu’une société ne parvienne pas à le respecter. Les motifs divergent. Elle peut alors demander le report de la date de tenue de son assemblée générale annuelle.
Pour connaître les règles applicables à chaque forme juridique, nous vous invitons à consulter les dossiers suivants :
1- Approuver les comptes d’une SASU ou d’une SAS 2- Approuver les comptes d’une EURL ou d’une SARL
Quand déposer la demande de prorogation du délai d’approbation des comptes ?
Idéalement, il vaut mieux déposer la demande de prorogation avant l’expiration du délai légal de 6 mois . Toutefois, la demande peut exceptionnellement intervenir après ce délai .
Par exemple, les sociétés qui clôturent leur exercice au 31 décembre, ont jusqu’au 30 juin de l’année suivante pour déposer leur demande de report de délai de tenue de leur assemblée générale ordinaire annuelle.
Que contient la demande de prorogation du délai d’approbation des comptes ?
La demande de prorogation du délai de réunion de l’assemblée générale annuelle contient un courrier et plusieurs justificatifs . Plus exactement, elle comprend :
- Une requête émise à l’attention du Président du Tribunal de Commerce, datée et signée,
- Un exemplaire du bilan et du compte de résultat de l’exercice précédent (pas celui en cours),
- Un bilan prévisionnel de l’exercice en cours, en attente d’approbation par les associés,
- Et un chèque pour le règlement des formalités (33,31 euros).
Dans sa requête, le représentant légal de la société doit indiquer les motifs qui le contraignent à demander un report. Il doit également proposer une nouvelle date prévisible pour la tenue de l’assemblée. Le greffe du tribunal de commerce propose un modèle gratuit (téléchargeable ICI ).
A qui envoyer la demande de report de tenue de l’assemblée générale annuelle ?
Le dossier de demande de prorogation de la date de tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle doit être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce .
Il faut s’adresser à l’organisme territorialement compétent, c’est-à-dire celui dans le ressort duquel se trouve le lieu du siège social de la société.

Poster un commentaire
Nous ferons de notre mieux pour vous répondre dans des délais raisonnables. Vous pouvez demander à tout moment la rectification ou la suppression de vos informations à caractère personnel : Nous contacter
Prénom (obligatoire)
Mail (non affiché) (obligatoire)
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Avertissez-moi de la publication de nouveaux commentaires par mail. Vous pouvez également souscrire sans laisser de commentaire.

- Création d’entreprise, les étapes clés
- Réaliser son étude de marché
- Faire son business plan
- Le guide de l’EURL
- Le guide de la SARL
- Le guide de la SASU
- Le guide de la SAS
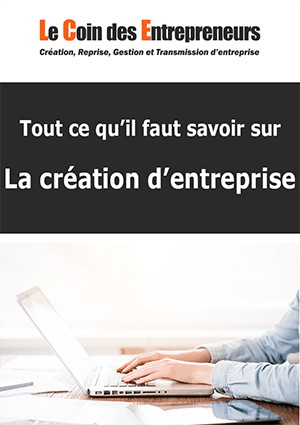
- Construire son projet d’entreprise en ligne
- Création d’entreprise en ligne
- Comparateur de statut juridique
- Outil de business plan en ligne
- Prévisionnel financier sur Excel
- Evaluer et tester son idée de création
- Bien préparer son projet de création
- Faire un business model canvas
- Valider son projet de création d’entreprise
- Tout comprendre sur le business plan
- Bien préparer son business plan
- Établir les tableaux financiers
- Faire un prévisionnel financier
- Créer une EURL : tout ce qu’il faut savoir
- Créer une SARL : tout ce qu’il faut savoir
- Créer une SASU : tout ce qu’il faut savoir
- Créer une SAS : tout ce qu’il faut savoir
- Tableau comparatif des statuts juridiques
- Choix d’un statut juridique pour l’entreprise
- Choix du régime fiscal de l’entreprise
- Choix d’un statut social pour le dirigeant
- Formalités à accomplir pour créer son entreprise
- Procédure à suivre pour immatriculer sa société
- Solutions pour créer son entreprise
- Créer son entreprise en ligne, choisir et comparer
Navigation :
- Partenariats et publicité
- Nous contacter
- Mentions légales et CGU
- Politique de confidentialité
- Plan de site
- Notre politique de protection des Données à caractère personnel
- Plan du site
Nos autres sites :
- Notre application
- Entreprises et Droit
- Compta-Facile
Le coin des entrepreneurs :
Le coin des entrepreneurs est un média online de référence pour les créateurs d'entreprise, les repreneurs d'entreprises et les chefs d'entreprises. Nous vous proposons sur notre site internet des centaines de dossiers sur les thèmes de la création, la reprise et la gestion d'entreprise, dans le but de vous informer et de vous conseiller dans toutes les étapes de votre projet entrepreneurial (de l'idée de projet jusqu'au lancement de votre nouvelle activité).
En plus du média, Le Coin des Entrepreneurs vous propose également une application digitale pour vous accompagner dans vos projets entrepreneuriaux. Notre application vous propose une multitude de fonctionnalités pour vous guider dans votre projet de création ou de reprise d'entreprise
Notre mission est simple : proposer aux entrepreneurs un éco-système complet qui leur permet de construire leur projet et de se lancer dans leur nouvelle activité

- Mot de passe oublié ?
- Le fil quotidien
- 4 derniers feuillets
- FH 4039 du 16-05-2024
- FH 4038 du 09-05-2024
- FH 4037 du 02-05-2024
- FH 4036 du 25-04-2024
- Archives FH
- Zoom sur arrêt
- Plus sur le net
- Table infos publiées
- Vie des affaires
- Tous les mensuels RF
- Programmation
- Dictionnaire Fiscal
- Dictionnaire Comptable et financier
- Dictionnaire Social
- Dictionnaire Paye
- Inscription
- Archives newsletters
- Chiffres et indices
- Outils de calcul
- Échéancier
- Sites utiles
- Formulaire de l'entreprise
6 - Reporter une assemblée ou suspendre ses effets : c'est possible en référé
Le juge des référés peut reporter une assemblée générale si celle-ci est de nature à causer un dommage imminent à la société. En outre, bien qu'il n'ait pas le pouvoir d'annuler les décisions votées en assemblée, il peut en suspendre les effets.
Cass. com. 13 janvier 2021, nos 18-25713 et 18-25730
L'essentiel Le juge des référés peut ordonner des mesures provisoires soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / 6-1 Le juge des référés peut reporter une assemblée générale, jusqu'à l'issue de l'intervention d'un administrateur provisoire préalablement désigné, si les décisions votées risquent d'altérer la mission de l'administrateur. / 6-3 Le juge des référés n'a pas le pouvoir d'annuler les délibérations d'une assemblée générale mais peut, néanmoins, en suspendre les effets. / 6-6 D'une manière générale, l'annulation des décisions d'une assemblée générale est strictement limitée. / 6-9
Les pouvoirs du juge des référés du tribunal de commerce
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse (c. proc. civ. art. 872 ).
En outre, il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent (c. proc. civ. art. 873 , al. 1 ) :
-soit pour prévenir un dommage imminent ;
-soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
C'est notamment le cas lorsque le juge des référés désigne un administrateur provisoire suite à une paralysie des organes de gestion de la société ou une mise en péril de ses intérêts sociaux (cass. civ., 1re ch., 9 juillet 1974, n° 73-12282).
L’intérêt de saisir le juge des référés plutôt que le tribunal tient à la rapidité de la procédure. Il sera possible d’obtenir une décision en référé en quelques semaines, voire quelques jours seulement, alors qu’il faut souvent plusieurs mois pour obtenir un jugement du tribunal.
Le juge des référés peut reporter une assemblée
Une société en difficulté financière.
Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, une SAS rencontrait des difficultés financières suite à l’acquisition des titres d’un groupe de société.
La SAS sollicite la nomination d'un administrateur provisoire afin de négocier avec les banquiers une restructuration de sa dette. Par une ordonnance du 17 juillet 2018, un administrateur provisoire est désigné pour une durée de 3 mois.
Entre-temps, les trois associés majoritaires de la SAS adressent au président et associé minoritaire une convocation à une assemblée générale fixée au 30 juillet 2018 ayant pour ordre du jour la révocation du président ainsi que son remplacement.
Quelques jours avant l'assemblée, le président de la SAS demande en référé le report de cette assemblée jusqu’à l’issue de la mission de l’administrateur provisoire.
Une ordonnance du 27 juillet 2018 lui donne gain de cause après avoir constaté que le maintien de l'assemblée générale et le remplacement du président de la SAS seraient contraires à la mission de l'administrateur provisoire. La décision est confirmée par la cour d'appel.
À noter En pratique, la désignation d'un administrateur provisoire n'est possible qu'en cas de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent (cass. com. 14 octobre 2020, n° 18-20240 ; cass. com. 25 février 2005, n° 00-22457 ; cass. com. 6 février 2007, n° 05-19008). En l'espèce, la désignation de l'administrateur provisoire était justifiée par le risque de faillite de la société.
Le report de l’assemblée justifié par un dommage imminent
Les trois associés majoritaires contestent devant la Cour de cassation l'ajournement de l'assemblée générale.
Ils soutiennent que le juge des référés ne peut reporter une assemblée que s'il existe des irrégularités susceptibles de présenter un risque d'annulation des décisions qui seront prises. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la convocation a été régulière et les associés ont reçu toute l'information nécessaire. Ils considèrent en outre que le changement de direction n'aura aucune incidence sur la mission de l’administrateur provisoire.
Leur demande est rejetée par la Cour de cassation. La Cour relève que le changement de présidence, dont l’urgence n’est pas avérée, est susceptible d'affecter la confiance accordée par les banques à l’administrateur provisoire. Par conséquent, la tenue de l'assemblée était bien de nature à causer à la SAS un dommage imminent qu'il convenait de prévenir en ordonnant le report de l'assemblée générale.
À noter Une assemblée générale ne peut être ajournée par une décision de justice que dans des cas exceptionnels. Ainsi, a été admis le report d'une assemblée pour manquement grave à l'information des associés (cass. com. 7 juillet 2020, n° 18-19330). En l'espèce, la décision de report n'est pas justifiée par la présence d'un administrateur provisoire, bien que cela suppose des difficultés pour la société, mais par le risque de faire échouer les négociations avec les banques.
Il peut aussi suspendre les effets d'une assemblée
Une nouvelle assemblée, cette fois-ci réunie.
Dans cette même affaire, les trois associés majoritaires ont de nouveau convoqué une assemblée générale en date du 31 août 2018 avec pour ordre du jour la fixation de la rémunération du président.
Lors de cette assemblée, les associés majoritaires ont modifié l'ordre du jour et ont mis au vote deux nouveaux projets de résolution. Le premier portait sur la révocation du président de ses fonctions et le second sur la nomination d’un nouveau président en remplacement.
Le président s'étant abstenu, la modification de l'ordre du jour a été approuvée et les deux résolutions ont été adoptées à la majorité des voix.
Le changement de dirigeant annulé en référé
Le juge des référés a de nouveau été saisi et, en appel, les décisions votées par l'assemblée générale du 31 août 2018 ont été annulées. Selon les juges, le changement de présidence de la société était à l'origine d'un trouble manifestement illicite et la seule mesure permettant de faire cesser ce trouble était d'annuler les délibérations litigieuses.
Censure de la Cour de cassation
Seule la suspension des effets est possible.
Les associés majoritaires de la SAS ont formé un pourvoi en cassation et l'arrêt d'appel a été censuré. La haute juridiction a rappelé que l'annulation des délibérations de l'assemblée générale d'une société, qui n'est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés (voir § 6-1 ). Il en est ainsi même dans le cas où cette annulation a pour but de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Toutefois, la Cour de cassation a précisé que le juge des référés avait la possibilité de suspendre les effets des résolutions votées par cette assemblée. En conséquence, si la cour d'appel de renvoi décide de le faire, le changement de présidence ne se produira pas avant l'achèvement de la mission de l'administrateur provisoire.
À noter La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de rappeler que le juge des référés ne pouvait pas annuler les délibérations d'une assemblée générale ( cass. com. 29 septembre 2009, n° 08-19937). Elle avait aussi évoqué, dans une affaire précédente, la possibilité pour le juge des référés de suspendre les effets d'une décision d'un GIE prise en assemblée (cass. com. 29 janvier 2008, n° 07-10797).
Faible incidence en pratique
Présence d'un administrateur provisoire
Rappelons que, dans notre affaire, la gestion de la SAS était déjà confiée à un administrateur provisoire. Étant donné que la désignation d'un tel organe entraîne le dessaisissement du dirigeant (cass. civ., 3e ch., 25 octobre 2006, n° 05-15393), le changement de présidence n'aurait eu en pratique aucune incidence au sein de la société dès lors que l'administrateur provisoire exerçait toujours ses fonctions dans la SAS.
Absence de remise en cause de la décision votée
À la différence de l'ajournement, qui reporte la tenue de l'assemblée générale à une date ultérieure, la suspension ne remet pas en cause la décision votée en assemblée. Ainsi, une fois la mission de l'administrateur provisoire accomplie, le nouveau président élu prendra directement ses fonctions.
Cette solution peut être regrettable en présence d'une fraude de la part des associés majoritaires. En effet, il n'est pas exclu dans cette affaire que ces derniers aient forcé la réunion de la seconde assemblée en modifiant l'ordre du jour afin de palier à l'ajournement de la première.
Le changement de dirigeant peut-il être annulé par le tribunal ?
Même devant le tribunal de commerce, la nullité des délibérations d'une assemblée ne modifiant pas les statuts est strictement encadrée. Elle ne peut résulter que :
-soit de la violation d’une disposition impérative des règles applicables aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats (c. com. art. L. 235-1 , al. 2 ) ;
-soit de la violation d'une clause des statuts, lorsque cette clause résulte de la faculté ouverte par une disposition impérative d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci (cass. com. 18 mai 2010, n° 09-14855).
Dans une SAS, les conditions de révocation du président ne relèvent d'aucune disposition impérative mais des statuts (c. com. art. L. 227-5 ). Ainsi, dans notre affaire ci-avant commentée, les décisions votées ne pourraient pas être remises en cause devant le tribunal de commerce.
Néanmoins, si le président arrivait à établir une fraude ou un abus de droit commis par les associés majoritaires pour favoriser leurs intérêts au détriment de la société, la délibération pourrait être annulée. En dehors de ce cas, le président révoqué pourra seulement prétendre à des dommages et intérêts sous réserve que sa révocation ait été brutale ou vexatoire.
« Le mémento de la SAS/SASU », RF Web 2019-2 , § 465
« Le mémento de la SA non cotée », RF Web 2019-5 , §§ 709 et 713
« Le mémento de la SARL et de l'EURL », RF Web 2020-3 , § 949

- À propos
- Qui sommes-nous ?
- Notre expertise
- Nous rejoindre
- Mentions légales
- Conditions Générales de Vente
- Conditions Générales d'Utilisation
- Politique de confidentialité
- Contactez-nous
- LE GROUPE REVUE FIDUCIAIRE www.revue-fiduciaire.com 100, rue La Fayette, 75010 Paris Tél. : 01 48 00 59 66 E-mail : [email protected]
- NOTRE LIBRAIRIE 100, rue La Fayette, 75010 Paris Tel. : 01 47 70 44 46 E-mail : [email protected]
- Suivez-nous
- La boutique
- Métiers
- Responsable comptable
- Ressources Humaines
- Gestionnaire Paye
- Expert-comptable
- Commissaire aux comptes
- Avocat d'affaires
- Gestionnaire de patrimoine
- CSE/Élus et RP
- Comptabilité
- La Revue Fiduciaire
- RF Comptable
- Veille juridique
- Fonds documentaires
- Social Expert
- Formulaires de l'Entreprise
- Formulaires de Droit Social
- RF Formation
- RF Capsules e-formation
- RF e-Learning
- RF e-Learning CAC
- Communication Client
- Comm'Avocat
- Comm'CGP
- Uloa by Invoke
- Patrim'Expert
Javascript est desactivé dans votre navigateur.
République Française
Service-Public.fr
Le site officiel de l’administration française
- Se connecter
- Accéder au site pour les entreprises
Partager la page
Le lien vers cette page a été envoyé avec succès aux destinataires.
Assemblée générale des copropriétaires.
Les copropriétaires doivent se réunir au moins une fois par an pour décider des travaux et des orientations qu'ils souhaitent pour leur immeuble. La tenue des assemblée générales obéit à des règles très précises. Chaque décision fait l'objet d'un vote dont les règles varient selon la nature des décisions à prendre.
Infographie - Assemblée générale des copropriétaires : les 6 étapes clés
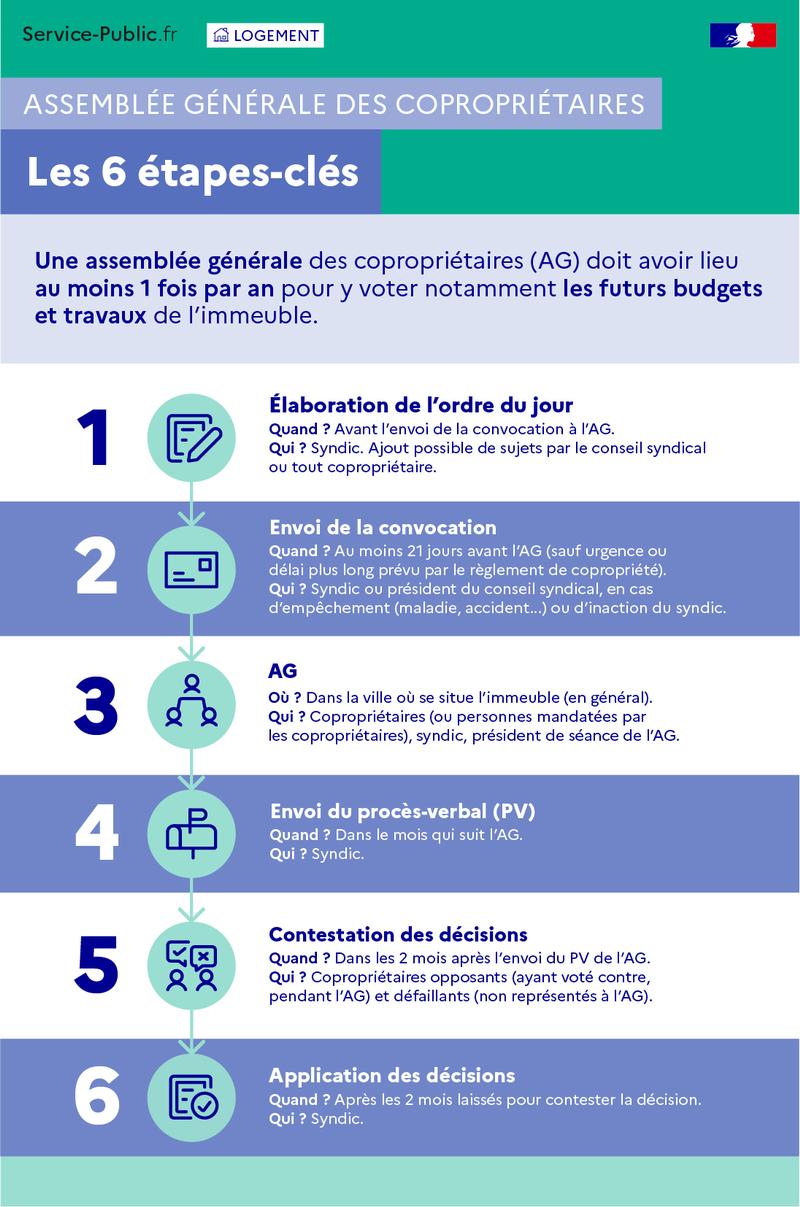
Ouvrir l’image dans une nouvelle fenêtre
Une assemblée générale des copropriétaires (AG) doit avoir lieu au moins 1 fois par an pour y voter notamment les futurs budgets et travaux de l'immeuble.
Élaboration de l'ordre du jour
Quand ? Avant l'envoi de la convocation à l'AG.
Qui ? Syndic. Ajout possible de sujets par le conseil syndical ou tout copropriétaire.
Envoi de la convocation
Quand ? Au moins 21 jours avant l'AG (sauf urgence ou délai plus long prévu par le règlement de copropriété).
Qui ? Syndic ou président du conseil syndical, en cas d'empêchement (maladie, accident...) ou d'inaction du syndic.
Où ? Dans la ville où se situe l'immeuble (en général).
Qui ? Copropriétaires (ou personnes mandatées par les copropriétaires), syndic, président de séance de l'AG.
Envoi du procès-verbal (PV)
Quand ? Dans le mois qui suit l'AG.
Qui ? Syndic.
Contestation des décisions
Quand ? Dans les 2 mois après l'envoi du PV de l'AG.
Qui ? Copropriétaires opposants (ayant voté contre, pendant l'AG) et défaillants (non représentés à l'AG).
Application des décisions
Quand ? Après les 2 mois laissés pour contester la décision.
Assemblée générale des copropriétaires : les 6 étapes clés
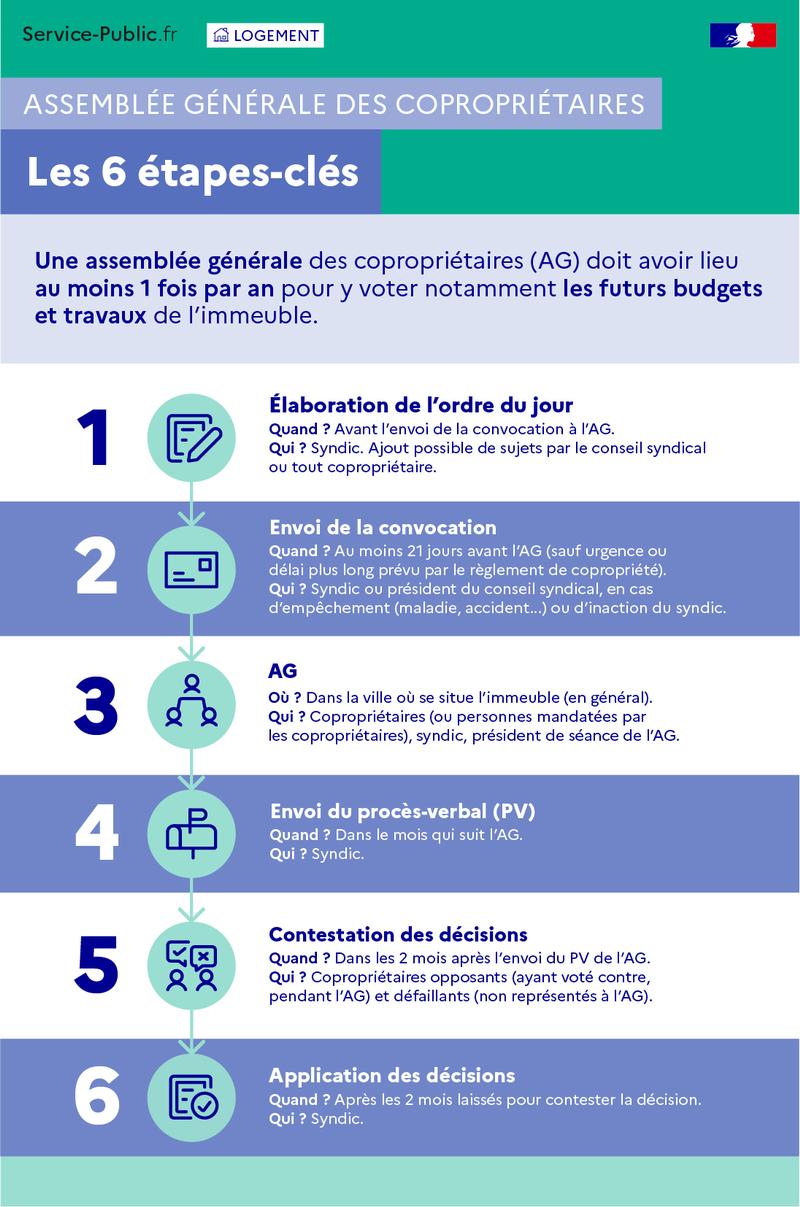
Lire la version texte
Convocation
Déroulement
Compte-rendu
Questions ? Réponses !
Quelles sont les règles de vote en assemblée générale de copropriété ?
Peut-on changer l'affectation d'un lot de copropriété ?
Peut-on contester une décision prise en assemblée générale de copropriété ?
Acteurs de la copropriété (organisation juridique)
Documents de copropriété
Budget et charges de copropriété
Copropriété en difficulté
Dossier relatif à l'assemblée générale des copropriétaires (PDF)
Agence nationale pour l'information sur le logement (Anil)
Ouvrage disponible à la vente sur vie-publique.fr
Publicité - La Documentation française
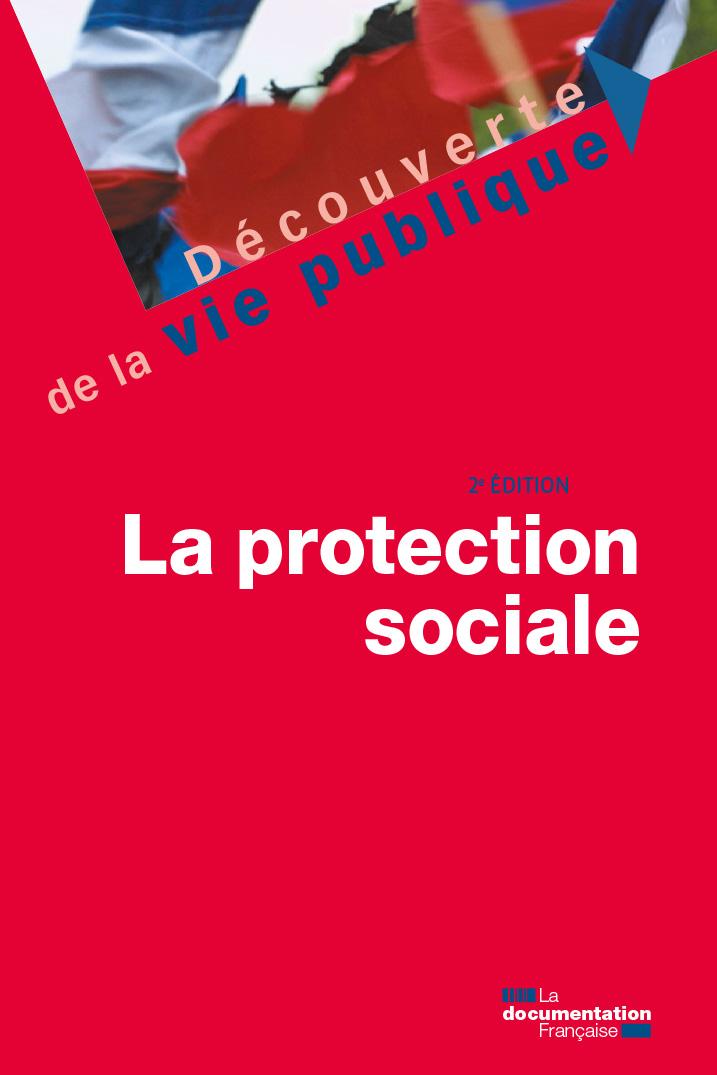

Recherche sur tout le site du village de la justice
Vous êtes sûr ?
Vous allez quitter votre espace membre , vous allez quitter votre espace emploi .
- Accueil
- / Actualités juridiques du village
- / Droit immobilier et urbanisme
- Actualités juridiques du village
- Droit immobilier et urbanisme
Abonnement aux Nouvelles parutions:
Vous permet de recevoir une alerte e-mail vous prévenant de la publication d'un nouvel article dans CETTE rubrique.

Xavier Demeuzoy - Avocat - www.demeuzoy-avocat.com
- Voir le profil de XAVIER DEMEUZOY
- Autres articles de l'auteur

Dix motifs d’annulation d’une assemblée générale de copropriétaires par un Tribunal.
Par xavier demeuzoy, avocat..
154369 lectures 1re Parution: 31 août 2018 Lecture "Tous publics" 31 commentaires 4.95 /5
Imprimer l'article
Syndics ou copropriétaires sollicitent régulièrement les professionnels du droit pour analyser la régularité de convocations où de Procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété. Cet article a pour objet de préciser 10 situations susceptibles d’obtenir l’annulation d’une assemblée générale par le Tribunal de Grande Instance.
14036 caractères
Préalablement à l’examen de ces motifs d’annulation, il convient de rappeler que toute contestation d’assemblée générale doit impérativement être introduite par une assignation du copropriétaire opposant ou défaillant signifiée par huissier de justice au Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’immeuble au plus tard dans un délai de deux mois à compter du lendemain de la réception du courrier recommandé avec accusé de réception du syndic contenant le Procès-verbal de l’assemblée générale.
Cette assignation doit être rédigée par le ministère d’un avocat.
Les motifs d’annulation peuvent être les suivants :
1. Le non respect par le syndic d’un délai de 21 jours entre la convocation et la tenue de l’assemblée générale.
Sauf urgence, l’article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 dispose que la convocation est notifiée au copropriétaire au moins 21 jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Le point de départ du calcul de ce délai de 21 jours commence le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
La Cour de cassation déclare nulle l’assemblée convoquée sans respecter le délai de 21 jours alors qu’aucune urgence n’est constatée. [ 1 ]
Par ailleurs, la Cour de cassation considère de façon constante qu’il n’est pas nécessaire que le demandeur en nullité allègue qu’il ait subi un préjudice personnel, ou que les autres copropriétaires aient subi un préjudice, du fait de l’envoi tardif de la convocation.
De même, la présence à l’assemblée du copropriétaire ne le prive du droit de demander la nullité de l’assemblée.
Attention toutefois, un copropriétaire ne peut invoquer le non-respect du délai de convocation pour demander la nullité des résolutions auxquelles il ne s’est pas opposé.

2. La convocation d’une assemblée générale par un syndic dont le mandat a expiré.
L’article 7 du décret du 17 mars 1967 dispose que le syndic doit convoquer au moins une fois par une assemblée générale.
Or, pour que cette convocation soit valable, il importe que le syndic soit toujours en fonction au moment où celle-ci est adressée aux copropriétaires.
A défaut d’un mandat effectif à la date de convocation à l’assemblée générale, celle-ci serait susceptible d’être annulée.
En effet, la jurisprudence tend à juger que l’absence de renouvellement du mandat du syndic équivaut à une absence de pouvoir d’agir et il ne saurait être allégué une quelconque qualité de « syndic de fait » pour couvrir l’irrégularité de la convocation. [ 2 ]
Dès lors, un copropriétaire pourrait effectivement obtenir l’annulation de l’assemblée générale, sous réserve toutefois du respect des conditions posées par l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 à savoir : 1) qu’il soit opposant ou défaillant (C’est-à-dire absent et non représenté) et, 2) qu’il agisse en contestation dans le délai légal de deux mois.
Sans quoi, l’assemblée générale deviendrait, malgré le vice qui l’entache, définitive et insusceptible de contestation. [ 3 ]
3. L’erreur dans la date de tenue de l’assemblée générale.
Comme le précise l’article 9 alinéa 1 du décret de 1967, La convocation à l’assemblée générale contient « l’indication des les lieu, date et heure de la réunion. »
Par conséquent, l’auteur de la convocation fixe les lieu et l’heure de la réunion en tenant compte s’il en existe, des stipulations du règlement de copropriété et décisions de l’assemblée générale.
Pour une illustration, La nullité de l’assemblée générale a été prononcée pour une convocation erronée délivrée pour le 20 au lieu du 21 décembre [ 4 ] ou encore pour une convocation à une date qui n’existe pas. [ 5 ] .
4. L’absence ou l’irrégularité de la désignation d’un présidence de séance /Le cumul irrégulier des postes de secrétaire et Président de séance.
L’article 15 du décret du 17 mars 1967 rappelle que la désignation d’un président, d’un secrétaire et, s’il y a lieu, d’un ou plusieurs scrutateurs au début de séance constitue une formalité substantielle à laquelle doit impérativement se plier l’assemblée générale des copropriétaires.
L’absence d’une telle désignation pourrait entraîner la nullité de l’assemblée générale, et ce, même en l’absence de griefs du requérant (qui devra toujours satisfaire les conditions de l’article 42 alinéa 2 de la loi précitée).
Il convient toutefois de préciser que la jurisprudence ne sanctionne pas seulement l’absence de désignation du président du bureau de l’assemblée générale mais également les irrégularités pouvant l’entacher.
D’une part, en effet, l’article 22-I de la loi du 10 juillet 1965 précise qu’il est interdit pour le syndic, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou ses préposés, de remplir la fonction de président de séance.
De plus, la jurisprudence a clairement jugé que seul un copropriétaire pouvait être élu président de séance et qu’il ne pouvait déléguer cette faculté à son mandataire s’il n’est pas lui-même copropriétaire. [ 6 ] .
D’autre part, la désignation tant du président que du secrétaire de séance étant une formalité substantielle et les deux fonctions étant légalement distinctes, une seule et même personne ne peut cumuler les deux fonctions, à peine de nullité de l’assemblée générale dans son ensemble. [ 7 ]
5. L’inapplication de la réduction des voix du copropriétaire majoritaire.
En matière de copropriété, la loi se veut protectrice contre tout type d’abus et notamment, en assemblée générale, contre les abus de position majoritaire.
Ainsi l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 impose que, dans les cas où un copropriétaire possède une quote-part de parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose soit réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
L’inapplication de cette règle de réduction des voix du copropriétaire majoritaire constitue une irrégularité affectant l’assemblée générale et pouvant justifier son annulation. [ 8 ] .
Il convient cependant de rappeler que cette irrégularité générale ne saurait faire obstruction à l’application des dispositions de l’article 42 de la loi précitée.
En ce sens, la jurisprudence a précisé que le copropriétaire, présent à l’assemblée générale pendant laquelle il n’est pas fait application de la règle de réduction des voix, n’était pour autant fondé qu’à demander l’annulation des résolutions contre lesquelles il s’était opposé. [ 9 ]
6. La participation irrégulière d’un mandataire au vote des résolutions.
Bien souvent, une assemblée générale s’expose à la nullité en raison de la violation de dispositions légales ou conventionnelles relatives au mandat.
En effet, si l’article 22-I de la loi du 10 juillet 1965 dispose que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, membre du syndicat ou non, il établit également des règles encadrant le mandat : limite du nombre de mandats ou de voix pour un mandataire, interdiction de représenter un copropriétaire pour le syndic, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou ses préposés.
De plus, le mandat doit nécessairement être écrit. [ 10 ]
Ainsi, en cas de violation de ces dispositions, la jurisprudence stricte et constante en la matière juge que la participation irrégulière d’un mandataire à l’assemblée générale entraîne la nullité de celle-ci, en dépit même du fait que son vote n’ait pu avoir d’incidence sur le sens de la décision adoptée. [ 11 ]
Attention toutefois, à l’inverse de la participation irrégulière d’un mandataire au vote, lorsque le syndicat porte atteinte au droit d’un copropriétaire d’être représenté à l’assemblée générale en écartant, sans prouver l’irrégularité du pouvoir donné, le vote d’un mandataire, l’assemblée générale peut également être annulée. [ 12 ]
7. Le dépassement du nombre de mandats ou de voix par un mandataire.
L’article 22-I rappelle qu’un mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de 3 délégations de vote.
Par dérogation, le mandataire peut néanmoins excéder cette limite si le total des voix qu’il a reçues en délégation et de ses voix (s’il est également copropriétaire) ne dépasse pas 5% des voix de l’ensemble des copropriétaires, ou s’il participe à l’assemblée générale du syndicat principal en qualité de mandataire de copropriétaires tous membres du même syndicat secondaire.
L’article 22-I précité ayant vocation à protéger la copropriété d’abus de majorité et étant d’ordre public, le non-respect de la limite établie (limite de 3 mandats ou 5% des voix) peut entraîner la nullité de l’assemblée générale.
8. Le vote d’une question non portée à l’ordre du jour.
L’article 13 du décret du 17 mars 1967 rappelle l’étendue de la compétence décisionnelle de l’assemblée générale en disposant qu’elle ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I du même décret.
De plus, la jurisprudence précise qu’une « décision qui a été votée conformément à l’ordre du jour ne peut être complétée par une autre qui n’y était pas inscrite ». [ 13 ]
Les dispositions de l’article 13 du décret précité étant d’ordre public, le vote d’une question non inscrite à l’ordre du jour est une cause de nullité de la décision irrégulièrement votée, mais toutefois pas de l’assemblée générale toute entière. [ 14 ]
De plus, il ne faut pas confondre une question non mentionnée à l’ordre du jour qui aurait été votée et celle qui aurait simplement été débattue et n’entrainerait aucune nullité. [ 15 ] .
Enfin, il ne saurait être dérogé à l’article 42 qui n’ouvre la voie de la contestation qu’au copropriétaire opposant ou défaillant agissant dans un délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale.
9. L’irrégularité tenant à la computation des voix.
La loi du 10 juillet 1965 encadre strictement le mode de computation des voix.
La violation des règles en la matière est sanctionnée par la nullité.
La jurisprudence sanctionne de nullité ainsi toute atteinte au droit fondamental des copropriétaires de participer ou de se faire représenter à l’assemblée générale et ce, sans qu’il ait à en rechercher l’influence sur le résultat du vote. [ 16 ]
Pour une illustration, serait nulle toute assemblée où les voix seraient décomptées par tête, ou attribuées en fonction du nombre de lots ou encore de la participation aux charges (sauf application de l’article 24 III de la loi du 10 juillet 1965) et non pas en fonction des quotes-parts de parties communes.
Dans le même sens, des voix ne pourraient être écartées au prétexte qu’il s’agit de lots non vendus ou non construits ou encore en raison de la nature des lots. [ 17 ]
Par ailleurs, et sauf exception spécifique de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 portant l’impossibilité pour un copropriétaire débiteur de voter sur l’autorisation donnée au syndic d’agir en justice en vue de la saisie de la vente de son lot, un mandataire ne pourrait être écarté du vote alors qu’il dispose d’une délégation de vote.
10. L’absence de la mention de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans le Procès-verbal d’assemblée générale.
La mention de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans le procès-verbal d’assemblée générale est rendue obligatoire par l’article 18 du décret du 17 mars 1967.
La mention dans le procès-verbal dudit article est exigée afin que les copropriétaires opposants et défaillants puissent prendre conscience des délais courts et impératifs auxquels doit s’astreindre toute éventuelle action en contestation (2 mois à compter de la notification du procès-verbal).
Cependant, à la différence des autres motifs précédemment exposés, l’absence de reproduction de l’article 42 de la loi précitée, n’entraîne pas la nullité de l’assemblée générale, mais emporte modification des conditions dans lesquelles la contestation pourra se faire.
En effet, à défaut de reproduction, le délai pour contester les décisions de l’assemblée générale est porté à 10 ans. [ 18 ]

Xavier Demeuzoy - Avocat au Barreau de Paris - www.demeuzoy-avocat.com
- 31 commentaires Commenter
Recommandez-vous cet article ?
Donnez une note de 1 à 5 à cet article : L’avez-vous apprécié ?
Notes de l'article:
[ 1 ] Civ. 3ème. 3 octobre 1974 D.1975. 130 ; JCP 1975 II 18007 note Guillot.
[ 2 ] Civ. 3e, 14 octobre 1987, n°85-18.749.
[ 3 ] Civ. 3e, 7 avril 2009, n°08-15.204.
[ 4 ] TGI Marseille 28 février 1978 Administrer juillet 1979 n°93
[ 5 ] Paris 3 mai 2002 Administrer juillet-aôut 2002 – 58. Observation Bouyeure – Paris 11 mai 2011 – RG n°09/02627 AJDI 2012
[ 6 ] Civ. 3e, 13 novembre 2013, n°12-25.682
[ 7 ] Civ. 3e, 6 novembre 2002, n°01-10.800.
[ 8 ] Voir en sens Civ. 3e, 3 mars 2010, n°09-11.874 : jugeant que la simple inapplication de réduction des voix du copropriétaire majoritaire suffisait à caractériser l’irrégularité des décisions contestées
[ 9 ] Civ. 3e, 4 février 2014, n°12-27.512 et n°12-28.380.
[ 10 ] V. par ex. Civ. 3e, 19 juillet 1995, n°93-17.911. A contrario v. Paris 11 septembre 1992 : Administrer août-sept 1993. 26, obs Guillot : reconnaissant l’existence d’un mandat tacite entre époux.
[ 11 ] Voir en ce sens : Civ. 3e, 11 février 1975, n°73-13.338.
[ 12 ] V. par ex. Civ. 3e, 22 février 1989, n°87-17.497.
[ 13 ] Civ. 3e, 7 novembre 2007, n°06-18.882.
[ 14 ] Voir en ce sens : Paris, 9 février 2011, RG n°09/17735 annulant la décision désignant un syndic bénévole alors que l’ordre du jour ne mentionnait que le renouvellement du syndic.
[ 15 ] Voir en ce sens : Civ. 3e, 10 mai 1983, n°81-16.318
[ 16 ] Civ. 3ème. 22 février 1989 n°87-17.497 Bull.civ. III n°47 Administrer sept. 1989. D.1989. IR 87.
[ 17 ] Civ. 3ème 20 novembre 1996 – RG 94-19-140.
[ 18 ] Voir en ce sens : Paris, 11 octobre 2001, AJDI 2002.141.
[ 19 ] Aix en Provence, 26 octobre 1995 : Bull. Aix 1995, n°2, p.302
[ 20 ] Paris, 19 janvier 2006, AJDI 2006.390
Discussions en cours :
Une AG peut-elle être annulée dans le cas où le syndic n’a pas convoqué dans les règles un copropriétaire ? Il prétend l’avoir fait mais est incapable d’en apporter la preuve formelle. L’accusé de réception semble avoir été signé par la gardienne, mais pas par le copropriétaire. Le facteur avait sans doute la flemme de monter dans les étages. Ladite gardienne affirme avoir déposé la LRAR... sur le paillasson du copropriétaire, en l’absence de celui-ci ! Comment le courrier a-t-il disparu ? En tous cas, le copropriétaire assure ne pas l’avoir reçu.
Lors de la derrière AG, plusieurs pouvoirs était mal rempli. Il manquai : Les NOM, Prénoms, et adresse .
Sont ’ils valable ? Ou peuvent ’il être contesté ?
le solde positif de 70000 euros a été mis dans un compte intitulé Prévoyance et ne sera pas transférable en cas de vente . Le syndic a-t-il une responsabilité ?
Bonjour Dans ma copropriété une AG a été tenue sur convocation du président du CS après mise en demeure restée infructueuse. Cependant, le CS n’a pas été voté depuis au moins 5 ans. Cette AG peut elle encore être contestée en dehors du délai d’un mois ?
Notre syndic nous relance pour que l on reponde a sa convocation d assemblee ? apparemment beaucoup de coproprietaires n’ont pas donné leurs consigne de vote. Y a T il un minimum de reponse pour que l on considere que l assemblee a bien eue lieu ?
A lire aussi dans la même rubrique :

Charges du bail commercial : le remboursement des provisions injustifiées versées par le locataire à son bailleur. Par Vianney Pommier, Avocat.
10 mai 2024 lire la suite

La suspension du délai de validité des autorisations d’urbanisme en cas de recours contentieux. Par Oriane Sommagio, Avocate.
7 mai 2024 lire la suite

Nature de la location saisonnière et compatibilité avec une clause bourgeoise. Par Clément Diaz, Avocat.
3 mai 2024 lire la suite

Démolition d’ouvrage non conforme ou illicite. Par Bouziane Behillil, Avocat et Romane Sylvestre, Etudiante.
30 avril 2024 lire la suite

Bienvenue sur le Village de la Justice .
Le 1er site de la communauté du droit, certifié 3e site Pro en France: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *
Aujourd'hui: 154 865 membres, 26061 articles, 126 991 messages sur les forums , 3 430 annonces d'emploi et stage ... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *

FOCUS SUR...
• [Semaine de l'alternance] L'alternance en droit, une opportunité d'insertion professionnelle.
• Lancement du Chatbot IA de recherche avancée du Village de la justice.
Tous les Articles publiés
Populaires en ce moment
Annonces d'Emploi
Formations à venir
LES HABITANTS

PROFESSIONNELS DU DROIT

Nouvelles parutions

Regards de juristes sur Les Aventures de Tintin.

Printemps digital chez LexisNexis !
-40% sur la Presse.

Fonds de commerce 2023 - Ce qu’il faut savoir
Des réponses concrètes aux différentes problématiques juridiques posées par les fonds de commerce
A côté du droit !

Sélection Liberalis du Week-end : une exposition dédiée à James Cameron à la Cinémathèque Française.

[Nouvelle parution] Nécropoles : du fait divers au crime contre l’humanité, un médecin légiste raconte…

Sélection Liberalis spécial jour férié : L’exposition sur l’architecte Renzo Piano à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé.

La chaîne "Vidéos et droit" du Village de la justice:
Information
Vous devez être inscrit et connecté à notre Espace Membre pour pouvoir vous abonner
Au sommaire de cet article :
👋 Bonjour, nous sommes ravis de vous revoir ! Cliquez ici pour reprendre votre démarche
| Découvrez notre nouveau guide pour créer son entreprise. Et c'est gratuit ! Cliquez ici pour le découvrir 💚
Comment annuler une assemblée générale ?
Charlotte Autissier
Diplômée du Master droit économique de Sciences Po Paris.
Mis à jour le 25 juin 2020
La vie d’une société est rythmée par les assemblées générales au cours desquelles des décisions importantes sont prises pour l’entreprise. A cet égard, une assemblée générale ordinaire doit être réunie obligatoirement une fois par an pour l’ approbation des comptes de la société.
Toutefois, lorsque les conditions de validité ne sont pas réunies, il est possible de faire annuler l’assemblée générale . Quelles sont les conditions d’annulation d’une assemblée générale ? On fait le point.
Mini-Sommaire
Pourquoi faire annuler une assemblée générale ?
L’ assemblée générale , fréquemment appelée “ AG ”, consiste à réunir les associés pour voter les décisions importantes ou annuelles de l’entreprise.
En cas de non-respect des règles de tenue d’une assemblée générale, il est possible d’annuler l’assemblée générale, ou l’une des décisions prises au cours de celle-ci. Il existe différents motifs d’annulation d’une assemblée générale . L’a nnulation d’une assemblée générale est notamment possible lorsque la convocation est irrégulière.
Pour être valide, l’assemblée générale doit respecter certaines conditions relatives à son organisation, notamment :
- Les modalités de convocation des associés ;
- L’envoi des documents nécessaires aux associés afin de pouvoir organiser ; l’assemblée générale (l’ordre du jour, les projets de résolutions soumis au vote, etc) ;
- Les règles de quorum et de majorité ;
Exemple : avant de réunir l’AG, les associés doivent être prévenus selon délai particulier. Les délais de convocations en SARL sont de 15 jours minimum. En SAS ou en SCI, les délais sont prévus par les statuts de la société. En cas d’irrégularité de convocation, il est possible d’annuler l’AG.
Quelles sont les conditions pour annuler une assemblée générale dans son ensemble ?
L’ annulation d’une AG dans son ensemble est possible lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
- Les règles de voix n’ont pas été respectées, autrement dit les conditions de quorum et majorité n’ont pas été remplis ;
- Certains documents nécessaires au vote n’ont pas été transmis (par exemple, ne pas avoir transmis le rapport de gestion 15 jours avant l’assemblée générale annuelle) ;
- La convocation est irrégulière ;
- L’ordre du jour n’est pas respecté ou est imprécis.
Quelles sont les conditions pour annuler une décision d’assemblée générale ?
Lorsqu’ une décision prise en assemblée générale ne respecte pas les conditions requises pour être valides, il est possible de l’annuler à condition que :
- La décision n’ait pas encore été exécutée ;
- L’annulation ne porte pas atteinte à l’intérêt collectif des associés ;
- L’annulation ne porte pas atteinte à des droits acquis lors de la décision initiale ;
- La d écision peut être valablement contestée (abus de majorité ou minorité) ;
- La décision n’a pas fait l’objet d’une publication au RCS.
En pratique : l’a nnulation d’une assemblée générale extraordinaire et l’annulation d’une assemblée générale ordinaire répondent aux mêmes conditions.
Annulation d’une assemblée générale : comment faire ?
Pour faire annuler une assemblée générale, il faut réunir une nouvelle assemblée générale dite rectificative. Au cours de cette nouvelle assemblée, les erreurs ayant eu lieu lors de la précédente assemblée générale pourront être rectifiées.
Au cours de cette nouvelle assemblée générale, pensez à éviter toute irrégularité. Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur un modèle de convocation d’assemblée générale .
Comment annuler une assemblée générale d’association ? L’ assemblée générale d’association peut être annulée dans les mêmes conditions que l’AG d’une société (défaut de quorum requis, défaut de convocation de tous les membres, etc).
Note du document :
4,5 - 15 vote(s)
Fiche mise à jour le 25 juin 2020
Vous souhaitez utiliser un outil de comptabilité en ligne ?
Ces articles pourraient aussi vous intéresser :

Assemblée Générale Annuelle : quel déroulement ?

Délai de convocation d’AG : société, association et copropriété

Comment fonctionne la convocation d’une assemblée générale ?

Comment faire une assemblée générale extraordinaire ?

Qu’est-ce que le compte rendu d’assemblée générale ?

Zoom sur le vote en Assemblée générale
Recherches les plus fréquentes
- Taux de marge calcul
- Depot des comptes annuels
- Changement d'adresse entreprise
- Transfert siège social
- Fermer un établissement secondaire
- Transformation SARL en SAS conditions
- Augmentation capital par incorporation de réserves
- Augmentation du capital par incorporation du compte courant
- Capitaux propres négatifs conséquences
👋 On a besoin de vous !
Si vous appréciez notre contenu, un avis sur Google nous aiderait énormément !
Donner mon avis

- Présentation
- Syndic de copropriété
- Gérance locative
- Transaction
- Espace client
- Prélèvement automatique
- Prélèvement à la demande
- En cas de dégâts des eaux
- En cas de vente
- Je m’informe
Comment participer aux Assemblées générales par visioconférence ?

Comment voter par correspondance pour l’assemblée générale de votre copropriété ?
Coup de pouce énergétique pour les copropriétés et les bâtiments résidentiels collectifs

Les modalités pour le report des assemblées générales en copropriété
La crise sanitaire du COVID 19 et la déclaration de l’état d’urgence qui s’en est suivie, ont entrainé l’impossibilité pour les syndics d’assurer les Assemblées Générales pendant cette période* et donc de renouveler leur mandat auprès des copropriétaires.
Trois ordonnances successives du 25 mars 2020, du 22 avril 2020 et du 20 mai 2020 ont organisé la continuité de l’administration des immeubles.
Les mandats de syndic sont prolongés
Les contrats de syndic qui devaient expirer entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 sont automatiquement renouvelés dans les mêmes termes, jusqu’au nouveau contrat de syndic désigné lors de la prochaine assemblée générale des copropriétaires.
La rémunération du contrat temporairement renouvelé est donc prévue comme devant être identique aux conditions du contrat initial, au prorata de la durée du renouvellement.
Les mandats des conseils syndicaux sont aussi prolongés
Faute de réunion des Assemblées Générales, les conseils syndicaux dont les mandats devaient expirer entre le 12 mars et le 23 juillet 2020, sont prolongés jusqu’à la prochaine Assemblée Générale.
La convocation des Assemblées Générales
Les Assemblées Générales de copropriété qui n’ont pu se tenir depuis le 12 mars doivent être à nouveau convoquées ou (re)convoquées, suivant le cas, pour se tenir impérativement avant le 31 janvier 2021.
La convocation adressée aux copropriétaires doit comprendre l’ensemble des documents annexes mêmes si ceux-ci avaient pu déjà être envoyés lors d’une première convocation annulée.
Les préconisations sanitaires actuelles
Si les rassemblements doivent encore être évités, certaines réunions impératives, limitées à 10 personnes, peuvent se tenir telles que des réunions de conseils syndicaux, des visites d’immeuble ou des réunions de vérification de comptes. Encore faut-il que la capacité d’accueil des salles permette de répartir les participants suffisamment éloignés les uns des autres.
Les règles de sécurité sanitaire doivent alors être scrupuleusement respectées par chacun sous la responsabilité du gestionnaire qui devra veiller à la bonne mise en application des gestes barrières, de la distanciation sociale et des préconisations liées à l’activité de gestion immobilière (stylos à usage unique, documents qui ne circulent pas entre les participants…).
Les Assemblées Générales dématérialisées
L’ordonnance du 20 mai 2020 ouvre la possibilité de tenir des assemblées générales dématérialisées, notamment par visioconférence ou audioconférence, à partir du 1 er juin 2020 et ce, jusqu’au 31 janvier 2021. En cas d’impossibilité de réaliser une visio/audioconférence, les décisions des copropriétaires pourront être prises avec un vote par correspondance. Quelle que soit la solution retenue, celle-ci devra garantir l’identification des copropriétaires, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations. Cette option demande donc des moyens technologiques très précis et performants.
* Seules les toutes petites copropriétés qui correspondent à des Assemblées Générales de moins de 10 personnes ont pu être envisagées depuis le 11 mai tout en respectant les préconisations sanitaires.
Dates repères
Du 12 mars 2020 au 23 juillet 2020 – Les contrats de syndics échus pendant cette période sont prolongés de plein droit jusqu’à la tenue de l’AG prochainement.
Du 23 juillet 2020 au 31 janvier 2021 – Tenue des AG qui n’ont pas pu avoir lieu pour cause de crise sanitaire

- il y a 2 jours
- 8 min de lecture
Quorum en Assemblée Générale : pourquoi sa maîtrise est vitale
Le Quorum en assemblée générale en 3 points :
Définition du Quorum : Le quorum représente le nombre minimal de membres présents ou représentés requis pour que les décisions prises lors d'une assemblée générale soient valides et légitimes. Ce seuil est crucial pour éviter que des décisions majeures soient influencées par une minorité non représentative des intérêts globaux des actionnaires.
Utilité du Quorum : En droit des affaires, le quorum garantit que les décisions prises reflètent un consensus minimal et protègent l'entreprise contre les abus de pouvoir, assurant ainsi que toutes les voix, y compris celles des petits actionnaires, soient prises en compte dans la gouvernance d'entreprise.
Risques d'un Quorum Non Respecté : L'absence de quorum peut entraîner l'invalidité des résolutions prises, nécessitant de nouvelles convocations d'assemblées générales , ce qui peut générer des retards et des coûts supplémentaires pour l'entreprise, tout en créant une insécurité juridique quant aux décisions de gestion.
Introduction sur le Quorum en assemblée générale
Le quorum, terme juridique fréquemment invoqué dans le cadre des assemblées générales des sociétés, constitue une condition sine qua non pour la validité des délibérations prises par les actionnaires ou les associés. Ce concept, bien que technique, s'inscrit au cœur de la gouvernance d'entreprise, garantissant que les décisions sont prises avec un niveau de représentation suffisant pour refléter les intérêts de l'ensemble des parties prenantes.
Article à lire : qu'est que l'abus de majorité lors d'une assemblée générale ?
Qu’est que le quorum dans une assemblée générale ?
Le quorum se définit comme le nombre minimum de membres présents ou représentés nécessaire pour que l'assemblée générale puisse valablement délibérer et prendre des décisions. Cette mesure est essentielle pour éviter que des décisions importantes soient prises par une minorité trop restreinte d'actionnaires ou d'associés, ce qui pourrait porter préjudice à la société et à ses actionnaires. En droit des affaires, le respect du quorum est donc un pilier de la légitimité et de la légalité des résolutions adoptées.
Importance du quorum en droit des affaires
En droit des affaires, le quorum est d'autant plus crucial qu'il assure une prise de décision démocratique et représentative au sein des entreprises. Il protège les intérêts collectifs des associés en s'assurant que les décisions qui influencent la direction et la gestion de l'entreprise sont prises avec un consensus minimal. C'est une garantie contre les abus potentiels de pouvoir et un moyen d'assurer que toutes les voix, surtout celles des petits actionnaires, sont entendues et prises en compte.
Article à lire : quelles sont les obligations légales des sociétés Francaises ?
Aspects juridiques du quorum
Bases légales du quorum pour les assemblées générales.
La réglementation du quorum est principalement définie par le Code de commerce et les statuts de chaque société qui peuvent adapter les règles légales à leur contexte spécifique. Par exemple, l'article L. 225-96 du Code de commerce stipule que le quorum pour les assemblées générales ordinaires des sociétés anonymes est fixé à un quart des actions lors de la première convocation et à un cinquième lors des convocations suivantes. Cette disposition légale varie en fonction du type de société (SA, SARL, SAS) et de la nature de l'assemblée (ordinaire, extraordinaire).

Comment calculer le Quorum ?
Le calcul du quorum est généralement basé sur le nombre d'actions possédées par les membres présents ou représentés. Pour garantir l'exactitude de ce calcul, il est crucial que toutes les présences soient dûment enregistrées et que les procurations soient correctement vérifiées. Des exemples pratiques montrent que la gestion rigoureuse des listes de présence et des votes par correspondance est essentielle pour assurer le respect des règles de quorum.
Article à lire : comment faire annuler une Assemblée Générale ?
Conséquences de l'absence de quorum
L'absence de quorum lors d'une assemblée générale conduit à l'invalidité des résolutions qui auraient pu être prises. Cela nécessite la convocation d'une nouvelle assemblée avec des règles de quorum potentiellement assouplies, comme le prévoit la loi pour les deuxièmes convocations. Cette situation peut engendrer des retards dans la prise de décision et des coûts supplémentaires pour l'entreprise, soulignant l'importance de bien planifier et communiquer autour des assemblées.
Le quorum est une pierre angulaire de la gouvernance des entreprises, essentiel pour assurer que les décisions prises lors des assemblées générales soient à la fois légitimes et démocratiques. Sa compréhension et sa gestion adéquate sont donc cruciales pour tout avocat spécialisé en droit des affaires , garantissant que ses clients naviguent efficacement dans le paysage complexe des assemblées générales.
Pratiques et stratégies pour atteindre le quorum
Atteindre le quorum requis lors des assemblées générales est une préoccupation constante pour les avocats spécialisés en droit des affaires. Des méthodes efficaces et une planification stratégique sont essentielles pour garantir la participation nécessaire et la légitimité des décisions prises.
Méthodes pour maximiser la participation à l'assemblée générale
Utilisation des pouvoirs et procurations.
Le recours aux pouvoirs et procurations est une pratique courante pour atteindre le quorum. Les actionnaires ou associés qui ne peuvent assister personnellement à l'assemblée peuvent mandater une autre personne pour voter en leur nom. Cette méthode permet d'assurer une représentation plus large des intérêts et de maximiser les chances de réunion du quorum. Il est crucial de veiller à ce que les procurations soient collectées et vérifiées conformément aux dispositions statutaires et légales, pour éviter tout litige sur la validité des décisions prises.
Article à lire : la protection des actionnaires minoritaires
Recours aux technologies de vote à distance
Avec l'avancée technologique, le vote à distance est devenu un outil précieux pour faciliter la participation des membres. Des plateformes sécurisées permettent aux actionnaires de voter sans être physiquement présents, contribuant ainsi à atteindre plus facilement le quorum. Ce mode de participation doit être encadré par des règles claires, souvent stipulées dans les statuts de la société ou définies par la réglementation en vigueur, pour garantir l'intégrité et la confidentialité des votes émis.
Gestion des absences
Anticipation des problèmes de quorum.
Anticiper les problèmes de quorum nécessite une analyse rigoureuse des tendances de participation aux assemblées précédentes et une communication efficace avec les actionnaires. Informer régulièrement les actionnaires des enjeux à discuter et de l'importance de leur vote peut encourager une plus grande participation. De plus, l'identification préalable des actionnaires susceptibles d'être absents et l'encouragement à utiliser des procurations ou le vote à distance sont des stratégies proactives pour minimiser les risques de non-atteinte du quorum.
Planification stratégique des dates et heures des assemblées
La sélection stratégique des dates et heures des assemblées générales est une autre approche pour maximiser la participation. Programmer les assemblées à des moments où la majorité des actionnaires est susceptible d'être disponible — par exemple, en évitant les périodes de vacances ou les fins de semaine — peut augmenter significativement la présence. Une analyse détaillée des disponibilités et des préférences des actionnaires peut informer cette décision, assurant ainsi une meilleure atteinte du quorum.
Atteindre le quorum dans les assemblées générales requiert une combinaison d'approches tactiques et technologiques. Pour les avocats spécialisés en droit des affaires, conseiller efficacement leurs clients sur ces pratiques est essentiel pour garantir la légalité et la légitimité des décisions prises par les entreprises, solidifiant ainsi la confiance dans la gouvernance d'entreprise.
Exemples notables sur l'atteinte ou non du Quorum
Analyse de cas où le quorum n'a pas été atteint et les impacts subséquents.
Un cas illustratif concerne une société anonyme où, lors d'une assemblée générale extraordinaire, le quorum requis n'a pas été atteint pour la modification des statuts. La première convocation n'avait réuni que 15% des actions, alors que la loi exigeait au moins 25% conformément à l'article L. 225-96 du Code de commerce. En conséquence, une deuxième assemblée a dû être convoquée, avec des coûts supplémentaires pour l'entreprise et un retard dans l'exécution des stratégies nécessaires. Cette situation a aussi engendré une insécurité juridique quant à la gestion future de la société, illustrant l'importance cruciale de la planification et de la communication préalable avec les actionnaires.
Jurisprudence influençant l'interprétation des règles de quorum
La jurisprudence a souvent joué un rôle déterminant dans l'interprétation des règles relatives au quorum. Par exemple, dans une décision rendue par la Cour de cassation, il a été statué que le non-respect du quorum lors de la première convocation ne rend pas automatiquement nulle la décision prise lors d'une deuxième assemblée si le quorum réduit est alors respecté. Cette décision souligne l'importance de bien comprendre les conditions spécifiques de chaque convocation et les implications légales de chaque réunion d'actionnaires.
Leçons tirées
Conseils basés sur des cas réels pour éviter les erreurs courantes.
Les avocats en droit des affaires peuvent tirer plusieurs leçons des cas précédents pour éviter les erreurs courantes liées au quorum :
Communication proactive : Informer et engager les actionnaires bien avant les assemblées pour s'assurer de leur présence ou de leur représentation par procuration. L'utilisation efficace des bulletins d'information et des plateformes de communication digitale est recommandée pour toucher un large public.
Flexibilité dans la planification : Planifier les assemblées en tenant compte des disponibilités des actionnaires majoritaires peut aider à atteindre le quorum nécessaire. La surveillance des tendances de participation et l'ajustement des horaires en conséquence sont des pratiques judicieuses.
Utilisation de la technologie : Promouvoir le vote à distance pour inclure les actionnaires incapables d'assister physiquement, en s'assurant que les technologies utilisées sont sécurisées et conformes aux exigences légales.
Révision régulière des statuts : Adapter les statuts de la société pour qu'ils soient en accord avec les pratiques modernes et les exigences légales, notamment concernant les modalités de quorum et de vote, peut prévenir des complications lors des assemblées générales.
Une compréhension approfondie des cas de jurisprudence et une application prudente des leçons tirées sont indispensables pour les avocats spécialisés en droit des affaires à Versailles , afin de naviguer efficacement dans les complexités des assemblées générales et de garantir la légalité des décisions prises.
Conclusion sur l'importance du Quorum en Assemblée Générale
La gestion rigoureuse du quorum dans les assemblées générales n'est pas seulement une exigence légale mais aussi une nécessité pour la bonne gouvernance des entreprises. Pour les avocats spécialisés en droit des affaires, une compréhension approfondie de cette notion et de ses implications est essentielle pour conseiller efficacement leurs clients.
Résumé des points clés
Le quorum, défini comme le nombre minimum de membres présents ou représentés nécessaire pour que les délibérations d'une assemblée soient valides, joue un rôle crucial dans la légitimité des décisions prises. Les règles concernant le quorum varient selon le type de société et la nature de l'assemblée, mais le principe reste universel : assurer que les décisions importantes soient prises avec un soutien suffisant, reflétant ainsi une démarche démocratique et équilibrée. Les bases légales, telles que stipulées dans le Code de commerce, offrent un cadre réglementaire strict, mais les statuts de chaque société peuvent présenter des spécificités qui exigent une attention particulière.
L'importance de la vigilance en matière de quorum ne saurait être sous-estimée. Les avocats spécialisés en droit des affaires doivent non seulement s'assurer que toutes les conditions légales sont respectées pour la tenue des assemblées, mais aussi conseiller leurs clients sur les meilleures pratiques pour maximiser la participation. Cela inclut l'usage efficace des pouvoirs et procurations, ainsi que l'adoption de technologies modernes pour le vote à distance, garantissant ainsi une participation plus large et une représentation adéquate des intérêts des actionnaires.
Anticiper les problèmes de quorum et planifier stratégiquement sont des compétences clés que tout avocat dans ce domaine devrait développer. L'analyse de cas concrets et la compréhension des décisions de jurisprudence associées permettent de tirer des leçons précieuses qui peuvent prévenir les erreurs communes et les litiges potentiels.
En définitive, rester vigilant sur les questions de quorum est indispensable pour éviter les litiges et assurer une gouvernance d'entreprise efficace. Les avocats doivent donc être proactifs, non seulement dans la surveillance des règles de quorum mais également dans leur capacité à anticiper et résoudre les problèmes avant qu'ils ne compromettent la stabilité et la légitimité des décisions d'entreprise.
Les avocats spécialisés en droit des affaires jouent un rôle crucial en assurant que le quorum, cette pierre angulaire de la gouvernance d'entreprise, soit respecté pour le bien de la société et de ses actionnaires. Dans ce contexte, chaque conseil prodigué et chaque action entreprise pour renforcer la participation des actionnaires est un pas de plus vers la consolidation d'une gouvernance robuste et respectueuse des droits de toutes les parties prenantes.
Posts récents
Comment fonctionne la convocation à une assemblée générale ?
Qu'est qu'une assemblée générale ? Comment se déroule une AG ?
Comment annuler une Assemblée Générale ?

Quel est votre email ?*
- Home LegalPlace
- Assemblée Générale SAS
L’assemblée générale d’une SAS
Dernière mise à jour le 02/07/2021
Les pouvoirs de l’assemblée générale
Le fonctionnement de l’assemblée générale, règles de majorité et de quorum dans les prises de décisions de l’assemblée générale, aménagement des droits de vote, vote en assemblée générale et pacte d’associés.
- Infographie : L’assemblée générale d’une SAS en bref

L’assemblée générale d’une SAS est une réunion de la collectivité des associés , pendant laquelle cette dernière doit adopter des décisions qui lui sont soumises au titre d’un ordre du jour.
Le terme d’assemblée générale est, du point de vue strictement juridique, impropre à la SAS, car, contrairement aux cas des SARL ou des SA, la loi n’impose nullement que les décisions collectives des associés de SAS soient prises en “assemblées générales”: c’est aux statuts de SAS de fixer les règles de prises de décisions collectives (article L. 227-9 du code de commerce) .
En pratique, dans la majorité des statuts de SAS, il est prévu un fonctionnement de type assemblées générales comme dans les SA, avec toutefois certains assouplissements en matière de convocation, de mode de prises de décision, permettant d’alléger le formalisme de tenue des assemblées générales.
La loi précise également que, sauf dans certains cas, c’est aux statuts de fixer les pouvoirs de la collectivité des associés. Les règles relatives à la tenue des assemblées générales en SAS vont donc se décider dès la création de la SAS .
C’est aux statuts de SAS de déterminer la compétence et les pouvoirs de l’assemblée générale de la SAS (la collectivité des associés) . C’est à dire que c’est aux statuts de fixer dans quels cas des décisions doivent impérativement être prises ou approuvées par la collectivité des associés.
Toutefois, le Code de commerce impose que les décisions suivantes soient prises par la collectivité des associés :
- L’approbation des comptes annuels et affectation des bénéfices
- L’ augmentation de capital , la réduction de capital , l’amortissement du capital
- La dissolution de la SAS
- La transformation de la SAS en une société d’une autre forme juridique
- La fusion, la scission, les apports partiels d’actifs soumis au régime des scissions
- L’examen des conventions réglementées
- Les décisions pour lesquelles la loi impose qu’elles soient prises à l’unanimité des associés (voir ci-après)
En pratique, le plus souvent les statuts prévoient que l’assemblée générale des associés est également compétente pour toutes les décisions portant sur la modification des statuts de la SAS .
Ici encore, c’est aux statuts de SAS de déterminer les règles et la forme de prise de décisions de la collectivité des associés . La prise des décisions en assemblée générale n’est qu’une modalité de prise de décision parmi d’autres.
Mode de prises de décision
Il est possible d’envisager, dans les statuts, divers mode de prises de décision et d’imposer certains modes dans certains cas ou de laisser à l’organe dirigeant (tel que le président de SAS ou le directeur général de SAS ) la possibilité de choisir l’un des modes à chaque fois qu’il souhaite solliciter la collectivité des associés pour une décision .
Les modes de prises de décision les plus connus tels que retranscrits dans les statuts de SAS sont les suivants :
Assemblées générales
La prise de décisions des associés en assemblées générales est la forme la plus communément utilisée dans les SAS . L’assemblée générale permet aux associés de se voir physiquement (ou d’assister par d’autres moyens telles que les conférences téléphoniques ou les visioconférences) et d’échanger sur les sujets fixés à l’ordre du jour, avant de voter pour adopter ou rejeter une résolution.
Les statuts doivent tout d’abord dans ce cas définir les règles applicables aux convocations des associés , et les lieux où l’assemblée peut se tenir.
Mieux vaut prévoir des règles souples, telles qu’une convocation par tous moyens (y compris par e-mail), avec un délai de préavis suffisant mais pas trop long (par exemple, 8 jours de préavis), et la possibilité de se réunir au siège social ou à tout autre endroit fixé dans la convocation (pour autant qu’il soit accessible).
Il convient également que les statuts prévoient les détails suivants :
- La présidence de l’assemblée (en général, le président ou un DG, un associé ayant le plus de voix)
- Les règles de représentation d’un associé en assemblée : peut-il donner pouvoir à un autre associé ou à toute personne de son choix (ce qu’il vaut mieux éviter compte tenu du caractère confidentiel des sujets pouvant être évoqués en assemblée)
- Les règles d’établissement d’une feuille de présence et d’un procès-verbal d’assemblée générale ( PV d’assemblée générale de SAS )
Une alternative peut être de prévoir une résolution, en début de réunion, par laquelle les associés votent à l’unanimité la purge du respect de la procédure statutaire de convocation de l’assemblée générale.
Consultations écrites
Afin d’éviter une réunion, ce qui nécessite une disponibilité commune pour les associés, la prise de décision par consultations écrites est de plus en plus répandue.
Dans ce cas, la personne à l’initiative de la convocation (que les statuts de SAS devront bien identifier) devra adresser le texte des résolutions aux associés qui disposeront d’un certain délai pour se prononcer par un oui ou un non. Les associés ne peuvent en principe pas suggérer des modifications aux résolutions soumises à leur vote.
Les statuts doivent précisément fixer les règles d’envoi et de retour de votes.
L’absence de réponse sera considérée comme une abstention.
Actes sous seing privé
L’acte sous seing privé n’est rien d’autre qu’un acte signé par tous les associés. Il est important que les statuts prévoient un tel mode de prise de décision, très pratique lorsque les associés veulent rapidement prendre une décision à l’unanimité sans s’encombrer du formalisme de la tenue d’une assemblée physique ou d’une consultation écrite. Il leur suffit ainsi de rédiger un acte répertoriant toutes les décisions qu’ils prennent et de le signer. Une telle décision unanime des associés en SAS vaudra décision collective équivalente à une assemblée générale des associés.
Téléconférences ou visioconférences
Il est très utile de prévoir la possibilité de tenir les assemblées générales en téléconférences ou visioconférence. Dans ce cas, les statuts de SAS devront prévoir précisément comment ces assemblées sont tenues et quels sont les moyens de s’assurer de l’identité des associés participant à la réunion à distance.
Fixation de l’ordre du jour
Quel que soit le mode de prise de décisions, la fixation de l’ordre du jour de l’assemblée général est un point crucial car, en principe, il ne peut pas être fixé en cours de séance : les associés doivent (sauf décision unanime) en avoir été tenus informés par avance afin d’avoir le temps de réfléchir au sens de leur vote et de s’informer le cas échéant.
C’est aux statuts de SAS de déterminer qui décide de l’ordre du jour de l’assemblée générale. En principe, c’est l’auteur de la convocation (le plus souvent le président de la SAS) qui le fixe. Mais les statuts peuvent utilement prévoir que, sous réserve de respecter un certains délai, un ou plusieurs associés représentant un minimum de droits de vote (par exemple 5% du capital et des droits de vote), ont la possibilité d’ajouter des questions à l’ordre du jour.
Les statuts de SAS prévoient les règles de majorités applicables aux prises de décision.
En principe, chaque action donne droit à un droit de vote (sauf cas d’ actions de préférence à droit de vote renforcé ou sans droits de vote).
S’il existe des actions issues d’ apports en industrie , les statuts doivent expressément prévoir les conditions dans lesquels les associés concernés expriment leurs votes.
La fixation de telles règles dépendra le plus souvent du rapport de force entre associés.
Par exemple :
- Si la société comporte un associé majoritaire (ayant la majorité absolue) qui souhaite garder le contrôle absolu de la SAS, il sera préférable que les statuts prévoient que toutes les décisions sont prises à la majorité des voix.
- Si l’équilibre des pouvoirs est tel qu’une minorité d’associés souhaite avoir la minorité de blocage pour des décisions importantes, telles que les modifications statutaires, il sera utile de prévoir des modes de délibération de type assemblées générales ordinaires (avec prises de décisions à la majorité des voix) et assemblées générales extraordinaires (avec prises de décision à la majorité renforcée). Les statuts devront prévoir avec précision quels types de décisions relèvent de quelles formes d’assemblées.
Les statuts doivent également prévoir les règles de quorum applicables aux assemblées générales : à savoir le nombre minimum de voix requises, pour les associés présents ou représentés, pour que l’assemblée générale puisse valablement se tenir.
Les voix des associés représentés (c’est à dire ayant donné une procuration de vote) dont en principe prises en compte pour le calcul du quorum, sauf si les statuts imposent une présence effective pour certaines décisions importantes, ce qui est rare.
La loi impose l’unanimité des voix pour certaines décisions :
- les décisions comportant une augmentation des engagements des associés
- l’instauration ou la modifications des clauses statutaires relatives à l’inaliénabilité des actions, à l’agrément des cessions d’actions, l’exclusion d’un associés, le changement de contrôle d’un associé, etc.
- le changement de nationalité de la SAS (à savoir le transfert de son siège social à l’étranger )
Les statuts de SAS peuvent tout à fait prévoir des aménagement de droits de vote au bénéfice de certains associés ou groupe d’associés, ou des actions de préférence. Ceci se traduira par des votes renforcés, des droits de veto, des droit de vote applicables que pour certaines catégories de décisions, etc.
En toutes hypothèses, la rédaction des statuts de SAS est très importante : compte tenu du fait que la loi donne une grande liberté dans l’organisation et les pouvoirs de la collectivité des associés, la moindre ambiguïté peut s’avérer préjudiciable. Il est donc important d’avoir des statuts de SAS bien rédigés sur ces aspects.
Le pacte d’associés peut prévoir des clauses au titre desquelles les associés s’engagent “à voter en faveur de certaines décisions” soumises à la collectivité des associés. Il s’agit d’une convention de vote : en principe, de tels engagements sont sans valeur, car l’assemblée générale de la SAS est souveraine. Il conviendra d’utiliser, dans le pacte d’associés, des formules adéquates imposant aux parties au pacte une obligation de “meilleurs efforts” en ce sens.
Infographie : L’assemblée générale d’une SAS en bref
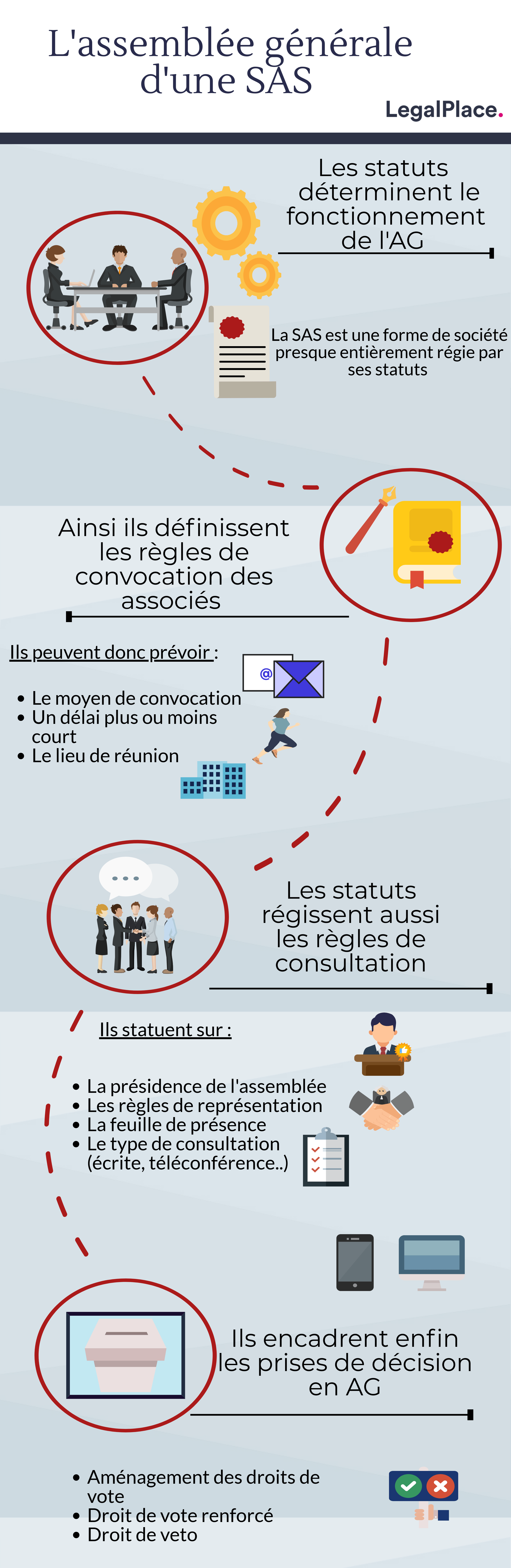
Samuel Goldstein
Samuel est co-fondateur de LegalPlace et responsable du contenu éditorial. L’ambition est de rendre accessible le savoir-faire juridique au plus grand nombre grâce à un contenu simple et de qualité. Samuel est diplômé de Supelec et de HEC Paris
Bonjour, directeur général associé 50/50 le président a pris seul la décision de modifier le mode de rémunération, lors de l’assemblée générale durant laquelle j’étais absent suite à un décès. j’ai prévenu mon associé de mon absence. malgré tout il a validé et acté sa décision. quels sont mes recours, comment contester ou invalider sa décision. cordialement
Samuel est co-fondateur de LegalPlace et responsable du contenu éditorial. L'ambition est de rendre accessible le savoir-faire juridique au plus grand nombre grâce à un contenu simple et de qualité. Samuel est diplômé de Supelec et de HEC Paris
Télécharger notre guide gratuit
Articles similaires
- suppress HtmlUnknownAnchorTarget Suppression du warning de l'IDE - Désactiver en attendant refonte menu Aller au menu
- suppress HtmlUnknownAnchorTarget Désactiver en attendant la refonte du menu Aller à la recherche
- Aller au contenu
- Aller en bas de la page
Deuxième séance du mardi 14 mai 2024
Présidence de mme yaël braun-pivet.
Mme la présidente
- M. Gabriel Attal, Premier ministre
- Mme Estelle Youssouffa
- M. Patrice Vergriete, ministre délégué chargé des transports
- M. André Chassaigne
- M. Arthur Delaporte
- M. Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur et des outre-mer
- M. Philippe Dunoyer
- Mme Mathilde Panot
- M. Bruno Millienne
- M. Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’industrie et de l’énergie
- M. Jean-Philippe Tanguy
- Mme Anne-Laure Blin
- M. Charles Rodwell
- Mme Joëlle Mélin
- M. Frédéric Valletoux, ministre délégué chargé de la santé et de la prévention
- Mme Pascale Martin
- M. Stéphane Séjourné, ministre de l’Europe et des affaires étrangères
- Mme Marie-Charlotte Garin
- Mme Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations
- M. Alexandre Vincendet
- M. Emmanuel Maquet
- M. Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
- M. Stéphane Mazars
- Mme Katiana Levavasseur
- M. Jean-Hugues Ratenon
- Mme Laetitia Saint-Paul
Suspension et reprise de la séance
3. Élection d’un juge suppléant à la Cour de justice de la République
- Amendement n o 101
- M. Nicolas Metzdorf, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
- Amendements n os 102 , 48 , 192 , 107 , 106 , 105 , 104 , 13 et 103
5. Élection d’un juge suppléant à la Cour de justice de la République (suite)
- Amendements n os 14, 15 , 108 , 112 et 109
- Mme Sophia Chikirou
- Amendement n o 111
- M. Charles Sitzenstuhl
- Article 1er (appelé par priorité - suite)
7. Élection d’un juge suppléant à la Cour de justice de la République (suite)
- Amendements n os 110 , 113 et 114
- M. Bastien Lachaud
- Amendements n os 16 , 49 , 213 , 96 , 218 , 120 , 119 , 118 , 117 , 17 , 116 , 39 , 50 , 214 et 121
9. Ordre du jour de la prochaine séance
- Ouvrir le sommaire
- Partager le compte rendu
- Accéder au document PDF du compte rendu
- Projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (Ouverture dans un nouvel onglet)
- Accéder au cahier bleu
- Partager l'intervention
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)
1. Hommage aux agents de l’administration pénitentiaire tués dans l’Eure
Ce matin, vers onze heures, au péage d’Incarville, dans l’Eure, près de Rouen, un convoi pénitentiaire a été victime d’une embuscade. (Mmes et MM. les députés et les membres du Gouvernement se lèvent.) Attaqués par une voiture-bélier, les fourgons ont essuyé des tirs à l’arme lourde, qui ont coûté la vie à deux agents de l’administration pénitentiaire. L’un d’eux laisse une femme et deux enfants, l’autre une femme enceinte de cinq mois. Trois autres agents, grièvement blessés, sont actuellement hospitalisés. En notre nom à tous, j’adresse notre soutien à tous les agents de l’administration pénitentiaire endeuillés par la mort de leurs collègues, ainsi qu’aux familles de ces derniers.
Les auteurs de cette attaque criminelle ne doivent pas rester impunis et je sais que tout est mis en œuvre pour les retrouver. Je salue l’action des forces de l’ordre, leur courage et leur réactivité. L’Assemblée nationale se tiendra toujours aux côtés de ceux qui servent la République et protègent nos concitoyens. C’est pourquoi, en mémoire des fonctionnaires assassinés dans l’exercice de leur mission et en solidarité avec leurs familles et leurs collègues, je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence. (Mmes et MM. les députés et les membres du Gouvernement observent une minute de silence.) La parole est à M. le Premier ministre.
M. Gabriel Attal , Premier ministre
Ce matin, dans l’Eure, deux agents de l’administration pénitentiaire sont morts en accomplissant leur devoir et trois autres ont été grièvement blessés. Ce matin, dans l’Eure, la République a été attaquée, l’ordre républicain a été pris pour cible, notre justice et le refus de l’impunité ont été frappés. À mon tour, au nom du Gouvernement, en notre nom à tous, de rendre hommage aux victimes. Notre peine est celle du pays tout entier, choqué par cette attaque d’une violence inouïe, par la brutalité et la lâcheté de ses auteurs. Notre pays est reconnaissant aux agents de l’administration pénitentiaire de leur engagement quotidien et ne reculera jamais devant les violences et les attaques. Il se tient uni, solidaire, derrière toutes celles et ceux qui se battent pour faire respecter le droit, la loi et la justice. Notre pays est déterminé à ce que la justice soit rendue. Mes pensées vont aux familles et aux proches des victimes. Je leur dis notre solidarité et notre soutien. Je pense à tous les agents de l’administration pénitentiaire qui escortent des détenus au quotidien, qui accomplissent chaque jour leur devoir dans les établissements, sur les routes, qui se disent que cela aurait pu être eux et dont la douleur est immense. Les Français savent ce que ces fonctionnaires accomplissent au quotidien. Nous serons à leurs côtés chaque jour pour veiller sur leur sécurité et pour que l’autorité soit respectée, pour que force aille toujours à la loi. Le ministre de la justice a convoqué ce matin une cellule de crise et s’est rendu auprès des collègues des victimes. La juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée s’est saisie de l’affaire. Tout sera mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ce crime abject. Le plan Épervier a été déclenché. Nous n’économiserons ni les efforts ni les moyens. Nous les traquerons, nous les trouverons et, je vous le dis, ils paieront. Nous le devons aux victimes, à leurs familles et à leurs proches, à tous les membres de l’administration pénitentiaire. Nous le devons aux Français. (Mmes et MM. les députés et les membres du Gouvernement se lèvent et applaudissent longuement.)
2. Questions au Gouvernement
L’ordre du jour appelle les questions au Gouvernement.
Desserte aérienne de Mayotte
La parole est à Mme Estelle Youssouffa.
Mme Estelle Youssouffa
Monsieur le Premier ministre, l’épidémie de choléra tue et progresse à Mayotte. L’île possède seulement cinq urgentistes pour une population réelle de 500 000 habitants : nous devrons survivre au refus de votre gouvernement de vacciner la population volontaire et de distribuer de l’eau en bouteille alors que les robinets sont à sec. C’est un scandale sanitaire et de la non-assistance à population en danger. Cette épidémie illustre le naufrage de l’État à Mayotte, mais nous, Mahoraises et Mahorais, sommes debout. Nous nous battons, nous sommes vigilants et nous voulons un avenir. Or celui-ci passe par la desserte aérienne de notre île et par la piste longue. Le ministre délégué chargé des transports a déclaré, en petit comité, que notre volcan sous-marin excluait la possibilité de construire la piste longue en Petite-Terre en raison d’un risque de submersion et de tsunami. Des risques naturels majeurs et imprévisibles, ainsi que les travaux, priveraient Mayotte de tout aéroport pendant dix-huit mois. Mayotte prend acte de vos arguments, mais quelle mise à l’abri prévoyez-vous pour la population de Petite-Terre, manifestement en danger ? L’État choisit Bouyouni en Grande-Terre pour construire un nouvel aéroport près du port de Longoni. Ce choix ouvre des perspectives économiques inédites et positionne Mayotte comme plateforme logistique du canal du Mozambique. Prévoyez-vous d’inscrire le budget du nouvel aéroport dans le futur projet de loi sur Mayotte ? À quelle date le premier coup de pioche aura-t-il lieu ? L’État nous dit que l’aéroport actuel sera inutilisable dès 2035, c’est-à-dire demain. Pas le temps de louvoyer pour laisser le dossier au prochain locataire de l’Élysée, comme c’est l’habitude depuis quarante ans ! Les Mahorais n’utiliseront jamais l’aéroport des Comores en attendant que Paris se décide à construire un aéroport pour désenclaver notre département. (Applaudissements sur les bancs du groupe LIOT. – M. Jean-Charles Larsonneur applaudit aussi.)
La parole est à M. le ministre délégué chargé des transports.
M. Patrice Vergriete , ministre délégué chargé des transports
Je partage votre constat selon lequel la desserte aérienne de Mayotte est un enjeu majeur et garantit la continuité territoriale de l’archipel.
M. Pierre Cordier
Agis, alors !
M. Patrice Vergriete , ministre délégué
C’est la raison pour laquelle, depuis l’engagement du Président de la République en 2019, le Gouvernement travaille d’arrache-pied pour renforcer la desserte aérienne de l’île…
Ça fait cinq ans !
…et améliorer l’infrastructure. Les premières études, que j’ai présentées la semaine dernière aux élus – vous étiez présente, madame Youssouffa – avec Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des outre-mer, montrent, vous l’avez dit, que l’aéroport actuel est exposé à un risque géologique majeur, lié à la présence d’un volcan sous-marin, dont personne ne pouvait anticiper les répercussions. Cette constatation, indépendante de toute volonté politique, exclut la construction d’une piste longue au sein de l’actuel aéroport pour améliorer la desserte de l’île. La construction d’un nouvel aéroport dans un site alternatif plus sûr est l’option la plus crédible, mais nécessite des études complémentaires. Il ne s’agit donc ni d’un recul ni d’un renoncement, mais d’un projet nouveau, réorienté, que nous devons élaborer ensemble, en toute transparence, pour doter les Mahorais d’une infrastructure à la hauteur des enjeux. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité que les conclusions des premières études soient rendues publiques la semaine dernière. Une fois l’ensemble des études achevées, à la rentrée, nous les présenterons ensemble aux Mahorais et nous tiendrons notre engagement de lancer le projet de construction d’un nouvel aéroport sur un site plus sûr.
Situation en Nouvelle-Calédonie
La parole est à M. André Chassaigne.
M. André Chassaigne
Monsieur le Premier ministre, en Kanaky Nouvelle-Calédonie, la situation était prévisible et vous ne l’avez pas empêchée. Trente ans après l’entente entre deux hommes pour une paix entre deux camps, le dialogue est rompu. L’État médiateur est devenu juge et partie alors que la situation appelle, de la part du Gouvernement, de la sagesse, de la tempérance, de la lucidité. Poursuivre l’examen du projet de loi constitutionnelle de dégel du corps électoral, c’est choisir l’embrasement. L’apaisement ne reviendra pas grâce à l’envoi d’escadrons de gendarmerie supplémentaires, ni grâce à une surenchère de paroles et de polémiques dans cet hémicycle. L’apaisement ne peut passer que par le retrait du projet de loi constitutionnelle (Applaudissements sur les bancs du groupe GDR-NUPES et sur plusieurs bancs des groupes LFI-NUPES, SOC et Écolo-NUPES. – M. Benjamin Saint-Huile applaudit aussi) et par l’envoi, sur place, d’un groupe de contact pour organiser le retour au dialogue. C’est la seule voie pour obtenir un accord global dans l’esprit des accords de Matignon et de Nouméa. Il ne peut en être autrement. Vous devez garder à l’esprit que la paix s’est construite, avant vous, grâce à un consensus, à des compromis, à des sacrifices. Ne vous inscrivez pas dans un processus de colonisation qui consiste à mettre en minorité un peuple sur sa propre terre. (Applaudissements sur les bancs du groupe GDR-NUPES.) Je vous en conjure, soyez à la hauteur de ce moment historique ! Le Président de la République lui-même a ouvert une possibilité de négociation en repoussant la convocation du Congrès à Versailles. Comme nous, comme le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, trois anciens Premiers ministres vous exhortent à sortir de l’impasse. Nous vous appelons solennellement à reprendre le dossier en main, à retirer le texte et à rétablir le dialogue pour un accord global. (Applaudissements sur les bancs du groupe GDR-NUPES et sur quelques bancs des groupes LFI-NUPES, SOC et Écolo-NUPES. – Mme Francesca Pasquini et M. Benjamin Saint-Huile applaudissent aussi.)
La parole est à M. le Premier ministre.
Avant toute chose, je veux rendre hommage aux policiers et aux gendarmes qui ont fait face ces dernières heures à des violences d’une intensité rare en Nouvelle-Calédonie, à leur professionnalisme et à leur sang-froid face à des incendies, à des pillages, à des tirs qui les visaient. (Mmes et MM. les députés se lèvent et applaudissent.) Selon un premier bilan, cinquante-quatre d’entre eux ont été blessés. Leur engagement pour permettre le maintien de l’ordre et protéger la vie humaine force le respect. En Nouvelle-Calédonie, on connaît le lourd tribut de la violence, on sait qu’elle ne résout rien, qu’elle ne mène à rien. Je répète ce que j’ai clairement affirmé ce matin : les violences ne sont ni justifiables ni tolérables. La violence n’a jamais forcé la main de personne, elle n’a jamais permis le dialogue. Or c’est par le dialogue, et par le dialogue seulement, que nous trouverons une solution politique globale pour la Nouvelle-Calédonie. Le retour au calme est notre priorité. Ainsi que l’a indiqué le ministre de l’intérieur, quatre escadrons de gendarmerie supplémentaires arriveront dans les prochaines heures sur place et le haut-commissaire de la République a décidé d’un couvre-feu pour la nuit. La question qui m’est posée porte sur l’examen en cours à l’Assemblée du projet de loi constitutionnelle modifiant le corps électoral pour les élections en Nouvelle-Calédonie. Des personnes qui sont nées en Nouvelle-Calédonie ou qui y résident depuis de nombreuses années, qui y ont leur vie personnelle et leurs activités professionnelles, qui y payent des impôts sont privées du droit de vote aux élections provinciales, c’est-à-dire à un scrutin local. Le dégel du corps électoral est donc un enjeu démocratique incontournable et demandé par le Conseil d’État. Il s’agit de permettre la tenue des prochaines élections provinciales et d’assurer la représentativité des élus, sans remettre en cause les équilibres fondamentaux de l’accord de Nouméa. Au-delà, notre unique volonté est de trouver, avec les indépendantistes et avec les non-indépendantistes, un accord politique global et le plus large possible qui permette d’aller de l’avant et d’écrire le futur de la Nouvelle-Calédonie. J’y insiste : cet accord passera par le dialogue avec toutes les parties prenantes. C’est pourquoi notre main est toujours tendue. C’est pourquoi le Président de la République, vous l’avez rappelé, a proposé d’ouvrir de nouvelles discussions entre les responsables politiques calédoniens et le Gouvernement. C’est pourquoi le Congrès ne sera pas convoqué immédiatement à l’issue des débats à l’Assemblée nationale.
M. Marc Le Fur
Il y a un vote, d’abord !
M. Jean-Victor Castor
Retirez le texte !
Dans l’intervalle, j’invite les responsables politiques calédoniens à saisir cette main tendue et à venir discuter à Paris dans les prochaines semaines.
M. Olivier Marleix
Quelle reculade !
L’important, c’est l’apaisement. L’important, c’est le dialogue. L’important, c’est la construction d’une solution politique commune et globale. L’important, c’est de trouver les moyens de faire respecter le choix souverain de la Nouvelle-Calédonie de rester dans la République et de définir le bon équilibre pour l’avenir du Caillou et de la jeunesse calédonienne, tout en respectant le droit à l’autodétermination. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RE.)
M. Jean-Paul Lecoq
Vous êtes responsable de la situation !
M. Fabien Roussel
La violence, c’est vous !
La parole est à M. Arthur Delaporte.
M. Arthur Delaporte
Deux surveillants pénitentiaires ont été assassinés dans l’exercice de leur métier et un troisième est grièvement blessé. Le groupe Socialistes exprime sa profonde solidarité envers les familles endeuillées et les agents pénitentiaire, trop souvent déconsidérés. (Applaudissements sur les bancs du groupe SOC et sur de nombreux autres bancs.) La Nouvelle-Calédonie a connu une nouvelle nuit de violences. La gravité de ce qui s’y passe nous inquiète profondément. La représentation nationale doit faire preuve de la plus grande retenue et d’un sens aigu des responsabilités. Le groupe Socialistes condamne fermement toutes les violences et exactions. Il adresse sa solidarité aux victimes comme aux fonctionnaires blessés. Nous appelons solennellement au retour au calme et à la reprise du dialogue. Car chaque minute qui passe nous éloigne de ce qui a fait la force depuis trente-cinq ans d’un processus partagé de décolonisation, incarné par des gouvernements successifs : celui de Michel Rocard pour les accords de Matignon, celui de Lionel Jospin pour l’accord de Nouméa et, dernièrement, celui d’Édouard Philippe. (Applaudissements sur les bancs du groupe SOC. – M. Stéphane Peu applaudit aussi.) Leur méthode était celle du dialogue et des consensus. Là est la solution pour un retour au calme. Monsieur le Premier ministre, nous vous le demandons une nouvelle fois : suspendez l’examen de cette réforme constitutionnelle, car dire que le Congrès ne sera pas convoqué dans les prochaines semaines ne peut être la seule solution (Applaudissements sur les bancs des groupes SOC, LFI-NUPES et Écolo-NUPES) ; renouez les fils du dialogue ; ressaisissez Matignon de son rôle historique, de votre rôle : être un acteur impartial du compromis ! L’accord de Nouméa arrive à son terme. La responsabilité d’obtenir un accord global est désormais entre vos mains. Faites un geste, donnez un calendrier clair, renouez avec la construction d’un destin commun ! Il y va de la paix civile. (Applaudissements sur les bancs du groupe SOC. – M. André Chassaigne applaudit également.)
La parole est à M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
M. Gérald Darmanin , ministre de l’intérieur et des outre-mer
Depuis hier, l’Assemblée étudie un projet de loi constitutionnelle qui a été adopté par le Sénat et qui fait suite au vote par les deux chambres de la loi organique reportant les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie. Ces élections locales, initialement prévues pour le mois de mai, auront lieu au plus tôt le 15 décembre prochain, voire plus tard si nous devions trouver un accord. Le projet de loi prévoit le dégel du corps électoral pour les élections provinciales, lequel constitue une nécessité démocratique et juridique. (M. Arthur Delaporte fait un geste de dénégation.) En effet, le Conseil d’État a explicitement alerté sur le fait que ces élections courraient un grand risque d’annulation si nous les convoquions, sur la base d’un corps électoral restreint, aux personnes nées ou arrivées en Nouvelle-Calédonie avant 1998. Cela intervient à un moment où les provinces ont un poids particulier puisque c’est le gouvernement autonome qui gère les questions économiques, marquées par la grave crise actuelle du nickel. Par ailleurs, depuis trois ans, le Gouvernement ne cesse de tendre la main à l’ensemble des acteurs. Il a multiplié les réunions pour tenter de trouver un accord global, ce qui malheureusement n’a pu être le cas jusqu’à présent. J’espère que, plus tard dans la journée, nous aurons l’occasion de discuter de l’article 2 du projet de loi constitutionnelle, que vous n’évoquez jamais. Il prévoit que, si un accord global incluant les modalités de l’autodétermination était trouvé, les changements constitutionnels découlant de la modernisation des institutions de la Nouvelle-Calédonie s’en inspireraient. En attendant, prenez vos responsabilités et rétablissons la démocratie en Nouvelle-Calédonie pour tous les Calédoniens ! (Applaudissements sur les bancs du groupe RE et sur quelques bancs des groupes Dem et HOR.)
Je regrette que ce soit le ministre de l’intérieur qui m’ait répondu et non le Premier ministre, aux abonnés absents sur ce dossier majeur alors que, depuis trente-cinq ans, c’est le locataire de Matignon qui est l’artisan patient du dialogue. Monsieur le Premier ministre, ressaisissez-vous ! Votre responsabilité demeure essentielle. Suspendez cette réforme, car c’est elle qui a provoqué la situation que nous connaissons depuis trois jours et qui nous inquiète !
Mme Marie-Christine Dalloz
C’est vous qui l’entretenez !
La démocratie passe aussi par le respect du consensus et d’une méthode. Un accord ne se négocie pas sous la pression.
La parole est à M. Philippe Dunoyer.
M. Philippe Dunoyer
Depuis deux jours, dans le Grand Nouméa, plusieurs dizaines de commerces ou d’entreprises ont été pillés ou incendiés. Plusieurs centaines de Calédoniens ont été insultés, menacés ou agressés jusque chez eux. Plus de quatre-vingts policiers et gendarmes ayant été blessés, je veux rendre hommage au courage et à l’engagement de nos forces de l’ordre. (Mmes et MM. les députés du groupe RE se lèvent et applaudissent. – Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes Dem, HOR et sur quelques bancs des groupes LFI-NUPES et GDR-NUPES.) Un couvre-feu a été instauré ; la vente d’alcool et le transport d’armes ont été interdits, alors qu’en Nouvelle-Calédonie, un foyer sur quatre possède plusieurs armes à feu. Toutes les autorités, indépendantistes ou non indépendantistes, ont appelé à un retour au calme, pour l’instant sans succès. En ces instants dramatiques qui nous renvoient à des heures sombres qu’aucun habitant du Caillou ne pensait revivre, mes pensées vont vers les Calédoniens de toutes ethnies, qui sont plongés dans l’angoisse et dans l’incertitude. Mes pensées vont aussi vers ces chefs d’entreprise et vers ces 1 000 salariés, au moins, qui ont tout perdu. Elles vont enfin vers les forces de l’ordre et les pompiers, qui font front dans un contexte très difficile. Mes questions sont les suivantes. La priorité est de rétablir l’ordre. Il faut à tout prix éviter que des citoyens s’exposent pour protéger leurs familles, leurs entreprises ou leurs habitations. Quand arriveront les renforts tant attendus pour mettre fin à la guérilla urbaine ? Ensuite, comment l’État peut-il soutenir ces salariés et ces entreprises qui se retrouvent dans un dénuement extrême, sans garantie d’assurance ? Enfin, la seule sortie possible passe par le retour du consensus et par la conclusion d’un accord global. C’est la voie vers laquelle le Président de la République nous a invités à aller en priant, le week-end dernier, tous les élus calédoniens à venir à la table des négociations. Comment comptez-vous, monsieur le Premier ministre, organiser ce dialogue, et selon quel calendrier ? (Applaudissements sur les bancs du groupe RE. – Mme Estelle Folest, MM. Arthur Delaporte et Jérôme Guedj applaudissent également . )
Je veux d’abord féliciter le député Dunoyer pour la qualité de ses interventions depuis hier et pour son calme au moment où ses proches sont peut-être menacés par ceux qui essayent de terroriser les représentants de la nation. (Mmes et MM. les députés des groupes RE, HOR et Dem se lèvent pour applaudir. – Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LR, ainsi que sur quelques bancs du groupe SOC.) Par ailleurs, je condamne tous ceux qui s’en sont pris au député Metzdorf, lui interdisant par un communiqué de presse inacceptable de revenir sur sa propre île et menaçant sa famille. De même, j’exprime mon soutien à la présidente Backès, dont le père de 80 ans a dû, la nuit dernière, être sorti d’une maison en feu par le Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN). Mettre ainsi la pression sur des élus ne peut être considéré comme une méthode politique. (Mmes et MM. les députés des groupes RE, HOR et Dem, ainsi que M. José Beaurain, se lèvent pour applaudir. – Applaudissements sur les bancs du groupe LR.) Dès ce matin, à la demande du Président de la République et du Premier ministre, des renforts sont partis vers la Nouvelle-Calédonie, soit de territoires ultramarins voisins soit de l’Hexagone. Cet après-midi, grâce au ministre des armées, un avion sera affrété pour conduire quatre escadrons supplémentaires en Nouvelle-Calédonie et y rétablir l’ordre. Malgré les quatre-vingts interpellations effectuées, plus de soixante-dix policiers ou gendarmes ont été blessés. Des membres de familles de gendarmes ont été évacués après avoir été la cible de tirs, sans pourtant porter l’uniforme de la République par ailleurs scandaleusement outragé. Quatre-vingts chefs d’entreprise ont vu leur outil de production brûlé ou détruit. Le Premier ministre m’a demandé de travailler avec les ministères des outre-mer et de l’économie et des finances à leur accompagnement. Même s’il s’agit d’une compétence locale, l’État français, comme toujours, sera au rendez-vous. Enfin, nous souhaitons le consensus. Après le vote du texte en débat, dès ce soir j’espère, le Président de la République et le Premier ministre écriront à toutes les parties calédoniennes pour les inviter à Paris afin de discuter, avec le chef du Gouvernement et moi-même, d’un accord global pacifique qui, j’en suis sûr, fera honneur à la France et à la Nouvelle-Calédonie. (Applaudissements sur les bancs du groupe RE. – Mme Estelle Folest applaudit également.)
La parole est à Mme Mathilde Panot.
Mme Mathilde Panot
Depuis dimanche, la Nouvelle-Calédonie s’embrase : incendies, barrages, tirs à balles réelles contre des gendarmes ou encore formation de milices cagoulées et armées qui laissent craindre une spirale de la violence irréversible. Nous saluons l’appel du gouvernement calédonien à la raison et au retour du dialogue. La paix civile perdure depuis des décennies grâce aux accords de Matignon-Oudinot puis grâce à celui de Nouméa. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NUPES.) Cette paix est précieuse et fragile. Car c’est sur les vieilles cicatrices que s’ouvrent de nouvelles blessures. Les violences actuelles nous ramènent quarante ans en arrière. Personne ne veut revivre ce qui était pudiquement appelé « les événements » mais qui était en fait une guerre civile. L’esprit de la poignée de main entre Tjibaou et Lafleur doit être préservé. (Mêmes mouvements.) Depuis qu’Édouard Philippe ne gère plus le dossier, les mauvaises décisions s’accumulent : maintien coûte que coûte du troisième référendum en plein deuil coutumier kanak, ce qui en a délégitimé le résultat et a discrédité la parole de l’État ; relégation du dossier du Premier ministre au ministre des outre-mer puis de l’intérieur ; dépôt unilatéral d’un projet de loi constitutionnelle. Désormais, c’est à vous, monsieur le Premier ministre, qu’en incombe la responsabilité. Il existe un fait colonial indéniable en Nouvelle-Calédonie. L’existence de deux peuples a été actée dès 1988 par le vote du peuple français au référendum. Or, dans une situation coloniale, la répression mène toujours à plus de répression. Rien n’était imprévisible, mais le pire peut encore être évité. Demain, la Nouvelle-Calédonie ne doit pas, après un vote passé en force, se réveiller à feu et à sang. Personne ne veut de morts en Calédonie. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NUPES.) Avec ce projet de loi, l’esprit des accords de Nouméa est piétiné. Quelle qu’en soit la forme, la voie de l’émancipation de la Nouvelle-Calédonie est irréversible. Monsieur le Premier ministre, préservez la paix civile, retirez ce projet de loi constitutionnelle, envoyez une mission de dialogue sur le territoire afin d’aboutir, comme en 1988, comme en 1998, à un accord global consensuel pour construire un destin commun aux citoyens calédoniens ! (Les députés du groupe LFI-NUPES se lèvent pour applaudir. – Applaudissements sur les bancs du groupe Écolo-NUPES. – Mme Elsa Faucillon applaudit également.)
Constater les violences, comme vous l’avez fait, c’est bien ; les dénoncer, c’est mieux. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RE. – Protestations sur les bancs du groupe LFI-NUPES.)
Mme Sophia Chikirou
Vous êtes les incendiaires !
Pas un mot pour dénoncer les violences et les agressions ! Pas un mot – contrairement à tous les orateurs précédents – pour soutenir les forces de l’ordre mobilisées sur le terrain, qui interviennent avec courage. À vous écouter, à observer certains comportements et certaines prises de position, on se demande si c’est véritablement l’apaisement que vous recherchez en Nouvelle-Calédonie. (Mêmes mouvements.)
Mme Anne Stambach-Terrenoir
Ce n’est pas possible…
J’ai eu l’occasion de le dire : je crois profondément que c’est le dialogue qui nous permettra d’apaiser la situation. Ce dialogue, nous en créons les conditions et nous le pratiquons depuis le début, par la voix du ministre de l’intérieur et des outre-mer. Notre main est toujours tendue pour le mener. C’est notre souhait pour trouver une solution politique globale : non une solution qui conviendrait seulement à certains, mais une solution pour toutes et pour tous.
Retirez le projet de loi !
C’est pourquoi le Président de la République a annoncé qu’il invitait l’ensemble des acteurs et des parties prenantes à une rencontre. C’est pourquoi le Congrès ne sera pas réuni immédiatement après l’examen du texte, qui doit aller à son terme. C’est pourquoi nous proposons aux dirigeants calédoniens de les réunir pour discuter et bâtir ensemble l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. Nous faisons le choix du dialogue et nous le ferons toujours. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RE.)
Vous avez allumé un incendie que vous ne saurez pas éteindre !
Politique énergétique
La parole est à M. Bruno Millienne.
M. Bruno Millienne
Avant toute chose, au nom du groupe Démocrate, je veux témoigner de notre soutien aux familles et aux collègues des agents pénitentiaires lâchement assassinés ce matin. (Applaudissements sur les bancs des groupes Dem et RE.) Nous partageons leur peine. Monsieur le ministre délégué chargé de l’industrie et de l’énergie, hier, à l’occasion du sommet Choose France, 15 milliards d’euros d’investissements étrangers en France ont été annoncés, avec à la clé des milliers d’emplois dans nos territoires. Cela conforte la place de la France comme pays le plus attractif d’Europe pour les investisseurs étrangers, pour la cinquième année consécutive. Nous pouvons tous nous en réjouir. Loin des discours défaitistes que l’on entend trop sur ces bancs, notre pays regorge de ressources pour expliquer ce succès. L’une d’elles, peut-être la principale, est l’accès à une énergie nucléaire fiable, pilotable, abordable et décarbonée. Le nucléaire est un enjeu majeur de notre souveraineté, nationale comme européenne.
M. Fabien Di Filippo
C’est pour ça que vous avez voulu fermer quatorze réacteurs ?
J’insiste sur ce point. Alors que l’extrême droite ne cesse de changer d’avis sur le sujet – nous l’avons encore vu récemment (Protestations sur les bancs du groupe RN) –, la gauche se perd dans des circonvolutions électoralistes, ne sachant plus si elle doit se raccrocher à la raison ou à l’opposition dogmatique de ses composantes les plus extrêmes. Je veux le dire à ceux qui nous regardent : le bulletin que vous mettrez dans l’urne le 9 juin, c’est aussi un bulletin pour ou contre le nucléaire, pour ou contre notre indépendance énergétique, pour ou contre la soumission au gaz russe – c’est important de le rappeler. Notre majorité met tout en œuvre pour renforcer cette filière d’excellence française, en cohérence avec l’indispensable développement des énergies renouvelables, deuxième jambe de notre stratégie énergétique pour la sortie du carbone. Les textes majeurs adoptés depuis le début de cette législature en sont une preuve irréfutable.
M. Laurent Jacobelli
C’est Pinocchio ou Tartuffe qui parle ?
Le démarrage du réacteur de type EPR de Flamanville est une nouvelle étape qui en appelle de nombreuses autres. C’est sur ces prochaines étapes que je veux vous interroger, monsieur le ministre délégué. Des engagements forts ont été pris ; je souhaiterais que vous indiquiez à la représentation nationale quels moyens sont engagés pour les tenir.
La parole est à M. le ministre délégué chargé de l’industrie et de l’énergie.
M. Roland Lescure , ministre délégué chargé de l’industrie et de l’énergie
Merci pour votre question et, surtout, pour votre engagement sans faille en faveur de cette grande cause nationale, celle de la souveraineté énergétique décarbonée.
Mme Julie Laernoes
Avec l’uranium russe ! C’est ça, la souveraineté ?
M. Roland Lescure , ministre délégué
Cette souveraineté, le Président de la République l’a dit dès son discours de Belfort début 2022, reposera très largement sur la relance du nucléaire. Cette relance se matérialise par le déplacement du Président de la République qui ira saluer le chargement de combustible pour l’EPR de Flamanville. La mise en service de ce réacteur, que nous attendons depuis longtemps, peut-être trop longtemps – dix-sept ans au total –, sonnera la relance du nucléaire qui sera synonyme d’autant d’investissements à venir. Six EPR 2 ont été annoncés ; leur dessin et leur fonctionnement étant plus simples, ils seront sans doute efficaces et opérationnels plus vite. Leur construction permettra d’augmenter substantiellement la capacité de la France à produire de l’électricité décarbonée.
On n’en croit pas un mot : vous disiez l’inverse il y a dix ans !
Quand on interroge un investisseur international qui souhaite investir en Europe, on constate qu’il choisit la France parce qu’elle lui garantit de l’électricité décarbonée et bon marché. (Rumeurs sur les bancs du groupe RN.) Si nous souhaitons relancer la politique industrielle française et faire de la France le point d’entrée privilégié des investisseurs internationaux en Europe, il faut le faire par le nucléaire. Il faut investir dans les EPR, mais également dans l’ensemble de la filière : le traitement et le recyclage des déchets – nous avons annoncé le prolongement de l’usine Orano et la construction d’une nouvelle usine ; l’organisation de la filière, pour que les talents soient au rendez-vous – il faut former et recruter 150 000 jeunes dans les dix ans qui viennent. Nous nous sommes organisés, nous mettons les moyens et nous serons à ce rendez-vous stratégique pour l’énergie et pour l’industrie françaises.
Politique industrielle
La parole est à M. Jean-Philippe Tanguy.
M. Jean-Philippe Tanguy
Ma question s’adresse à M. le Premier ministre. « Pour les investisseurs [étrangers], conquérir la France, c’est conquérir l’Europe » : cette déclaration du ministre délégué chargé de l’industrie et de l’énergie, Roland Lescure, est si consternante que j’ai cru à une manipulation. Pourtant non, ce n’était pas un lapsus mais un aveu révélateur. Ce gouvernement est fier d’aider nos adversaires économiques à conquérir l’économie française et, ce faisant, le marché européen que vous prétendez défendre. Nous apprenons d’ailleurs aujourd’hui que M. Macron soutient, en anglais, le rachat d’une grande banque française par une concurrente européenne.
Quelle honte !
En ces temps de guerre économique, il y a les nations qui se protègent pour mieux partir à la conquête du monde, et il y a vous, la Macronie, qui encouragez le monde à conquérir la France. En 2001, l’avoir extérieur de notre pays, à savoir la différence entre ce que les Français possèdent à l’étranger et ce que les étrangers détiennent chez nous, était de 40 milliards d’euros. Ce déficit a été multiplié par quinze et aujourd’hui à 630 milliards d’euros.
Mme Laure Lavalette
La France possède pourtant l’une des épargnes les plus abondantes du monde. Qu’avez-vous fait des 6 000 milliards d’euros pour valoriser notre économie tout en enrichissant les épargnants ? Absolument rien ! (Protestations sur les bancs du groupe RE.) Conçue avec le soutien des cabinets de conseil que vous avez grassement payés avec l’argent des Français, votre communication sur l’attractivité de la France n’est qu’un énième mensonge. Que l’on compte en emplois créés ou en argent investi, la France n’a jamais été l’économie la plus attractive depuis sept ans. Pire, c’est l’Europe entière qui décroche, avec 6 % des investissements mondiaux contre 17 % pour les États-Unis et autant pour l’Asie. Un investissement étranger en France n’est ni bon ni mauvais en lui-même. S’il conduit à des transferts de technologie et de savoir-faire en France, c’est un atout ; s’il revient à piller des brevets français, à voler des parts de marché ou à étouffer des filières naissantes, alors c’est de l’incompétence ou une trahison – en l’occurrence, les deux. Quand allez-vous cesser de vendre la France pour cacher votre échec ? (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)
Un grand banquier central américain avait l’habitude de dire : « Si vous avez compris quoi que ce soit à ce que j’ai dit, c’est que je me suis mal exprimé. » Vous avez dit tout et son contraire ! (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes RE et Dem.) Vous montrez une fois de plus que vous disputez des batailles d’hier et d’avant-hier, et que vous les perdez toutes, l’une après l’autre. Vous étiez contre l’Union européenne ; vous avez perdu cette bataille. Vous étiez contre l’euro ; vous avez perdu. (Protestations sur les bancs du groupe RN.) Vous étiez contre le marché européen de l’électricité ; vous avez également perdu.
M. Thomas Ménagé
C’est vous qui avez tout perdu !
Vous êtes désormais contre la voiture électrique ; vous êtes en train de perdre cette bataille, et les 20 000 salariés de Dunkerque auxquels nous proposons un avenir vous en seront reconnaissants. Maintenant, vous perdez la bataille de l’attractivité de la France. Ce matin, monsieur Tanguy, pendant que vous rédigiez votre question, j’étais dans la banlieue de Blois, dans une entreprise qui fabrique des produits pharmaceutiques. (Exclamations sur les bancs du groupe RN.)
M. Julien Odoul
Parlons de la pénurie de médicaments !
C’est un industriel italien, présent en France depuis trente ans, qui a investi dans l’entreprise plus de 160 millions d’euros et qui va créer cent emplois. Si vous étiez au pouvoir, cela n’arriverait pas car vous n’avez aucune crédibilité. Les Italiens, les Américains, les Chinois qui, aujourd’hui, choisissent la France, la quitteraient. Vous n’avez rien compris au commerce international. (Rires sur les bancs du groupe RN.)
Vous, c’est le pire déficit commercial de l’histoire !
Vous pensez que fermer les portes suffit à régler les problèmes. Vous n’avez rien compris aux investissements internationaux. Vous ne souhaitez pas que la France réussisse. Vous êtes le parti de la défaite – et la défaite, vous l’aurez ! (Applaudissements sur les bancs des groupes RE, Dem et HOR.)
Monsieur le ministre délégué, si seulement vous vous contentiez d’être aussi ringard que votre faille temporelle des années 1990, mais vous êtes incompétent : déficit extérieur, déficit des… déficit de… (Rires et exclamations sur les bancs du Gouvernement et du groupe RE.)
M. Rémy Rebeyrotte
Silence pour la France !
Déficit de l’avoir extérieur, déficit du marché public, voilà votre bilan ! (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)
Violences contre les forces de l’ordre
La parole est à Mme Anne-Laure Blin.
Mme Anne-Laure Blin
Monsieur le Premier ministre, une fois de plus, notre pays est choqué par la violence la plus radicale qui a coûté la vie, il y a quelques heures, à deux agents de l’administration pénitentiaire dans l’exercice de leur mission. Au nom de mes collègues du groupe Les Républicains, je veux dire à leurs familles, à leurs épouses, à leurs enfants qui ont perdu leur père, à leurs collègues, notre compassion, notre vive émotion et notre colère. (Applaudissements sur les bancs des groupes LR, RE, Dem et HOR ainsi que sur quelques bancs des groupes RN et LFI-NUPES.) Ces images d’hommes lourdement armés, attaquant le fourgon, ont de quoi nous indigner. Cela s’est passé à 100 kilomètres de Paris, à quelques semaines des Jeux olympiques. La France est-elle devenue ce far west où l’on tire sur nos forces de l’ordre, où l’on voit des scènes de guerre sur nos routes de campagne, où l’on abat de sang-froid des fonctionnaires ? Ce drame nous rappelle les 30 000 faits de violence commis, en France, chaque année, contre les forces de l’ordre. Non seulement ce chiffre a doublé depuis vingt ans mais la violence, de plus en plus barbare, peut désormais toucher des Français de tous les âges, partout, tout le temps. Évidemment, vous nous répondrez que vous n’y êtes pour rien. Nous le savons, les Français le savent : vous n’êtes jamais responsables de rien. Monsieur le Premier ministre, aucun autre parti politique depuis quarante ans n’aura gouverné la France aussi longtemps que le vôtre ; et pourtant vous fuyez toujours vos responsabilités. Il est plus qu’urgent et vital que l’autorité ne soit plus un slogan mais une réalité. Les Français exigent une rupture, nous sommes nombreux dans cet hémicycle à vouloir des lois d’autorité et de fermeté, mais cela suppose une chose : que vous arrêtiez de vous payer de mots, que vous arrêtiez de faire semblant et que vous passiez aux actes. Les Français attendent justice. (Applaudissements sur les bancs du groupe LR.)
J’ai déjà eu l’occasion de rendre hommage à la mémoire des agents de l’administration pénitentiaire qui ont été lâchement assassinés aujourd’hui. Mes pensées vont également à leurs collègues blessés. Vous abordez la question de l’autorité et du respect de l’autorité dans notre pays. C’est un sujet qui, vous le savez, me mobilise, tout comme l’ensemble du Gouvernement. Dès ma déclaration de politique générale, j’ai fait des annonces et indiqué des perspectives dans ce domaine. Il y a quelques semaines, m’exprimant à Viry-Châtillon, j’ai précisé les mesures que nous entendions prendre et le calendrier de leur application. Qu’est-ce qui a déjà été mis en œuvre depuis ma déclaration de politique générale et ce discours à Viry-Châtillon ? L’engagement que j’avais pris à la fois sur des sanctions plus rapides et sur la possibilité d’avoir un équivalent des travaux d’intérêt général (TIG) pour les moins de 16 ans a été tenu :…
On parle de narcotrafiquants équipés d’armes de guerre !
…le garde des sceaux a pris une circulaire pénale qui permet la mise en œuvre de ces mesures d’intérêt éducatif pour les moins de 16 ans. Je me suis engagé à ce que le non-respect de la laïcité dans le cadre d’une agression soit le plus systématiquement possible retenu comme une circonstance aggravante. Là aussi, le garde des sceaux a pris une circulaire pénale : de la même manière qu’agresser quelqu’un du fait de sa religion constitue une circonstance aggravante, le faire à cause de son absence de religion ou parce qu’il ne suit pas certains préceptes religieux devra toujours en être une aussi. J’ai ensuite annoncé plusieurs mesures concernant l’école de la République : dès la rentrée prochaine, elles donneront enfin la possibilité de prendre de véritables sanctions dès l’école primaire pour répondre au refus de l’autorité et aux contestations que les enseignants constatent dans les classes, dès le CE2, le CM1 ou le CM2. (Exclamations sur les bancs du groupe LFI-NUPES.) Or, je le crois profondément, le respect de l’autorité se construit dès le plus jeune âge.
Quel rapport ? Quelqu’un lui fait des fiches, quand même ?
Madame la députée m’interrogeait plus largement sur l’autorité dans notre pays : je crois que la respecter se construit dès le plus jeune âge, dès l’école de la République. C’est un autre sujet que celui que j’ai abordé tout à l’heure.
Vous voulez parler du fond ? Des trafiquants plus lourdement armés que les policiers ?
Deuxièmement, concernant la justice des mineurs, puisqu’à côté de la prévention, il nous faut des sanctions beaucoup plus claires et beaucoup plus fermes, j’ai annoncé plusieurs mesures pénales : composition pénale pour les mineurs, capacité à retenir davantage le manquement à l’obligation parentale contre les deux parents, sanction supplémentaire en cas d’un tel manquement. J’ai également ouvert la discussion avec les groupes parlementaires – j’en ai déjà rencontré plusieurs et j’en recevrai d’autres très prochainement – à propos de l’atténuation de l’excuse de minorité et de la création d’une procédure de comparution immédiate pour les mineurs…
Un coup de règle sur les doigts peut-être ?
…qui n’existe pas. Je suis prêt à avancer sans tabou sur tous ces sujets. Parce que le respect de l’autorité s’acquiert dès le plus jeune âge, c’est dès le plus jeune âge qu’on doit apprendre que l’uniforme se respecte, que les hommes et les femmes dépositaires de l’autorité se respectent, que la loi et les règles se respectent, et que dans le cas contraire, la loi est là pour vous sanctionner. (Applaudissements sur les bancs du groupe RE et sur quelques bancs du groupe Dem.)
Tu as tiré au bazooka ? Deux heures de colle !
La réalité, c’est que nos policiers, gendarmes et agents pénitentiaires se sentent seuls. (Applaudissements sur les bancs du groupe LR.) Vous les laissez seuls en première ligne, sans le secours d’une politique pénale ferme. Depuis sept ans, vous avez été le gouvernement qui a construit le moins de places de prisons. (Applaudissements sur les bancs du groupe LR.)
M. Patrick Hetzel
Elle a raison, c’est ça le vrai problème !
Sommet Choose France
La parole est à M. Charles Rodwell.
M. Charles Rodwell
Quelque 15 milliards d’euros investis, plus de 10 000 emplois créés. Tel est le bilan record de la 7 e édition du sommet Choose France qui s’est tenue hier à Versailles – dans ma circonscription. N’en déplaise aux défaitistes du Rassemblement national, il s’agit d’un immense succès : la France est, pour la cinquième année consécutive, le pays le plus attractif d’Europe pour les investissements internationaux. Ce succès n’est pas un simple chiffre, mais un succès pour toute la population française : nos communes de moins de 20 000 habitants accueilleront un projet d’investissement sur deux. C’est un succès pour l’emploi : depuis 2017, les entreprises, françaises comme internationales, ont créé près de 2,8 millions d’emplois en France. C’est aussi un succès pour les finances publiques :…
Plus 3 000 milliards de dette ! Dans quel monde vivent-ils ?
…plus d’investissements en France, c’est plus de valeur créée, donc plus d’impôts collectés et moins de dépenses contractées. Ce succès est le fruit de la constance : depuis sept ans, malgré les crises, malgré les oppositions, nous n’avons jamais changé le cap de notre ligne politique.
Il serait temps !
Nous n’avons jamais cessé de baisser les impôts, pour un total de plus de 50 milliards d’euros.
C’est faux !
Nous n’avons jamais cessé de réformer le marché du travail au service de l’emploi, ni d’investir dans nos secteurs industriels stratégiques.
M. Emeric Salmon
Dans un monde en guerre économique, dans lequel les blocs s’affrontent, la constance de notre ligne politique, de nos réformes paie. Ma question est simple : quelle est notre feuille de route, pour maintenir l’attractivité de la France et poursuivre la réindustrialisation de notre pays ? (Applaudissements sur les bancs du groupe RE.)
Je vous remercie pour votre question comme pour le travail accompli dans le rapport sur l’attractivité que vous nous avez remis et qui oriente les réflexions du Gouvernement quant à la feuille de route à suivre.
À mon avis, ils se connaissent…
Vous l’avez dit, ce 7 e sommet Choose France est un succès inégalé, résultat d’une politique constante de compétitivité et d’attractivité – n’en déplaise aux défaitistes de tous bords – qui fait que la France attire. Elle attire par sa fiscalité diminuée et simplifiée, par ses procédures simplifiées et accélérées, parce que ses régions attirent et que ses talents sont nombreux. Comme je le disais tout à l’heure, la France attire aussi parce qu’elle a de l’énergie décarbonée.
Mme Raquel Garrido
Ce sont les travailleurs français qui attirent !
Nous étions hier à Versailles. Les annonces – cinquante-six investissements pour plus de 15 milliards d’euros – se font sous les ors à Versailles, mais les parpaings poussent dans les territoires,…
Avec le ZAN, ils ne poussent plus nulle part : on ne peut plus rien faire !
…dans le Loiret, dans la Somme, dans les Hauts-de-France, en Ardèche – partout en France, y compris à Marseille. Pour redonner de l’espoir aux territoires qui l’ont perdu, cela est essentiel : c’est là qu’il faut investir et que les industriels internationaux souhaitent le faire. Pour répondre à votre question : nous allons continuer, accélérer, amplifier le travail, et nous le ferons en Européens, de façon à accompagner le développement d’industries naissantes : parmi les usines ayant ouvert en France l’an dernier, 37 %, plus d’une sur trois, appartenaient aux industries de l’avenir, telles celles de l’énergie verte ou du recyclage, qui proposeront les emplois de demain. Plus que jamais, nous continuerons de les soutenir, comme nous soutenons la voiture électrique. (Applaudissements sur les bancs du groupe RE et sur quelques bancs du groupe Dem.)
Revalorisation tarifaire des établissements d’hospitalisation privés
La parole est à Mme Joëlle Mélin.
Mme Joëlle Mélin
Au nom de notre groupe, je voudrais exprimer notre vive émotion et notre solidarité avec les familles des victimes du braquage immonde ayant eu lieu ce matin. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.) Ma question s’adresse à monsieur le ministre de la santé. Par vos fonctions passées, vous êtes le mieux placé pour mesurer le désarroi des établissements d’hospitalisation privés suite à la revalorisation tarifaire pour 2024, quatorze fois inférieure à celle du secteur public. Pourtant, vous connaissez bien l’importance de ces 1 030 établissements, mettant les quatre cinquièmes des Français à moins de trente minutes d’un lieu d’hospitalisation, réduisant ainsi les déserts médicaux. Vous connaissez leur activité : 9 millions de personnes soignées, soit 35 % de l’activité globale pour un coût de 18 % seulement des dépenses d’assurance maladie. Vous connaissez bien leur résilience pendant et après le covid, malgré une inflation de 5,2 % en 2022 et 4,9 % en 2023, affectant directement tous les postes d’investissement et de fonctionnement. Vous mesurez donc bien l’iniquité de votre décision, qui fait non seulement imploser la convergence tarifaire public-privé attendue depuis quarante-deux ans, mais surtout met à genoux le système privé, lui aussi chargé de délégation de service public. Alors, que cherchez-vous ? À aggraver la situation de surcharge du secteur public – ne vous inquiétez pas, le 3 juin, jour de la grève, vous en aurez un aperçu ? À préparer une grande vague de financiarisation pour de grands groupes apatrides, qui eux se moquent totalement de la santé de Français ? À présenter des comptes acceptables à l’Union européenne ? Ma question est donc la suivante : à la veille de la publication d’un rapport, calamiteux, de certification des comptes de la sécurité sociale pour 2024, ne pensez-vous pas qu’il est temps de changer de logiciel et, plutôt que de raboter tous les budgets, de faire enfin les comptes sincèrement, en prenant en compte les réserves majeures de la Cour des comptes ? (Applaudissement sur les bancs du groupe RN.)
La parole est à M. le ministre délégué chargé de la santé et de la prévention.
M. Frédéric Valletoux , ministre délégué chargé de la santé et de la prévention
Le service de santé repose effectivement autant sur l’engagement des hôpitaux publics que des établissements privés – pas plus que les autres membres du gouvernement, je n’ai besoin des chiffres que vous avez rappelés pour reconnaître l’importance de l’offre privée. Laissez-moi, à mon tour, vous en donner quelques-uns montrant que ce Gouvernement, comme tous ceux de cette majorité, a soutenu l’activité hospitalière privée, donnant quelque 3,5 milliards d’euros aux établissements privés pour accompagner leur déploiement depuis 2019 et 300 millions l’an dernier suite aux dépassements d’activité. Ces établissements ont en outre émargé à l’enveloppe de 500 millions consacrée par le Premier ministre à aider les établissements, publics comme privés, à supporter l’inflation, les tarifs ayant d’ailleurs augmenté l’an dernier de près de 5 % dans le privé. Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’expliquer, les calculs – assez techniques – de la campagne tarifaire de cette année reposent sur les mêmes critères dans chacun des secteurs. Il se trouve qu’appliqués à l’analyse de rentabilisation de chaque établissement, public comme privé, ces critères donnent des résultats différents. Vous le savez bien puisque j’ai exposé les chiffres de manière très précise. Le Gouvernement accompagne donc bien le déploiement des établissements privés, dont nous savons l’importance dans la prise en charge des Français. Vous évoquez la grève du 3 juin : pour avoir discuté ces dernières semaines avec la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) et plusieurs grands établissements, j’espère trouver des voies de sortie avant le déclenchement de ce conflit : j’ai confiance en leur sens des responsabilités et je connais leur engagement dans nos territoires et leur professionnalisme s’agissant de la prise en charge des Français, qu’ils ne prendraient pas le risque de mettre en péril.
Situation à Gaza
La parole est à Mme Pascale Martin.
Mme Pascale Martin
Des détenus déshabillés entassés à l’arrière de camions les transportant jusqu’à un camp de détention ; des enclos, où sont parqués des détenus menottés, yeux bandés, ayant l’interdiction de bouger sous peine de torture ; des malades attachés au lit, nourris à la paille, forcés de porter des couches ! Cette description que des lanceurs d’alerte israéliens font de l’établissement de détention Sde Teiman, à 30 kilomètres de Gaza fait froid dans le dos. L’un d’eux témoigne : « Ils les ont dépouillés de tout ce qui ressembl[ait] à des êtres humains ». Des centres de torture de ce type, Israël reconnaît en avoir ouvert trois, issus de la reconversion d’installations militaires. Révélés par CNN, ces faits s’ajoutent aux violations toujours plus graves du droit international par l’armée israélienne. Après avoir forcé 1,4 million de Gazaouis à s’entasser dans Rafah, qui ne peut accueillir que 200 000 personnes, l’armée israélienne la pilonne et y a déployé ses chars.
M. Meyer Habib
Libérez les otages !
Plus de 360 000 personnes ont repris la route vers le centre de la bande, mais les bombardements reprennent aussi au nord. Plus de 1 million de personnes risquent de mourir de faim. Plus aucun média ne diffuse d’images. Les camions d’aides sont attaqués, le poste frontière détruit. L’intention génocidaire du gouvernement israélien se précise de jour en jour. (Exclamations sur plusieurs bancs des groupes RN et LR.)
M. François Cormier-Bouligeon
Ça suffit le Hamas !
Le président français se targue d’avoir lancé un avertissement ferme à Netanyahou. Mais celui-ci n’a que faire des avertissements, qui ne sont que des mots et non des actes. Le Président a aussi promis de rapatrier les enfants palestiniens blessés qui ont fui en Égypte et qui pâtissent de l’insuffisance des soins. À Gaza, un enfant palestinien est tué ou blessé toutes les dix minutes !
Selon le Hamas !
Mensonge ! Libérez les otages !
Seuls onze enfants ont été accueillis par la France, sans préserver la famille, un seul parent pouvant accompagner l’enfant. Entre notre délégation, les ONG et vos services, ça s’enlise !
Vous n’avez pas un mot pour les otages !
Et les Français morts à cause du Hamas ?
Quand le Président va-t-il respecter sa parole ? Quand votre gouvernement va-t-il prendre les mesures pour rapatrier ces enfants et leur sauver la vie ? (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NUPES, dont plusieurs membres se lèvent. – M. Jean-Charles Larsonneur applaudit également.)
La parole est à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
M. Stéphane Séjourné , ministre de l’Europe et des affaires étrangères
Je me suis déjà longuement exprimé devant vous à propos de Rafah et sur ce sujet en particulier. Ce qui est à l’origine de cette tragédie, c’est l’attaque du 7 octobre, que vous n’avez toujours pas mentionnée : pas un mot pour nos otages, pas un mot pour les quarante-trois Français tragiquement décédés lors de ces attaques. (Applaudissements sur les bancs du groupe RE.) Les Palestiniens n’ont pas à payer le prix des violences et de la folie meurtrière du Hamas. Je le répète devant vous : Israël doit cesser l’opération en cours à Rafah. Sur le fond, je veux également rappeler la position française, que j’ai défendue le 30 avril dernier lors de mon déplacement en Israël et que je défendrai de nouveau…
M. Jean-François Coulomme
Allez, un peu de courage !
M. Stéphane Séjourné , ministre
…auprès du Conseil de sécurité des Nations unies : la France est pour la libération immédiate et inconditionnelle des otages. (M. le Premier ministre applaudit. – M. Gabriel Amard fait un geste de la main, le pouce vers le bas.) Trois de nos compatriotes sont encore détenus à Gaza et je souhaite que l’ensemble des Français et de la représentation nationale se mobilisent pour leur libération.
M. Gabriel Amard
Ce n’est pas le sujet !
Nous nous prononçons également pour un cessez-le-feu durable, à même de garantir la protection des civils, et pour une entrée massive de l’aide humanitaire,…
M. Carlos Martens Bilongo
On l’attend, pour l’instant !
…ainsi que pour une reprise crédible du processus politique en faveur de la solution à deux États. C’est cette position équilibrée que j’ai défendue, madame la députée. Les Israéliens comme les Palestiniens le savent, la France œuvre en fonction de considérations humanitaires, en particulier en coopérant avec ses partenaires arabes, sur place.
Mme Andrée Taurinya
Il s’agit d’enfants !
Nous continuerons à agir diplomatiquement dans la région, en nous prémunissant de toute instrumentalisation politique. (Applaudissements sur les bancs du groupe RE.)
Mme Nathalie Oziol
Ce n’est pas une réponse !
Loi contre les violences sexistes et sexuelles
La parole est à Mme Marie-Charlotte Garin.
Mme Marie-Charlotte Garin
147 visages, 147 voix du mouvement #MeToo, dans toutes ses nuances, publient aujourd’hui une tribune dans le journal Le Monde pour demander une loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles. C’est ce que réclament depuis longtemps les associations féministes, et voilà que le mouvement s’amplifie encore ; il est puissant, il nous dépasse et il nous enjoint d’agir maintenant. En effet, derrière les 147, il y a des millions d’inconnues. Derrière les 147, il y a les 134 victimes de féminicides en 2023 et les 7,4 millions de Français et de Françaises victimes d’inceste. Il y a une femme victime de viol toutes les six minutes ; il y a celles qui résistent face au harcèlement, à l’emprise, aux violences, à la domination et à l’impunité. Depuis sept ans, tout change pour que rien ne change. Alors, madame la ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, je sais que vous allez énumérer les mesures prises au fil des années, les victoires arrachées par les féministes, les petits progrès qui, indéniablement, font avancer les choses. Mais depuis #MeToo, on avance au coup par coup, au gré des coups médiatiques plutôt que pour contrer les coups sous lesquels tombent nos mères, nos filles et nos sœurs. On dit que les femmes se sont mises à parler, mais les femmes ont toujours parlé ! On s’est juste décidé à bien vouloir les entendre.
Mme Christine Arrighi
Très bien !
Les bulles du mouvement #MeToo se rejoignent pour faire marée face à l’absence de réponse politique forte. Nous demandons, comme en Belgique, une loi intégrale et les moyens qui vont avec. Nous demandons une meilleure protection des victimes, l’élargissement des ordonnances de protection des victimes de viol, l’accès gratuit aux soins psychotraumatiques et, surtout, des moyens financiers pour les forces de justice, pour les forces de l’ordre et pour les associations. Madame la ministre, il faut maintenant agir. Quand allez-vous présenter devant le Parlement une loi intégrale pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles ? (Applaudissements sur les bancs des groupes Écolo-NUPES, LFI-NUPES et GDR-NUPES, ainsi que sur quelques bancs du groupe SOC. – Mme Marie-Pierre Rixain et M. Jean-Charles Larsonneur applaudissent également. – Mmes Raquel Garrido et Pascale Martin, continuant d’applaudir, se lèvent.)
La parole est à Mme la ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.
Mme Aurore Bergé , ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations
Ils sont 147, vous l’avez dit, à avoir signé cette tribune dans Le Monde . Mais derrière elles et derrière eux – ils le disent eux-mêmes –, ce sont des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui ont subi, qui subissent ou qui pourraient subir des agressions sexuelles, des viols et des coups. Voilà une réalité assez terrifiante, en vérité, que nous n’avons pas forcément envie de regarder en face, d’autant que dans neuf cas sur dix, une femme victime d’agression sexuelle ou de viol connaît son agresseur. Cela se passe dans notre intimité, dans nos familles, dans nos maisons, dans notre environnement professionnel, et cela signifie que dans cet hémicycle, il y a évidemment des femmes, et peut-être aussi des hommes, qui ont vécu des agressions sexuelles ou des viols. Réalité statistique plus terrifiante encore, il y a aussi parmi nous, potentiellement, des agresseurs. C’est cette réalité que nous devons collectivement traiter, non pour pointer du doigt tous les hommes en disant qu’ils sont tous des agresseurs – ce n’est évidemment pas ce que je dis –, mais pour souligner qu’enfin, cette question doit concerner l’ensemble de notre société. Nous avons déjà commencé à y œuvrer, par exemple en allongeant le délai de prescription ou en instituant les cours criminelles départementales ; les taux de condamnation pour viol augmentent ainsi année après année – de 30 % depuis 2017. Mais cela ne suffit pas, et c’est pourquoi nous devons en particulier mieux appréhender la notion de consentement, qui se joue dans l’intimité. C’est pour cela que nous devons modifier notre code pénal, afin d’appréhender de manière globale ce que signifie le consentement, et ce dès le plus jeune âge ; nous devons donc mieux le caractériser, pour faire augmenter les taux de condamnation effective. C’est ce à quoi s’est engagé le Président de la République : nous modifierons, je l’espère ensemble, notre code pénal. (Applaudissements sur les bancs du groupe RE.)
Quel est votre bilan, en sept ans ?
Lors des auditions que nous avons menées dans le cadre de la mission d’information sur la définition pénale du viol, le constat a été unanime : modifier le code pénal ne suffira pas : il va falloir mettre des moyens sur la table ! (Applaudissements sur les bancs des groupes Écolo-NUPES, LFI-NUPES et GDR-NUPES.)
Lutte contre le narcotrafic
La parole est à M. Alexandre Vincendet.
M. Alexandre Vincendet
Il y a à peine quelques semaines, la police nationale menait une opération Place nette XXL dans le Rhône, permettant l’interpellation de nombreuses personnes soupçonnées de trafic de stupéfiants ; je tiens ici à saluer et à féliciter les forces de l’ordre pour leur action. Plus largement, ces opérations indispensables ont permis plus de 1 100 interpellations et la saisie de près d’une tonne de drogue partout en France. Face à une telle submersion, il est urgent d’amplifier encore votre action pour préserver la sécurité nationale. La quantité de drogue produite et distribuée dans le monde n’a jamais été aussi importante. Or nous le savons, les conséquences du narcotrafic sont tentaculaires : risques pour la santé publique ; risques d’exclusion sociale durable et d’enlisement dans la violence ; risques financiers, bien sûr, du fait de la multiplication de flux occultes échappant à tout contrôle et pouvant financer des entreprises terroristes ; risques majeurs de sécurité, enfin, car la criminalité toujours plus organisée plonge les territoires concernés, urbains comme ruraux, dans un climat constant de peur et d’insécurité. Je sais le Gouvernement pleinement engagé sur la question, mais il nous faut aller encore plus loin : il faut que la peur change de camp et, pour cela, de nouveaux moyens juridiques semblent indispensables. C’est la conclusion à laquelle est arrivée notre collègue sénateur, Étienne Blanc, rapporteur de la commission d’enquête sénatoriale sur l’impact du narcotrafic en France. Le lâche assassinat perpétré ce matin par un commando de sauvages pour faire évader un narcotrafiquant le montre : c’est une guerre que nous avons à mener. J’ai pour ma part déposé une proposition de loi visant à geler les avoirs des trafiquants de drogue, afin de bloquer les têtes de réseau, et ce texte a retenu l’attention du ministre de l’économie. Nous sommes sur ces bancs, singulièrement au sein du groupe Horizons, déterminés à vous aider à adapter notre arsenal législatif. Ma question est donc la suivante, monsieur le ministre de l’intérieur : quelles suites entendez-vous donner aux recommandations de ce rapport, et comment pouvons-nous poursuivre nos efforts pour définitivement gagner la guerre contre les trafiquants ? (Applaudissements sur quelques bancs des groupes HOR et RE.)
Cet après-midi a donc été rendu le rapport des sénateurs Étienne Blanc et Jérôme Durain sur l’impact du narcotrafic en France, rapport qui compte 600 pages. Je n’en ai lu pour le moment que les principales conclusions, mais je peux vous dire que j’étudierai l’intégralité de ses propositions avec mes services, et je suis certain que le garde des sceaux fera de même, sous l’autorité, bien sûr, du Premier ministre. Ce rapport est issu des travaux d’une commission d’enquête qui a été menée très sérieusement et à laquelle les services des ministères de l’intérieur et de la justice ont largement contribué ; elle a permis de dresser un état des lieux, que vous relayez ici, de la présence très forte du narcotrafic en Europe mais aussi dans le monde, du fait de plusieurs phénomènes. Le principal facteur est la baisse du prix de la drogue, liée à la surproduction observée en Amérique du Sud et en Afghanistan et qui touche tous les pays du monde – il suffit d’observer les effets du fentanyl aux États-Unis. Des laboratoires utilisent l’argent ainsi généré pour produire de nouvelles drogues de synthèse, non conventionnelles. De telles évolutions ont lieu à un moment où de nombreux pays, autour de nous, ont baissé leur garde législative et policière en matière de drogues – voyez ce qui se passe en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne ou en Italie. Grâce à la France, qui est sans doute l’un des seuls pays à augmenter chaque année, quel que soit son gouvernement, ses moyens de police et de gendarmerie scientifiques et techniques, des problèmes que personne n’avait jamais réussi à résoudre ont été résolus, par exemple le démantèlement des messageries cryptées EncroChat et Sky ECC, avec la coopération d’Interpol et d’Europol. Nous devons évidemment aller beaucoup plus loin : les annonces du garde des sceaux sur la création d’un parquet national spécialisé dans la lutte antistupéfiants constituent une première grande réponse. Nous avons nous-mêmes doublé les effectifs de police et de gendarmerie pour concentrer davantage de moyens de police judiciaire dans l’interpellation des trafiquants, qui sont de plus en plus nombreux. Aux Pays-Bas ou en Belgique, des avocats, des hommes politiques et des policiers sont menacés et assassinés ; nous n’en sommes pas là mais nous n’en sommes pas loin, si nous n’amorçons pas un réveil stratégique, économique et financier. La lutte contre la drogue est la grande guerre de politique intérieure que notre pays doit mener. Pour cela, nous tirerons toutes les conclusions du rapport issu de la mission d’information relative à l’application d’une procédure d’amende forfaitaire au délit d’usage illicite de stupéfiants, présenté par les députés Éric Poulliat et Robin Reda, ainsi que du rapport sénatorial Blanc-Durain ; nous y travaillerons avec vous.
M. Sylvain Maillard
Objectif zéro artificialisation des sols
La parole est à M. Emmanuel Maquet.
M. Emmanuel Maquet
Les Français sont prêts à affronter toutes les difficultés, sauf quand elles sont causées par leurs propres dirigeants. La lutte contre l’étalement urbain est nécessaire, mais l’objectif zéro artificialisation nette en 2050, le fameux ZAN – introduit par la loi du 20 juillet 2023 –, est une folie (Applaudissements sur les bancs du groupe LR) qui va renchérir le prix de la construction et interdire l’accès à la propriété à des millions de nos compatriotes. (« Sortez du périph’ ! » sur les bancs du groupe LR.)
M. Jean-Yves Bony
Dans ma circonscription, les acteurs locaux me font part de leurs inquiétudes et tirent la sonnette d’alarme. En effet, à chaque fois que vous aviez la possibilité de préciser la loi, vous l’avez fait au détriment du logement et du développement économique dans la France rurale. Vous avez choisi une définition sévère des surfaces artificialisées, qui pénalisera les parcelles avec jardin, les plus répandues dans nos cœurs de villages. Vous avez choisi de définir les zones d’aménagement concerté (ZAC) au moment où ont débuté les travaux plutôt qu’à celui où la décision a été prise, pénalisant les territoires qui avaient anticipé la loi. Vos choix ont entraîné, par exemple pour la communauté de communes Somme Sud-Ouest, dans ma circonscription, un déficit de développement de 293 hectares – combien, monsieur le ministre, à l’échelle de la France ? Vos collègues de Bercy le savent : permettre à l’industrie de se relocaliser, c’est agir pour l’environnement. (Mme Emmanuelle Anthoine et M. Fabrice Brun applaudissent.) Votre projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables prouve que vous êtes conscients de la crise qui menace le secteur du bâtiment et des travaux publics et l’accession à la propriété. Mais cette loi sera inopérante si vous ne revenez pas sur le ZAN, dont les conséquences seront redoutables pour le secteur ; le groupe Les Républicains ne pourra pas la soutenir si elle ne s’y attaque pas. Vous devez entendre les territoires ruraux qui crient leur désarroi. (Applaudissements sur les bancs du groupe LR.) Acceptez de valoriser les ZAC ! Acceptez de faciliter la revitalisation économique ! Revoyez la manière dont vous définissez ce qui est artificialisé et ce qui ne l’est pas ! Surtout, tenez compte des spécificités de nos territoires ruraux. En un mot, faites confiance à la France rurale et donnez de la liberté aux élus responsables. (Mêmes mouvements.)
Mme Emmanuelle Anthoine
C’est du bon sens !
La parole est à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
M. Christophe Béchu , ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Vous étiez à la COP15, monsieur le député Maquet, et quand vous en êtes rentré, vous avez dit qu’elle avait contribué à vous ouvrir les yeux, ou plus exactement à vous conforter, puisque je vous reconnais cet engagement de longue date en faveur de la biodiversité et des équilibres écologiques – je cite Le Courrier picard. Vous savez à quel point l’artificialisation est la première cause d’érosion de la biodiversité, et j’accueille votre question non comme une remise en cause de l’objectif mais comme l’expression d’une volonté, celle de rendre compatible le ZAN avec d’autres éléments existants. Il est souhaitable que nous prenions un moment pour en discuter. Vous m’expliquez que la définition des ZAC est restrictive, alors que nous avons décidé – je l’ai dit ici même – que toute ZAC commencée avant août 2021 peut être intégralement comptabilisée dans la période 2011-2021. C’est donc, contrairement à ce que vous dites, de l’oxygène que nous redonnons aux territoires, grâce à un dispositif que nous avons coconstruit, en particulier avec Les Républicains à l’Assemblée et au Sénat. Ensuite, vous avez l’impression que nous favorisons la relocalisation d’activités industrielles au détriment du logement. Là aussi, je suis prêt à ce que nous ouvrions ensemble les cahiers de la communauté de communes dont vous parlez, parce que ce n’est ni l’esprit ni le sens de l’arrêté ministériel que j’ai pris il y a quelques semaines.
Tout va très bien, madame la marquise !
M. Christophe Béchu , ministre
Celui-ci classe en effet les grands projets que nous pouvons sortir de ces trajectoires d’artificialisation, de manière, précisément, à permettre le développement de logements en zone rurale. Sur ce sujet, il est encore difficile de mesurer ce que la loi du 20 juillet 2023, les décrets du mois d’octobre et l’arrêté pris il y a quelques jours ont permis de modifier, mais je vous assure que tout cela est cohérent.
M. Vincent Descoeur
Ça reste corseté, quand même !
Une clause de revoyure est prévue dans la loi et ma proposition est simple : voyons-nous, étudions ensemble le cas de la communauté de communes que vous évoquez, et ce sera avec plaisir que j’essaierai de cheminer avec vous.
L’avenir va donner raison à M. Maquet !
Sécurité des Jeux olympiques et paralympiques 2024
La parole est à M. Stéphane Mazars.
M. Stéphane Mazars
C’est effectif : depuis mercredi dernier, la Flamme olympique est sur notre sol et son parcours suscite enthousiasme et bonheur chez nos concitoyens. Ils étaient près de 1 500 enfants, hier matin, dans le centre-ville de Millau, au cœur de mon département, pour l’accueillir, après sa majestueuse traversée du célèbre viaduc qui fête, cette année, de la plus belle des manières, ses 20 ans. Pour avoir été présent, avec mon collègue Jean-François Rousset, je mesure et salue la très forte mobilisation et le total engagement de nos forces de sécurité, de nos forces de secours, de l’armée et, plus généralement, des services de l’État, pour sécuriser l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques dans notre pays. Jamais la France n’a organisé un événement d’une telle ampleur. Nous le savons, c’est bien le défi de la sécurité qui soulève le plus de commentaires et d’interrogations. Pour le relever, nous avons voté, il y a près d’un an, la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques, pour renforcer nos moyens juridiques, en particulier grâce à la création de nouvelles infractions ou la possibilité d’expérimenter, pour les grands événements, la vidéoprotection augmentée. À ce titre, monsieur le ministre de l’intérieur, avez-vous reçu un premier retour d’expérience sur l’intérêt que représente cette technologie fondée sur l’intelligence artificielle ? Par ailleurs, des élus locaux se sont inquiétés de la sécurité dans leurs territoires, du fait de la mobilisation des forces de l’ordre autour des sites olympiques, en particulier en Île-de-France. À l’occasion de votre déplacement il y a quelques jours à Rodez, vous avez souhaité les rassurer en leur affirmant que, même au cœur des Jeux, la sécurité de nos concitoyens serait assurée partout et pour tous. Pourriez-vous nous préciser où en est la mobilisation des forces de sécurité et de secours, d’ores et déjà effective depuis l’arrivée du Belem dans le port de Marseille, et qui devra rester au même niveau d’intensité jusqu’au 18 septembre, jour de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe RE.)
Je me réjouis, comme vous, de constater que les Français sont heureux, partout en France, de voir démarrer les épreuves olympiques par le relais de la Flamme. La cérémonie qui s’est tenue à Marseille était magnifique. Pas moins de 200 000 personnes se sont rassemblées dans le Vieux-Port pour voir arriver la Flamme et assister à un concert qui s’est prolongé jusqu’à tard dans la soirée. Le lendemain, huit étapes ont jalonné le parcours de la Flamme dans la belle ville de Marseille, notamment dans les quartiers nord. Depuis, la Flamme a repris sa route et s’est arrêtée, en particulier dans votre département de l’Aveyron. Très populaire, cet événement, une vraie fête de famille, a réuni plus de 400 000 personnes. La Flamme est aujourd’hui en Corse et tout se passe, là encore, fort bien.
Il faut l’envoyer à Nouméa.
M. Gérald Darmanin , ministre
Nous montrons là que nous sommes capables, en France, d’organiser de grands événements, comme nous l’avons fait pour la Coupe du monde de rugby qui s’est déroulée sans accroc. Les grincheux en sont pour leur compte, ceux qui veulent toujours voir la France triste et perdante. Il suffit de voir la une des journaux étrangers et la joie des familles françaises devant cette fête incroyable des Jeux olympiques pour se convaincre de notre réussite, que nous devons au génie de notre pays et, en partie aussi, à nos forces de l’ordre. Je vous suis reconnaissant de les en avoir remerciées. J’en profite pour vous donner des précisions sur la technologie que nous utilisons. La surveillance intelligente, qui ne recourt pas à la reconnaissance faciale, permet de repérer jusqu’à huit événements, des mouvements de foule ou des départs de feu, par exemple. Nous menons des expérimentations avec quatre entreprises exclusivement françaises, hier au cours d’un concert de Depeche Mode, demain lors de Roland-Garros. J’ai d’ailleurs installé un comité indépendant chargé de contrôler le travail de ces sociétés et de la préfecture de police. Nous pourrons utiliser cette nouvelle technologie dans le respect des droits garantis à nos concitoyens. La France est prête à organiser le plus grand événement mondial. Cela fait un siècle que les Jeux olympiques d’été ne s’étaient pas tenus dans notre pays. Ce sera une belle fête, en partie grâce aux forces de l’ordre. (Applaudissements sur les bancs du groupe RE.)
Places en centres d’hébergement d’urgence
La parole est à Mme Katiana Levavasseur.
Mme Katiana Levavasseur
Permettez-moi avant tout d’exprimer, au nom de mes collègues députés de l’Eure et des membres du Rassemblement national nos sincères condoléances et notre soutien aux familles des agents de l’administration pénitentiaire lâchement assassinés par des barbares ce matin. Monsieur le ministre de l’intérieur, deux minutes ne suffiront pas à exposer la gravité de la situation concernant les places en centres d’hébergement d’urgence, littéralement pris d’assaut par des immigrés en situation irrégulière.
M. Perceval Gaillard
Selon la Cour des comptes, 40 à 60 % des places en centres d’hébergement d’urgence sont occupées par des immigrés clandestins, pour un coût avoisinant le milliard. Cette situation est intolérable. La France est le seul pays en Europe à avoir inscrit dans sa législation le principe d’un hébergement inconditionnel. Comme l’avait souligné le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ce droit permet d’héberger gratuitement et sans limite de durée les demandeurs d’asile, les sans-papiers et les résidents en difficulté sociale. Il n’est ainsi pas rare que des sans-papiers soient hébergés pendant des années. Ce système, au lieu d’être une mesure temporaire d’urgence, est devenu une porte ouverte à des abus continus, tout en privant nos concitoyens les plus vulnérables d’une aide d’urgence vitale. Les Français fragilisés par la vie sont directement affectés par cette saturation. Il est inadmissible que des femmes battues, qui fuient la violence ou des jeunes majeurs isolés, soient laissés sans solution d’hébergement à cause de votre politique migratoire laxiste ! D’autant plus que les demandeurs d’asile, plus de 140 000 rien que l’année dernière, qui ont été déboutés de leur demande ont tendance à se reporter sur le parc d’hébergement d’urgence de l’État. Il est temps de défendre les intérêts de nos concitoyens et de rétablir l’ordre et la justice dans la gestion de l’hébergement d’urgence. Quelles mesures immédiates allez-vous prendre pour mettre fin à cette absurdité et garantir que l’hébergement d’urgence profite d’abord et avant tout aux Français dans le besoin ? (Applaudissements sur les bancs du groupe RN. – Mme Cyrielle Chatelain et M. Karim Ben Cheikh s’exclament.)
Vous connaissez le nombre de personnes qui meurent dans la rue ?
En l’absence de Guillaume Kasbarian, ministre chargé du logement, je répondrai à votre question. Commençons par rappeler les chiffres. Chaque soir, 200 000 personnes, dont la moitié sont en région parisienne, passent leur nuit dans un centre d’hébergement d’urgence. Ces 200 000 places ont pu être ouvertes grâce à un effort sans précédent car, lors de la crise du covid, le gouvernement précédent a pris la décision de relever le nombre de places et nous avons tenu à maintenir ce niveau, tout en développant en parallèle, conformément à l’engagement du Président de la République, le plan « logement d’abord » qui consiste à proposer des sortes de pensions de famille, une autre solution que l’hébergement d’urgence, qui n’est la panacée pour personne. Qui retrouve-t-on dans les centres d’hébergement d’urgence ? Par définition, ceux qui n’ont pas de toit. Vous citez un rapport de la Cour des comptes dont vous tirez des conclusions hâtives, et vous semblez découvrir une formule magique qui consisterait à expulser les occupants de ces centres pour y faire entrer ceux qui n’y sont pas ! Vous oubliez simplement que l’hébergement d’urgence est précisément conçu pour ceux qui n’ont pas d’hébergement. Je citerai l’exemple des femmes victimes de violences conjugales pour lesquelles le parc a doublé en quelques années afin d’atteindre 10 000 places. Parallèlement, nous réalisons, avec les associations, un véritable travail de dentellière pour adapter les moyens aux besoins en fonction des secteurs. J’ai bien entendu votre appel à prêter une attention particulière aux plus fragiles, à ceux qui souffrent, mais je vous assure que nous sommes déterminés à mener une politique globale qui ne laisse personne au bord du chemin. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RE.)
Épidémies de choléra à Mayotte et de leptospirose à La Réunion
La parole est à M. Jean-Hugues Ratenon.
M. Jean-Hugues Ratenon
Monsieur le ministre de la santé, la France est un pays développé, la troisième puissance économique d’Europe. Pourtant, deux épidémies : la leptospirose et le choléra frappent violemment la France de l’océan Indien. Ces deux maladies des pays pauvres frappent deux territoires Français – cette France qui, à Mayotte, laisse mourir un enfant de 3 ans. Oui, chers collègues, on meurt du choléra en France ! Ou plutôt en outre-mer, l’autre France. N’est-ce pas là le résultat de l’abandon de nos territoires ? (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NUPES. – M. Marcellin Nadeau applaudit aussi.) Le choléra met une nouvelle fois en lumière le sous-développement du 101 e département français. À quand l’égalité de traitement entre territoires de la République ? À quand l’égalité d’accès aux services publics, notamment à l’eau, ce bien commun ? (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NUPES. – Mme Cyrielle Chatelain et M. Marcellin Nadeau applaudissent également.) L’épidémie risque de s’étendre à La Réunion, déjà confrontée à une autre maladie, la leptospirose. Depuis le début de l’année, elle fait face à une forte augmentation du nombre de cas, du jamais-vu. Déjà deux morts, qui auraient pu être évités. Parmi les malades, 70 % ont dû être hospitalisés et 25 % sont dans un état critique. Les hôpitaux s’en trouvent saturés : 90 % des places dans les services concernés sont occupées par des patients atteints de cette maladie. La Réunion a 15 % de lits en MCO (médecine, chirurgie, obstétrique) et 40 % de lits de rééducation en moins par rapport à la moyenne nationale. Pourquoi ? Il en résulte une pression sur les services et le personnel soignant, à La Réunion comme à Mayotte. Vous financez la guerre à coups de milliards au détriment de notre santé. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NUPES. – Mme Francesca Pasquini applaudit également.) C’est indigne de la République. La santé n’est pas une marchandise, Il est urgent d’agir, des solutions existent. Que comptez-vous faire ? Êtes-vous prêt à mettre en pratique les propositions qui vous ont été soumises pour éradiquer les maladies et rattraper le retard du service public ? (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NUPES et sur plusieurs bancs du groupe Écolo-NUPES. – M. Marcellin Nadeau applaudit également.)
Je me suis rendu à Mayotte il y a quelques jours et je salue l’engagement des services de l’État pour faire face à une poussée de choléra qui frappe de nombreuses régions dans le monde, en particulier en Afrique australe, l’Afrique des grands lacs, pas très loin de Mayotte. Cette épidémie est circonscrite à un quartier, celui de Kirson, dans la commune de Koungou. À ce stade, 76 personnes sont malades et 4 000 personnes ont été vaccinées dans ce quartier. Ce faisant, l’État applique les recommandations du Haut Conseil de la santé publique : une vaccination ciblée contre le choléra et progressive, en direction des personnes malades, de leur entourage et de ceux qu’elles ont côtoyés.
Nous voulons des vaccins !
M. Frédéric Valletoux , ministre délégué
Je rends hommage aux quatre-vingt-sept volontaires de la réserve sanitaire qui œuvrent aux côtés des hospitaliers et des soignants de Mayotte, pour détecter, dépister, accompagner et prendre en charge les populations, réaliser un travail de prévention en rappelant les règles d’hygiène. La leptospirose qui sévit à La Réunion, est, hélas, une maladie qui revient chaque année pendant l’été austral.
Mme Aurélie Trouvé
Alors tout va bien !
À La Réunion, 107 cas ont été constatés cette année, contre 160 l’an dernier et 169 en 2022. Je pourrais remonter ainsi sur une quinzaine d’années.
Vous avez de faux chiffres !
Non, nous n’abandonnons pas les populations. Au contraire, l’État est présent. Je l’ai dit pour Mayotte mais je veux bien le répéter pour La Réunion : les investissements réalisés dans les services hospitaliers de La Réunion, l’aide apportée à l’hôpital de La Réunion, témoignent de notre volonté de nous montrer solidaires vis-à-vis des habitants. C’est normal et c’est concret !
Rave party illégale à Parnay
La parole est à Mme Laetitia Saint-Paul.
Mme Laetitia Saint-Paul
La commune de Parnay, village de carte postale, au cœur de l’appellation Saumur-Champigny, a été révélée au grand public pour de tout autres raisons. Ce week-end, une rave party illégale réunissant plus de 10 000 personnes a causé de graves nuisances dans tout mon bassin de vie.
Un député du groupe LR
Il faut envoyer l’armée.
Malgré la remarquable mobilisation de la préfecture, des gendarmes, des secours, de la procureure, des élus locaux, notamment le maire Éric Lefièvre, pour déployer dans l’urgence, jour et nuit, un dispositif qui permette d’éviter les suraccidents, ce type de rassemblement illégal s’est soldé, une fois de plus, une fois de trop, par la mort d’un jeune homme. Je présente toutes mes condoléances à ses proches. Elle s’est aussi soldée par 216 évacuations sanitaires et 5 181 infractions, représentant un montant total de plus de 650 000 euros d’amendes. De nombreuses zones d’ombre demeurent. Quels sont les moyens de prévention, notamment de renseignement ? Qui porte la responsabilité en l’absence d’organisateurs ? Quelle place accorder aux facilitateurs autoproclamés ? Quelles réparations pour les victimes, propriétaires, communes, riverains, sans parler des atteintes à l’environnement ? Que finance la Mildeca (mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) et pour quel résultat ? Pourquoi cette mission n’est-elle pas pilotée par le ministère de l’intérieur qui lui reverse l’argent des saisies ? La banalisation de la consommation de drogue est, en elle-même, un fléau. (Applaudissements sur les bancs du groupe RE.)
Merci d’avoir rendu hommage aux policiers, aux gendarmes et au préfet, qui ont installé un centre de secours alors que cette manifestation était interdite et illégale. Des sapeurs-pompiers, des gendarmes et des agents de préfecture ont organisé du mieux possible l’évacuation sanitaire de personnes qui étaient parfois sous l’emprise de l’alcool, de stupéfiants, ou des deux. Le décès d’un jeune homme a eu lieu, et je voudrais évidemment m’associer aux condoléances que vous adressez à sa famille. Les organisateurs de cette manifestation se sont montrés tout à fait irresponsables, à la fois parce qu’elle était illégale, mais aussi parce qu’elle se caractérisait par l’amateurisme et la violence. Je voudrais saluer le courage du maire et le travail de ses services, au sens large du terme, dans une petite commune, ainsi que le travail que vous avez mené en tant que députée auprès de votre territoire. Pas moins de 800 gendarmes ont été mobilisés pour réaliser des contrôles. Plus de 5 000 amendes ont été attribuées, qui représentent plus de 700 000 euros. Je peux vous assurer, en lien avec la direction générale des finances publiques (DGFIP), qu’elles seront payées.
Ils ne sont pas solvables ! Ils ne paieront jamais !
Des dizaines de personnes ont été interpellées et, dès ce matin, un certain nombre d’entre elles sont passées devant les tribunaux en comparution immédiate. J’espère qu’elles feront l’objet des condamnations les plus fermes. Le matériel des organisateurs a été saisi. Nous espérons que les violences commises contre les gendarmes et l’organisation de cette manifestation illégale susciteront de la part de la justice des réponses pénales fortes, puisque c’est le procureur de la République lui-même qui a ordonné aux gendarmes de procéder à ces saisies. La question se pose de savoir si notre législation est suffisante, puisque les renseignements du ministère de l’intérieur avaient annoncé la tenue de cette rave party dans votre département. Nous ne disposons cependant que de moyens d’information et non d’entrave. C’est peut-être le premier sujet auquel le Parlement devrait réfléchir. Par ailleurs, même si elle n’est pas sous l’autorité du ministère de l’intérieur, nous devons travailler avec la Mildeca pour lutter contre la consommation de stupéfiants, et non en faveur de la relativisation, voire de l’encadrement, de cette dernière. Il n’est ni possible ni souhaitable d’encadrer la consommation de stupéfiants qui mènent à la mort. Chacun doit le dire ici !
Il a raison !
C’est notamment le cas lorsqu’elle fauche en pleine jeunesse des gens qui veulent s’amuser, mais le faire parfois avec de la drogue, ce qui est non seulement illégal, mais aussi particulièrement dangereux.
Nous avons terminé les questions au Gouvernement.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures trente, est reprise à dix-sept heures vingt-cinq.)
La séance est reprise.
Je vous informe que nous allons maintenant procéder à l’élection, par scrutin dans les salles voisines de la salle des séances, d’un juge suppléant à la Cour de justice de la République. Je suis saisie de la candidature de Mme Blandine Brocard. Le scrutin est secret et des bulletins imprimés sont à votre disposition. Pour que le vote soit valable, le bulletin déposé dans l’urne ne doit comporter qu’un seul nom. Les délégations de vote ne sont pas admises. J’ouvre le scrutin, qui est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale pour une durée de trente minutes. Il sera donc clos à dix-sept heures cinquante-six.
4. Modification du corps électoral pour les élections au Congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
Suite de la discussion d’un projet de loi constitutionnelle.
L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au Congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (n os 2424, 2611). Je vous indique qu’à la demande du groupe Socialistes et apparentés, j’ai réuni le groupe de contact sur la Nouvelle-Calédonie qui comprend les présidents de chaque groupe politique, les députés de Nouvelle-Calédonie, le président de la commission des lois et le président de la délégation aux outre-mer. Au terme d’un échange assez long – ce qui explique l’heure tardive de reprise de la séance –, nous sommes convenus que nous appelions à la sérénité des débats dans l’hémicycle et au respect des positions et des opinions de chacun, que, compte tenu de la situation actuelle en Nouvelle-Calédonie, particulièrement à Nouméa, nous appelions au calme et à la reprise du dialogue, que l’objectif partagé par tous était d’aboutir à un accord global et que l’Assemblée nationale prendrait toute sa part dans la poursuite de cet objectif – nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie peuvent compter sur l’ensemble de la représentation nationale pour jouer pleinement son rôle sur cette question.
Discussion des articles (suite)
Hier soir, l’Assemblée a poursuivi la discussion des articles du projet de loi constitutionnelle, s’arrêtant à l’amendement n o 101 à l’article 1 er , appelé par priorité.
Article 1 er (appelé par priorité - suite)
La parole est à M. Bastien Lachaud, pour soutenir l’amendement n o 101.
M. Bastien Lachaud
Tout le monde souhaite évidemment le retour à la paix civile en Nouvelle-Calédonie. Cependant, le Gouvernement doit prendre conscience de sa responsabilité. Avec ce texte, il a décidé de passer en force face aux indépendantistes qui appelaient de leurs vœux un accord global au sein duquel serait traitée la question du dégel du corps électoral. Ceci étant dit, monsieur le ministre, je vous repose à présent une question que je vous ai déjà posée hier soir et j’aimerais cette fois avoir une réponse – vous avez eu toute la nuit pour faire travailler vos services. Vous nous avez donné les chiffres du dégel à un instant T – cette année. Pouvez-vous nous donner les chiffres dans cinq ans et dans dix ans ? Hier soir, vous avez crié dans l’hémicycle que, d’ici là, certaines personnes seraient mortes. Certes mais pouvez-vous nous dire…
…combien de personnes seront mortes ?
…combien de personnes seront inscrites sur les listes électorales nonobstant le nombre de personnes qui décéderont – malheureusement pour elles – d’ici là ?
La parole est à M. Nicolas Metzdorf, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, pour donner l’avis de la commission.
M. Nicolas Metzdorf , rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
Défavorable.
La parole est à M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer, pour donner l’avis du Gouvernement.
Avis défavorable sur l’amendement de M. Lachaud qui vise à substituer au mot : « suivantes » les mots : « qui suivent ».
Mme Danielle Brulebois
Eh oui ! C’est ça, l’amendement !
La parole est à Mme Sophia Chikirou.
Ces amendements nous permettent d’évoquer un sujet qui place la Nouvelle-Calédonie dans une situation particulièrement dramatique. Peut-être l’amendement n o 101 vous déplaît-il, mais il nous donne l’occasion d’approfondir une discussion qui concerne 270 000 de nos compatriotes. Ils vivent sous tension en grande partie parce que vous refusez d’entendre que le dialogue ne peut se nouer avec un seul camp ; il doit se tenir avec tout le monde. Le Président de la République et votre gouvernement avez décidé de maintenir un référendum contre l’avis des indépendantistes ; vous avez décidé de passer en force contre l’avis de plus de la moitié de la population de la Nouvelle-Calédonie. La situation dans laquelle nous nous trouvons depuis deux jours relève de votre responsabilité pleine et entière. Alors prenez vos responsabilités : pour ramener le calme et la paix civile, il vous incombe de suspendre l’examen du texte et d’envoyer une délégation de médiateurs afin de renouer un dialogue rompu. Ce ne sont certainement pas les déclarations du rapporteur qui ramèneront le calme. Nous allons réprimer, dites-vous après avoir provoqué : vous incendiez puis vous envoyez les gendarmes maintenir l’ordre, parfois au prix de leur propre sécurité. Nous vous demandons d’assumer vos responsabilités – et nous parlerons autant que nécessaire pour vous faire entendre le point de vue de personnes qui ne sont pas représentées par leurs députés dans cet hémicycle. ( M. Bastien Lachaud applaudit. )
La parole est à M. le ministre.
Je ne peux laisser dire que les députés ne représentent pas le territoire qui les a élus. M. Léaument parlait hier du taux de participation au référendum ; nous n’avons pas poussé le vice jusqu’à lui rappeler que plus de 58 % des électeurs de sa circonscription n’ont pas voté à l’élection législative. Nous ne remettons pas pour autant en cause la légitimité de tel ou tel élu ! Vous ne devriez pas trier les élus en fonction de vos goûts – ou, en l’occurrence, en fonction de leur vote en faveur de Nicolas Metzdorf ou de Philippe Dunoyer ; ce serait plus respectueux de la démocratie et de la République. Nous envoyons des gendarmes en Nouvelle-Calédonie pour maintenir l’ordre. Madame Chikirou, vous ne connaissez pas la situation ! Les gendarmes avec leurs familles – par exemple à Poindimié sur la côte ouest – se sont fait tirer dessus à balles réelles dans leurs brigades. Nous n’avons pas envoyé des gendarmes maintenir l’ordre ; ce sont des gens qui sont entrés dans la gendarmerie et qui l’ont dévastée.
Et le GIGN, vous ne l’avez pas envoyé ?
Ne criez pas ; je n’entends pas vos arguments, vous reprendrez la parole.
Je ne crie pas, je parle !
Au moins pourriez-vous condamner ces faits. Vous riez ? Des gendarmes et leurs familles se font tirer dessus, et vous riez ? Soit. Avis défavorable.
(L’amendement n o 101 n’est pas adopté.)
La parole est à M. Antoine Léaument, pour soutenir l’amendement n o 102.
M. Antoine Léaument
Avant de défendre cet amendement, je voudrais vous remercier, madame la présidente, pour vos propos introductifs qui contrastent avec ce que nous avons entendu hier de la part de M. Darmanin. À l’évidence, il n’a pas bien entendu vos paroles sur le calme et l’attention qui doivent présider à nos débats afin que nous évitions les piques inutiles telles que celles qu’il vient de lancer. Je vais maintenant lui répondre. Oui, le taux d’abstention est élevé aux élections législatives et le sera probablement aux élections européennes. Vous n’avez sans doute pas oublié que nous vous avons fait des propositions concrètes pour faire baisser l’abstention, notamment en luttant contre la mal-inscription et la non-inscription sur les listes électorales.
Quel est le rapport avec le texte ?
La situation en Nouvelle-Calédonie n’est pas de même nature puisque, lors des précédents référendums, le taux de participation a été très élevé, dépassant les 80 %. Si la participation a drastiquement diminué lors du dernier référendum, c’est parce que vous n’avez pas créé les conditions permettant un appel général en faveur d’une large mobilisation des électeurs. Ce référendum a donc perdu en légitimité. La cause en est que vous avez voulu aller plus vite que la musique et que vous n’avez pas respecté la culture kanak, qui requérait une période de deuil plus longue. Vous avez donc créé les conditions d’une faible participation à ce référendum – comme vous créez les conditions d’une faible participation aux élections européennes à venir. Voilà l’un des sujets sur lesquels vous ne nous apportez pas de réponse. Vous bottez en touche : la démocratie s’applique même quand elle ne nous plaît pas, nous dites-vous.
C’est vrai !
La démocratie, c’est le pouvoir du peuple. Or, en Nouvelle-Calédonie, il y a deux peuples. L’un d’eux n’a pas été respecté. Pour que la démocratie soit pleine et entière, il faut que l’ensemble du peuple calédonien ait voix au chapitre. Avec ce projet de loi et avec ce référendum, vous ne respectez pas la souveraineté calédonienne.
(L’amendement n o 102, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Je suis saisie de deux amendements identiques, n os 48 et 192. La parole est à M. Antoine Léaument, pour soutenir l’amendement n o 48.
Mon collègue Bastien Lachaud vous a posé une question. Hier, vous nous avez donné les chiffres du corps électoral à un instant T mais nous souhaiterions – comme les Calédoniens – connaître l’impact de votre réforme à moyen et long terme. Nous avons compris que vous ne pouviez prédire les décès – et c’est heureux, sinon nous nous inquiéterions des capacités du ministère de l’intérieur, qui peut déjà envoyer des alertes sur tous les téléphones portables en plein hémicycle – mais nous souhaiterions connaître l’évolution du corps électoral – hormis les décès, imprévisibles par nature – en conséquence de la réforme que vous comptez appliquer. Aux termes des dispositions de l’article 24 de la Constitution, le Parlement contrôle l’action du Gouvernement. Nous sommes donc dans notre rôle en vous interrogeant sur ce point. Nous attendons vos réponses. Puisque vous m’avez fait le plaisir, monsieur le ministre, de souligner que je cite souvent la Constitution, je vous fais remarquer que vous avez commis une erreur. Hier, vous avez prétendu citer l’article 1 er de la Constitution de la V e République alors qu’il s’agissait de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui est antérieure à la Constitution de 1793 que j’avais moi-même citée.
M. Charles Sitzenstuhl
La Déclaration est dans le bloc de constitutionnalité !
La parole est à Mme Sabrina Sebaihi, pour soutenir l’amendement identique n o 192.
Mme Sabrina Sebaihi
Lors de la discussion sur le premier texte de loi relatif à la Nouvelle-Calédonie, vous vous étiez vanté d’avoir le soutien du Congrès pour reporter la date des élections. Cette fois, le Congrès de Nouvelle-Calédonie a voté en faveur du retrait du texte dont nous débattons mais vous n’en faites pas état. Vous ne l’avez pas évoqué ! Pourquoi choisir de faire de la démocratie à géométrie variable ? Pourquoi tenir compte du vote du Congrès lorsqu’il va dans votre sens et qu’il est d’accord avec vous pour changer le calendrier des élections, et ne pas en tenir compte lorsqu’il vous demande de retirer le texte concernant le dégel du corps électoral ? Que répondez-vous ? Pourquoi ne tenez-vous pas compte de ce vote ? Nous vous avons fait plusieurs propositions depuis hier, notamment la mise en place d’une mission de dialogue afin de progresser vers un accord global. Le Président de la République a annoncé qu’il ne convoquerait pas le Congrès avant plusieurs semaines. Je pose de nouveau la question : pourquoi cette précipitation dans le calendrier alors que nous ne sommes pas certains que ce texte sera soumis au Congrès pour validation ? En réalité, les va-et-vient, l’ambiguïté maintenue autour de ce texte nous discréditent pour mener des discussions sur la Nouvelle-Calédonie. Il faut aller beaucoup plus loin. La Nouvelle-Calédonie étant considérée comme un territoire à décoloniser, il convient désormais de faire appel à l’ONU pour mener les négociations. (Applaudissements sur les bancs des groupes Écolo-NUPES, LFI-NUPES et GDR-NUPES.)
Quel est l’avis de la commission ?
M. Nicolas Metzdorf , rapporteur
Quel est l’avis du Gouvernement ?
En cas de projet de loi organique pour reporter l’élection d’une assemblée, la consultation du Congrès est obligatoire. Ici, en revanche, la délibération du Congrès n’était pas prévue dans le cadre de la consultation sur le projet de loi constitutionnelle. Il y a une différence entre la procédure parlementaire et une délibération politique votée par les assemblées, comme elles en votent partout en France. Ne comparez pas ce qui n’est pas comparable. D’autre part, vous faites semblant de ne pas entendre que nous sommes obligés de reporter ces élections provinciales parce que nous avons négocié jusqu’au bout. Nous ne pouvons pas convoquer des élections provinciales avec le corps électoral actuel ; elles seraient annulées. La réalité est que vous refusez la responsabilité du pouvoir. Heureusement que nous sommes aux responsabilités car, si je vous écoutais, vous convoqueriez des élections provinciales qui seraient annulées, justifiant la convocation, en urgence, sans aucune négociation, des assemblées pour modifier le corps électoral et l’organisation, dans la précipitation, des élections avec un corps électoral dégelé, à quelques jours d’un nouveau scrutin. En clair, vous n’êtes pas prêts pour les responsabilités politiques ; vous êtes donc prêts pour l’opposition. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RE.)
La parole est à Mme Danièle Obono.
Mme Danièle Obono
Cet amendement vise précisément à corriger le texte pour transformer l’avis simple du Congrès en avis conforme. C’est parce que nous respectons la souveraineté calédonienne, dont le Congrès est l’expression, que nous pensons que cet avis est nécessaire. Il se trouve que l’avis du Congrès sur ce projet de loi constitutionnelle est négatif. Vous prétendiez défendre la démocratie, en parangons de vertu, mais au fond, vous n’utilisez l’argument démocratique que quand il va dans votre sens. La démocratie n’est pas ce qui motive ce projet de loi. J’en viens à l’argument relatif au risque juridique qui existerait si l’on tenait des élections avec le corps électoral actuel. Ce point est contesté. Dans un arrêt du 22 juin 2023, la Cour de cassation a jugé que « [d]ans son arrêt du 11 janvier 2005, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que, après une histoire politique et institutionnelle tourmentée, la condition de dix ans de résidence fixée par le statut du 19 mars 1999 a constitué un élément essentiel à l’apaisement du conflit meurtrier en Nouvelle-Calédonie et retenu que l’histoire et le statut de la Nouvelle-Calédonie sont tels qu’ils pouvaient être considérés comme caractérisant des nécessités locales, au sens de l’article 56 de la Convention, de nature à permettre les restrictions apportées au droit de vote de certains résidents de cette collectivité. « Il doit être constaté que l’organisation des consultations sur l’autodétermination de ce territoire n’a, à ce jour, pas permis de mettre un terme à ces nécessités locales. » Autrement dit, il était possible de tenir les élections dans le cadre actuel. Vous avez choisi de ne pas le faire parce que votre objectif est de passer en force. Voilà pourquoi vous ne voulez pas de l’avis conforme du Congrès et voilà pourquoi nous le demandons. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe LFI-NUPES.)
L’argument que le ministre répète avec un peu trop d’autorité, selon lequel si le texte n’est pas voté, les élections seront annulées, procède d’une lecture abusive de l’avis du Conseil d’État qui relève un risque d’inconventionnalité.
…et d’inconstitutionnalité !
Le cadre juridique actuel sur le gel du corps électoral est constitutionnel. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous devons modifier la Constitution. La seule question concerne l’inconventionnalité éventuelle, c’est-à-dire la contradiction avec la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Comme l’a indiqué Danièle Obono, la Cour de cassation, haute juridiction de notre pays, juge qu’à ce stade, il n’y a pas de risque d’inconventionnalité. Les avis divergent ; il n’existe pas de certitude. Finalement, si vous convoquez des élections, cela signifie que toute votre stratégie a échoué.
Exactement !
Vous prenez le risque de convoquer des élections qui pourraient être boycottées par une partie des acteurs refusant le processus en cours. Ainsi, vous prenez un risque d’illégitimité. Dès lors, conserver le corps électoral actuel n’est pas la situation qui présente le plus grand risque juridique.
La parole est à Mme Sabrina Sebaihi.
En effet, vous n’avez aucune certitude sur le risque juridique en cas d’organisation du scrutin. Sur la question du calendrier, je m’interroge : qui fait preuve de précipitation ? C’est vous ! Au moment même où le texte est débattu à l’Assemblée, le Président de la République déclare qu’il faut reprendre le dialogue et qu’il va inviter les parties prenantes pour ouvrir les discussions. Je réitère donc ma question. Je ne comprends toujours pas pourquoi nous devrions voter un texte qui sera éventuellement soumis au Congrès alors même qu’en cas d’accord intervenu avant décembre, tout cela sera caduc. Pourquoi ne pas travailler, sans épée de Damoclès au-dessus de la tête des parties prenantes, à obtenir un accord global dans de bonnes conditions et dans un dialogue apaisé, afin d’éviter ce qui est en train de se produire en Nouvelle-Calédonie, plutôt que de précipiter le vote de ce texte ? Je ne comprends pas.
La parole est à M. le ministre.
Tout d’abord, rétablir la démocratie n’est pas faire peser une épée de Damoclès sur qui que ce soit, mais une juste mesure pour que les citoyens puissent voter.
Mais la démocratie n’est pas abolie ! Qui parle de la rétablir ?
La démocratie, c’est important, monsieur Delaporte. Même si cela vous paraît manifestement un peu éloigné de notre discussion, c’est tout de même l’objet de l’évolution du corps électoral dont nous débattons. Deuxièmement, je rappelle à Mme Obono que la Cour de cassation n’est pas le juge de l’élection ; cette compétence relève du juge de droit public, à savoir le Conseil d’État ou le Conseil constitutionnel selon les scrutins. Mais la Cour de cassation n’a pas pris une position différente de celle du Conseil d’État, bien au contraire puisqu’elle considère qu’il faut conserver des spécificités locales. C’est ce que nous faisons en prévoyant dix ans de présence sur place – donc dix ans d’attente – pour pouvoir voter à une élection locale. Cette règle n’existe nulle part ailleurs en France et même nulle part ailleurs dans le monde démocratique. Nous conservons donc les spécificités locales. Troisièmement, j’invite M. Delaporte à relire l’avis du Conseil d’État, cette juridiction que cite pourtant si souvent l’opposition, notamment les points 7 et 8. Le Conseil d’État indique lui-même expressis verbis qu’il faut constater que le corps électoral actuel est une dérogation « aux principes d’universalité et d’égalité du suffrage » qui « tend à s’accroître avec le temps » et en devient contraire, selon le point 8, aux principes constitutionnels et aux engagements internationaux de la France. Il estime que conserver le corps électoral actuel serait contraire aux conventions internationales et aux principes élémentaires de la Constitution française qui régit notre vieille démocratie. Dois-je vous rappeler, monsieur le député, que le droit de suffrage et l’égalité entre les citoyens devant l’élection, en un mot la démocratie, ont une valeur supérieure à celle d’un tableau annexé au titre des dispositions transitoires mentionnées au titre XIII. Cela étant, on peut soutenir l’idée qu’il ne faut pas toucher au corps électoral…
Personne ne le fait.
Mais si, c’est ce que vous soutenez en l’absence d’accord. On pourrait tout aussi bien réserver les scrutins locaux – les référendums d’autodétermination ne sont pas concernés – aux Calédoniens nés avant 1998 et empêcher ad vitam æternam tous les autres, leurs enfants et petits-enfants, de choisir leurs élus locaux. Ce n’est pas raisonnable et je réitère l’avis défavorable du Gouvernement.
(Les amendements identiques n os 48 et 192 ne sont pas adoptés.)
Je suis saisie de plusieurs amendements, n os 107, 106, 105, 104, 13, 103, 14 et 15, pouvant être soumis à une discussion commune. Les amendements n os 13 et 103 sont identiques. La parole est à M. Bastien Lachaud, pour soutenir l’amendement n o 107.
Il est proposé de repousser la date d’application du texte. Vous ne pouvez pas, monsieur le ministre, d’un côté nous dire que ce projet de loi vise à rétablir la démocratie et, de l’autre, maintenir en l’état actuel une spécificité locale.
De deux choses l’une : ou bien vous mettez fin complètement au gel, et tout le monde peut voter, ou bien vous respectez la spécificité locale que prévoit l’accord de Nouméa – qui, je le rappelle, est toujours en vigueur et qui dispose clairement que ses dispositions perdurent tant qu’il n’y aura pas d’accord entre les parties. Vous prétendez que nous ne sommes pas prêts à gouverner ; malheureusement, c’est vous qui gouvernez, mais je ne suis moi non plus pas sûr que vous y soyez prêt. Regardez la situation en Nouvelle-Calédonie : c’est tout de même votre gestion du dossier qui nous a, hélas, menés là. Monsieur le ministre, je sais que votre téléphone portable est sûrement plus important que la représentation nationale…
En l’occurrence, tout à fait !
Et il acquiesce ! Madame la présidente, vous l’aurez noté. (Mouvements divers.)
Vous n’êtes pas le centre du monde ; mais peut-être n’étiez-vous pas au courant ?
Vous êtes ici pour répondre à la représentation nationale !
Pourquoi ne voulez-vous pas nous donner le nombre d’électeurs inscrits dans cinq ans et dans dix ans si ce projet de loi était adopté ? Ne les connaissez-vous pas ou refusez-vous de nous les donner, et dans ce cas pourquoi ? Expliquez-vous, au moins !
La parole est à M. Antoine Léaument, pour soutenir l’amendement n o 106.
Il vise à décaler la date du vote de la loi organique organisant les prochaines élections. Votre logique, monsieur Darmanin, consiste à instaurer un rapport de force en imposant une épée de Damoclès au-dessus de la tête des éventuelles parties à une négociation future. Nous prônons la logique inverse : laisser davantage de temps aux parties afin de leur permettre de se réunir et de discuter du sujet. Comme vous le savez, je suis attaché aux textes constitutionnels et je me dois à ce titre, d’autant que nous débattons en ce moment d’un projet de loi constitutionnelle, de rappeler l’article 24 de notre Constitution, qui est très clair : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. » Je suis bien conscient du problème auquel se heurte l’Assemblée : votre gouvernement gouverne sans son appui, faute de vote de confiance. C’est une difficulté supplémentaire et pour ma part, je ne peux donc reconnaître à votre gouvernement une légitimité totale. Néanmoins, les institutions étant ce qu’elles sont, vous gouvernez. Or, comment pouvons-nous contrôler la véracité de vos propos si vous ne répondez pas aux questions de mon collègue Lachaud sur le corps électoral ? Vous nous demandez de voter un texte qui ne fait pas consensus entre les parties et qui n’a pas été négocié avec elles, contrairement à la logique de l’accord de Nouméa. Vous nous demandez d’adopter un texte qui engagera la Nouvelle-Calédonie dans un processus pendant les années à venir sans savoir quel sera l’effet de cette décision. Mais je me réjouis que des papiers viennent de vous être remis ; j’espère que vous nous en donnerez le contenu et qu’y figurent les réponses aux questions qui vous ont été posées, puisqu’elles n’étaient apparemment pas dans votre téléphone portable.
La parole est à Mme Sophia Chikirou, pour soutenir l’amendement n o 105.
La Nouvelle-Calédonie est un territoire très particulier au sein de la République, un territoire pas comme les autres. En premier lieu, ce n’est pas un département ; ensuite, il est internationalement reconnu comme étant encore occupé. L’ONU le classe dans les « territoires à décoloniser ». Vous dites que le peuple calédonien doit être un et indivisible et que tous les citoyens doivent pouvoir voter, quelle que soit leur histoire et quelle que soit la date à laquelle ils s’y sont installés, moyennant le délai minimum de dix ans. Mais la réalité, c’est qu’il y a deux peuples en Nouvelle-Calédonie, et non un seul peuple, un et indivisible. Cela peut ne pas plaire, mais c’est la réalité de la Nouvelle-Calédonie. Certains disent qu’il faut favoriser un peuple unique et faire de tous les Calédoniens des Français comme les autres. Mais ce n’est pas ce que veulent les Calédoniens ! J’en veux pour preuve les années de violences extrêmes qui émaillent le passé et qui les ont divisés. Ces « événements », on peut les appeler une guerre civile. Et puis, pendant des décennies, il y a eu la paix parce que tout le monde a accepté de participer au dialogue. On aurait ainsi pu éviter ce qui se passe depuis quarante-huit heures là-bas. Mais le Gouvernement français est sorti de l’impartialité qui avait été convenue en prenant parti et en forçant la main des intéressés pour essayer de mettre la pression au sujet du dégel du corps électoral, d’où les nouveaux troubles qui touchent la Nouvelle-Calédonie. C’est une conséquence tellement grave de ce projet de loi que la raison, le sens de la responsabilité, le sens de l’histoire (Exclamations sur plusieurs bancs des groupes RE et LR) devraient vous pousser à retirer le texte. Le Président de la République devrait appeler à la paix et le retirer ! (Applaudissements sur les bancs des groupes LFI-NUPES et GDR-NUPES.)
La parole est à M. Bastien Lachaud, pour soutenir l’amendement n o 104.
Un point me semble encore mal compris depuis le début du débat : c’est l’enjeu pour les Calédoniens que représente le dégel du corps électoral. En effet, pour les indépendantistes, pour le peuple kanak, la Nouvelle-Calédonie a été une colonie de peuplement. Hier, monsieur le ministre, vous avez évoqué les bateaux qui, accostant dans l’archipel, y apportèrent les maladies qui ont décimé le peuple premier. Des chercheurs travaillent sur le sujet : je pense notamment à Christophe Sand qui, dans un excellent livre intitulé Hécatombe océanienne , étudie ce qu’il appelle la dépopulation des îles du Pacifique. Il en conclut que le taux de dépopulation a parfois atteint 95 %. Ainsi, entre 1774, quand James Cook a abordé la Nouvelle-Calédonie, et l’arrivée des Français, 70 % à 75 % des Kanaks sont décédés.
Venez-en à l’amendement !
Prenons l’exemple de la vallée de Tiwaka : aujourd’hui peuplée d’une centaine de personnes, elle devait en compter de 30 000 à 60 000 avant que les Européens n’abordent l’archipel. Autrement dit, des centaines de milliers de Kanaks sont morts depuis l’arrivée des Européens en Nouvelle-Calédonie. À l’évidence, la question du peuplement est donc fondamentale. On ne peut comprendre la réaction des indépendantistes à ce projet de loi en ignorant le traumatisme qu’a été la colonie de peuplement.
Le traumatisme, c’est vous !
Colonie de peuplement et dépopulation, mises bout à bout, ont engendré chez ce peuple premier la peur de disparaître.
La parole est à M. Arthur Delaporte, pour soutenir l’amendement n o 13.
Cet amendement vise à repousser d’un an le délai d’adoption de la loi organique organisant les prochaines élections pour le renouvellement général du Congrès et des assemblées de province en le mettant en cohérence avec la date des élections la plus tardive évoquée par le Conseil d’État, c’est-à-dire dans dix-huit mois. C’est une proposition de bon sens parce que nous pourrions encore reporter l’élection d’un an si la loi organique était adoptée au plus tard le 1 er octobre 2025. Ce serait une manière de donner du temps au temps et d’aboutir aux solutions permettant la mise en place des nouvelles institutions en Nouvelle-Calédonie. Vous semblez croire, monsieur le Ministre, que je ne suis pas favorable à l’évolution du corps électoral : bien sûr que si ! Mais comme depuis le début du débat, je répète que nous sommes pour une évolution du corps électoral concertée et acceptée par tous. Permettez-moi par ailleurs de vous rappeler le point 11 du premier avis que le Gouvernement a demandé au Conseil d’État en novembre, sur la première version du projet de loi constitutionnelle : « Si les circonstances propres à la situation particulière de la Nouvelle-Calédonie sont toujours de nature à justifier l’existence d’un corps électoral spécifique, la compatibilité des règles en vigueur avec les engagements internationaux de la France est incertaine […]. » Cela ne veut pas dire qu’il y a un risque avéré d’inconventionnalité, mais qu’il y a un doute. Cette incertitude juridique peut conduire à décider de réviser la Constitution pour réformer le corps électoral, mais ne dites pas qu’il est absolument sûr qu’une élection organisée sous le format actuel serait forcément annulée par le juge. Enfin, vous prétendez qu’il faut rétablir la démocratie : est-ce à dire qu’il n’y a plus de démocratie en Nouvelle-Calédonie et, par conséquent, que les élus de Nouvelle-Calédonie sont illégitimes ? Je ne le pense pas.
La parole est à Mme Danièle Obono, pour soutenir l’amendement n o 103.
Dans le sillage des deux interventions précédentes, je commencerai par revenir sur l’histoire du peuplement du territoire de la Nouvelle-Calédonie, Kanaky, puisqu’hier, certaines interventions particulièrement insultantes ont laissé croire que les positions défendues par les indépendantistes relevaient de la xénophobie et du racisme. Ne pas comprendre l’histoire de cet archipel et les raisons pour lesquelles la question démographique est politique et même existentielle pour le peuple autochtone, c’est passer à côté du débat. Le collègue Lachaud a évoqué les conséquences des maladies, certes transmises involontairement, mais il s’y ajoute surtout l’action de l’État français qui, dès l’origine, a mené une politique de peuplement, y compris jusque dans les années 1970 quand la politique de Pierre Messmer consistait explicitement à peupler l’archipel avec « du Blanc ». C’est précisément la mémoire de cette politique qui fait craindre que le projet de loi ait pour effet de minoriser le peuple autochtone. Voilà pourquoi nous insistons sur la question des chiffres. Au reste, les représentants indépendantistes, loin d’avoir donné un quelconque quitus, ont demandé une étude d’impact sur l’évolution que produirait une modification du corps électoral s’il était étendu aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie depuis au moins dix ans. La démocratie, la citoyenneté et la liberté du suffrage ont bien valeur constitutionnelle, monsieur le ministre, mais d’autres éléments juridiques le sont aussi, en l’occurrence les dispositions de l’accord de Nouméa. La Cour de cassation a rappelé que les dispositions constitutionnelles ainsi que celles issues de la loi organique de 1999 ne sont pas limitées dans le temps et demeurent en vigueur. Cela fait aussi partie des principes constitutionnels qu’il faudrait respecter.
Je vous informe que la clôture du scrutin pour l’élection du juge suppléant à la Cour de justice de la République est annoncée dans l’enceinte du Palais. Le résultat du scrutin sera proclamé à l’issue du dépouillement.
Quel suspense ! (Sourires.)
6. Modification du corps électoral pour les élections au Congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
Nous en revenons à l’examen du projet de loi constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie.
La parole est à M. Arthur Delaporte, pour soutenir les amendements n os 14 et 15, qui peuvent faire l’objet d’une présentation groupée.
Les amendements n os 14 et 15 visent à reporter l’échéance avant laquelle doit être adoptée la loi organique nécessaire à la tenue des élections provinciales, respectivement au 1 er juillet 2025 et au 1 er mars 2025. Je vous propose de choisir l’une de ces deux dates, qui sont certes plus rapprochées que celle qui figure dans mon amendement n o 13, mais qui laissent davantage de temps que celle du 1 er octobre 2024. Pour en revenir à la question démocratique, un problème d’égalité devant le suffrage, comme l’écrit le Conseil d’État dans son avis du 7 décembre 2023, se pose – personne ne le nie. Cependant, si le droit de vote en vigueur en Nouvelle-Calédonie pour les élections provinciales déroge à des principes constitutionnels, il est lui-même de valeur constitutionnelle. Nous devons réviser la Constitution, mais il s’agit de principes de rang équivalent, la dérogation ayant été elle-même acceptée et constitutionalisée – en raison des nécessités locales –, comme le rappelle l’ensemble des juridictions, dont le Conseil d’État. Vous affirmez, monsieur le ministre, que cette situation n’est pas démocratique ; je crois au contraire que ce dispositif, reconnu par la Constitution, est le fruit de la souveraineté populaire, le résultat d’une volonté qui s’est exprimée dans un cadre démocratique.
Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
Après deux jours de débat, nous convenons enfin qu’un problème d’égalité des citoyens devant le suffrage se pose. On progresse !
Je l’ai dit depuis le début, vous ne m’avez pas écouté !
Ce n’est pourtant pas ce qu’il semblait hier, quand vous donniez l’impression de ne pas savoir pourquoi ce texte était soumis au Parlement. (Mme Sophia Chikirou s’exclame.) Quant à M. Lachaud, je suis désolé de lui dire qu’il n’est pas le centre du monde – lui qui regarde également son téléphone, sans doute à propos d’un autre sujet. Dans mon cas, j’essayais de m’enquérir de l’opération Épervier lancée après la mort de trois agents pénitentiaires ce matin – en tant que ministre de l’intérieur, monsieur Lachaud, je peux aussi m’intéresser à la sécurité des Français. Quoi qu’il en soit, ce que vous pensez de la façon que j’ai de travailler avec mes collaborateurs ne m’intéresse pas. (Mme Danièle Obono s’exclame.) En revanche, ce qui m’intéresse, pour vous répondre, monsieur Léaument, c’est que les huit amendements en discussion commune – hormis ceux de M. Delaporte, dont je salue la cohérence – n’ont rien à voir avec ce que vous avez évoqué lors de votre prise de parole. C’est dommage, parce que l’amendement n o 107 de Mme Panot que vous avez d’abord défendu prévoit – je le dis à l’intention de ceux qui nous écoutent et qui n’ont pas nécessairement le texte des amendements sous les yeux – de reporter jusqu’au 1 er octobre 2029 le vote de la loi organique qui définira les mesures nécessaires à l’organisation des élections. Si cet amendement était adopté, non seulement il n’y aurait pas d’élections en 2024, mais il n’y en aurait pas non plus en 2025, ni en 2026, ni en 2027, ni en 2028 ; il faudrait attendre 2029 ! Ainsi, nous ne pourrions pas organiser deux élections provinciales, ce qui porterait le mandat des actuels élus à quinze ans ! Chacun voit que ce n’est pas raisonnable.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq
Votre intention de reporter les élections en 2029 montre que vous avez envie non pas de discuter du fond, mais plutôt de faire de l’obstruction parlementaire. Avis défavorable. (M. Arthur Delaporte demande la parole à Mme la présidente.)
Monsieur Delaporte, vous avez déjà présenté trois amendements, j’ai donné cinq fois la parole à des membres de La France insoumise... (Exclamations sur les bancs du groupe LFI-NUPES. – Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe RE.) Soyez très bref !
J’ai défendu deux amendements différents en trente secondes ! Je souhaitais simplement répondre au ministre qui prétend que c’est la première fois que j’exprime des réserves, en lui relisant ma déclaration d’hier après-midi (Protestations sur quelques bancs du groupe RE) : « Disons-le une bonne fois pour toutes : personne ne conteste que les règles actuelles doivent être révisées car elles comportent leur lot d’injustices. […] Si l’on doit effectivement réfléchir, au nom du principe d’égalité auquel nul ne s’oppose, au dégel du corps électoral, la restriction a de fait, elle aussi, une nature constitutionnelle. Nous devons donc ici concilier plusieurs principes à valeur constitutionnelle. » Voilà ce que j’ai dit hier, monsieur le ministre,…
Ce n’est pas ce que vous avez dit !
…et que vous prétendez ne pas avoir entendu depuis le début du débat. Je vous invite donc à m’écouter un peu plus attentivement.
(Les amendements n os 107, 106, 105 et 104, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
(Les amendements identiques n os 13 et 103 ne sont pas adoptés.)
(Les amendements n os 14 et 15, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
La parole est à Mme Sophia Chikirou, pour soutenir l’amendement n o 108.
Monsieur le ministre, nous ne faisons pas d’obstruction. (« Oh ! » sur plusieurs bancs des groupes RE et Dem.)
Si, ça s’appelle comme ça !
Ce que nous faisons, c’est permettre à tous nos concitoyens qui s’intéressent à la Nouvelle-Calédonie de bien mesurer et comprendre nos arguments ;…
Vous répétez en boucle les mêmes arguments depuis le début !
…c’est porter ici la parole de ceux qui ne l’ont pas ; c’est dialoguer et faire avancer la discussion, car il n’y a pas de meilleure façon de faire. Contrairement à hier, le rapporteur ne s’exprime plus, ce qui fait baisser la tension. Le fait qu’il ne tienne plus, comme hier, des propos provocateurs et incendiaires, permet à la discussion de mieux se dérouler. C’est une bonne chose et une bonne décision pour aider à l’apaisement.
Super ! Vous êtes extraordinaire !
Quand on ne vous répond pas, ça marche mieux ! Vous êtes les démocrates du monologue !
D’autre part, à propos du sens de l’histoire – et dès lors qu’on évoque la Nouvelle-Calédonie, on convoque l’histoire –, si nous faisons référence à la colonisation et aux peuples présents en Nouvelle-Calédonie – notamment au peuple kanak, qui est le peuple premier –, c’est parce que ce peuple est assez extraordinaire : il est capable d’une résilience fabuleuse. Le peuple kanak l’affirme clairement : nous reconnaissons qu’il y a des victimes de l’histoire sur la terre de la Nouvelle-Calédonie, et que des gens s’y trouvent qui n’ont pas demandé à y venir, mais qui ont été victimes de déportation – dans le cas des bagnards – et de déportation politique. Vous évoquiez hier, monsieur le ministre, l’insurrection de la Commune de Paris en 1871 et l’insurrection de la Kabylie face à la colonisation. Cela m’a fait très plaisir de vous entendre à ce sujet, parce que je suis élue de la circonscription de Ménilmontant, où se sont justement croisés Louise Michel (Applaudissements sur quelques bancs du groupe LFI-NUPES) et le leader de l’insurrection kabyle, Cheikh El Haddad. Pour moi, cette histoire est très importante… (Mme la présidente coupe le micro de l’oratrice, dont le temps de parole est écoulé.)
Madame Chikirou, c’est vrai que vous ne faites pas d’obstruction, puisque votre amendement consiste à remplacer « interruptifs de » par « considérés comme interrompant ». (Sourires.)
La parole est à M. Bastien Lachaud.
Monsieur le ministre, je pense que le débat mérite mieux que des réponses de ce niveau.
On est d’accord !
Je tiens à votre disposition l’amendement de M. Metzdorf déposé au Congrès de la Nouvelle-Calédonie dimanche, qui remplace un f minuscule par un f majuscule, et qui supprime deux virgules. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LFI-NUPES.) Je pense que M. Metzdorf a voulu non pas faire de l’obstruction, mais défendre ses idées. Ce que M. Metzdorf a fait au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, souffrez que nous le fassions à l’Assemblée nationale ! (« Bravo ! », « Exactement ! » et applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NUPES.)
(L’amendement n o 108 n’est pas adopté.)
La parole est à Mme Danièle Obono, pour soutenir l’amendement n o 112.
Nous assumons de vouloir prendre le temps du débat (« Ah ! » sur quelques bancs du groupe RE) , quand vous vouliez en faire une formalité parlementaire, alors que chacun reconnaît que c’est un sujet sensible, qui mérite une discussion politique de qualité. S’agissant de l’objection du ministre – qui semble découvrir au fur et à mesure ce que nous disons depuis le début, comme l’a souligné le collègue Delaporte –, personne, y compris les parties prenantes en Nouvelle-Calédonie, ne considère que l’état actuel du troisième corps électoral – spécificité issue de l’histoire – doit demeurer ad vitam æternam . Lors du XIV e comité des signataires de l’accord de Nouméa, qui s’est tenu le 4 février 2016, les indépendantistes ont accepté que le corps électoral citoyen puisse être ouvert aux natifs du pays, y compris ceux n’ayant pas de parents citoyens. Il était normal que ces natifs, qui votaient aux référendums, puissent voter aux élections provinciales. Les parties prenantes ont alors renoncé à introduire des recours contentieux, convenant que le litige était « politiquement clos » – je reprends l’analyse du juriste Mathias Chauchat, qui montre que la question de l’évolution de ce corps électoral était posée de longue date et que des réponses avaient été proposées. Si vous n’aviez pas choisi de faire dérailler le processus, et de passer en force, ces discussions auraient peut-être abouti. Tel est l’objet de nos interventions. En voulant imposer ce projet de loi constitutionnelle, vous allez à l’encontre d’un processus qui aurait pu – et dû –, depuis quelques années, permettre une évolution de ce corps électoral, quels que soient les résultats des référendums. Il est nécessaire de le rappeler devant la représentation nationale, parce que les débats qui s’y tiennent font foi. De la part du groupe La France insoumise et de ceux qui s’opposent à ce texte, il n’y a pas de refus de la démocratie ; de votre côté, en revanche, il y a une volonté de passer en force. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LFI-NUPES.)
Je souhaite poursuivre le propos de ma collègue, et achever celui que je n’ai pu terminer tout à l’heure. Sur le sujet qui nous occupe, prendre le temps de discuter et de rappeler l’histoire, c’est participer à construire la suite. Je rappelais comment Louise Michel et les communards avaient été déportés en Nouvelle-Calédonie après l’insurrection parisienne de 1871. Vous imaginez à quel point nous revendiquons cette histoire, dont nous sommes les héritiers, et qui nous lie pour toujours à la Nouvelle-Calédonie. D’autre part, pour ceux qui ont, comme moi, des origines de l’autre côté de la Méditerranée – notamment en Kabylie –, l’insurrection kabyle, qui a eu lieu au même moment que l’insurrection parisienne, et qui a été réprimée avec autant de barbarie et de sauvagerie – il y a eu des milliers de morts –, a conduit à la déportation de plus de 5 000 insurgés kabyles en Nouvelle-Calédonie. Insurgés kabyles et insurgés parisiens se sont ainsi retrouvés en Nouvelle-Calédonie, ont sympathisé, et sont devenus des frères, comme l’écrira Louise Michel – leur histoire durant jusqu’à la mort de cette dernière, elle qui s’était liée à Cheikh El Mokrani et à Cheikh El Haddad. Les opprimés de ce monde, ici les communards de Paris, là-bas les colonisés de Kabylie, se sont retrouvés aux côtés du peuple kanak, et ont appris à se connaître, à devenir frères ensemble. Aujourd’hui, ils font tous partie de l’histoire commune de la Nouvelle-Calédonie.
C’est bien, ça !
Tous ont eu affaire, d’une certaine façon, au même oppresseur. Oui, l’histoire de la Nouvelle-Calédonie est douloureuse et mérite une forme de démocratie où la parole prenne toute sa place, et où le temps de la discussion et de la compréhension des blessures doive être accordé. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NUPES. – M. Marcellin Nadeau applaudit également.)
M. Philippe Gosselin
C’est bien tout le processus depuis vingt-cinq ans !
Vous n’avez pas un truc à raconter sur Louise Michel, monsieur Gosselin ?
Madame Chikirou, vous avez été excellente. (M. Antoine Léaument applaudit.) Je vous remercie profondément d’avoir défini, comme on le fait depuis le début, le peuple calédonien :…
…des Kabyles, des communards, des Wallisiens et des Futuniens, poussés là par les aléas de l’histoire…
J’ai aussi parlé des oppresseurs !
…et qui se sont associés avec les Kanaks. Tout au long des deux derniers siècles, ces communautés se sont mélangées, et ont constitué ce qu’on appelle aujourd’hui, dans toute la classe politique – même s’il n’est pas reconnu par la Constitution –, le peuple calédonien. C’est ce peuple calédonien, tout mélangé, qui est allé voter et a choisi par trois fois de rester français. (Protestations sur plusieurs bancs du groupe LFI-NUPES et sur quelques bancs du groupe Écolo-NUPES.)
Ce n’est pas si simple !
Ce peuple calédonien, dans sa large majorité, toutes ses composantes confondues, souhaite aujourd’hui retrouver les voies de la démocratie. Merci d’avoir reconnu et souligné son existence ; respectez à présent son choix démocratique. Avis défavorable. (Applaudissements sur les bancs des groupes RE, LR et Dem.)
(L’amendement n o 112 n’est pas adopté.)
La parole est à M. Antoine Léaument, pour soutenir l’amendement n o 109.
Si nous voulions faire de l’obstruction, nous nous y prendrions un peu différemment.
Vous répétez en boucle les mêmes choses !
Nous essayons de débattre sur le fond. Parler de la Nouvelle-Calédonie, c’est parler de la République. Vous nous avez reproché à plusieurs reprises, monsieur Darmanin, de ne pas être universalistes, au motif que nous voudrions que certains principes s’appliquent ici, mais ne s’appliquent pas là-bas. En réalité, c’est l’inverse. Nous défendons des principes universalistes, notamment le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Nous défendons le principe que la France ne doit pas être une puissance coloniale. Nous défendons aussi l’idée que l’égalité républicaine, en France, se définit à partir de la citoyenneté.
Il faudrait savoir !
C’est la raison pour laquelle nous considérons que l’absence de dégel du corps électoral pose un problème. Mais, dès lors que la France a reconnu qu’il y a deux peuples, puisqu’il y a une situation coloniale, le seul moyen pour que la citoyenneté soit à même de définir l’égalité au sens où nous, républicains, l’entendons, c’est que des accords soient négociés entre les différentes parties. Prendre en compte l’identité kanak, c’est aborder en républicains les questions relatives à la Nouvelle-Calédonie. Je rappelle qu’il est question, dans l’accord de Nouméa, de la mise en place d’une citoyenneté calédonienne pouvant aboutir à une nationalité. La séparation entre nationalité et citoyenneté n’a pas toujours existé. Quand, en 1793, on invente la citoyenneté, elle est en même temps la nationalité : ce qui définit l’identité nationale française est la qualité de citoyen. La distinction entre citoyenneté et nationalité intervient plus tard, au début du XX e siècle, avant lequel il n’existe pas de carte d’identité. À travers le débat sur la Nouvelle-Calédonie, ce sont des principes fondamentaux de la République que nous souhaitons débattre. Nous ne pouvons pas décider, ici, à l’Assemblée nationale, de ce qui doit valoir pour le peuple kanak ; c’est à lui de décider. Et le dernier référendum ne saurait être tenu pour légitime, dans la mesure où plus de la moitié des Calédoniens, kanak et non kanak, n’a pas souhaité y participer. C’est la raison pour laquelle nous vous disons depuis le début qu’il faut revenir à des négociations entre les différentes parties, seul moyen de définir cette citoyenneté calédonienne dans un cadre accepté par tous.
Je regrette l’obstruction que pratique le groupe La France insoumise : les propos du député Léaument n’ont rien à voir avec l’amendement, qui vise à remplacer le mot « remplissant » par l’expression « qui remplissent ». (« Ah ! » sur les bancs du groupe RE.)
Nous déposons en effet des amendements rédactionnels pour pouvoir intervenir sur un sujet dont nous mesurons l’importance. (Exclamations sur les bancs du groupe RE.)
Obstruction !
S’il est besoin de vous rappeler à quoi ressemble l’obstruction, je vous renvoie aux deux batailles contre la réforme des retraites. Tout le monde se rappellera que cela n’avait rien à voir, même si le sujet était tout aussi important. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NUPES.)
On reconnaît votre savoir-faire et on ne va pas le tenter.
Monsieur le rapporteur, comme le disait mon collègue Léaument et contrairement à ce qui a pu être dit ou pensé, ce débat est d’intérêt général (Applaudissements sur quelques bancs du groupe LFI-NUPES) , car il pose les questions suivantes : qu’est-ce que faire nation ?
Selon La France insoumise !
Qu’est-ce que la citoyenneté ? Vous m’avez interpellée, sur les réseaux sociaux, à propos du droit de vote des résidents étrangers. C’est un grand sujet républicain, dont nous aurons peut-être le temps de discuter lorsque nous examinerons d’autres amendements au projet de loi constitutionnelle. Vous considérez que la démocratie sera retrouvée quand ce projet de réforme constitutionnelle sera entériné, comme si l’accord de Nouméa – et je peux le comprendre, de votre point de vue de non-indépendantiste – avait brisé la démocratie ou avait constitué un recul en la matière. Or l’accord de Nouméa – certes, ce n’est peut-être pas votre lecture de l’histoire –, en tant qu’élément d’un processus de décolonisation, en tant qu’il s’inscrit dans la déclaration reconnaissant l’identité du peuple kanak, sa nature de peuple premier – terme qui n’implique pas une hiérarchisation, mais qui correspond à une caractérisation politique et historique reconnue au niveau international – et ses droits, fait partie d’un processus démocratique. Cette vision est non pas un recul, mais une avancée. Votre point de vue loyaliste s’entend, mais il ne peut pas être celui de l’Assemblée nationale. C’est pourquoi nous vous interpellons et continuons à demander le retrait du texte, qui remet en cause le droit démocratique du peuple kanak. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NUPES.)
Je voudrais vous remercier pour vos interventions, grâce auxquelles j’apprends des choses sur la Nouvelle-Calédonie, moi qui n’en suis pas un spécialiste. ( « Ah ! » sur les bancs du groupe LFI-NUPES.) Notamment pour la vôtre, madame Chikirou, qui remet sur la table un principe que nous connaissons bien en France : le peuple premier franc – je ne sais pas si l’on peut l’appeler ainsi – n’existe pas. Nous sommes tous issus de l’immigration, nous sommes tous des sang-mêlé et des sangs mélangés. (Exclamations sur les bancs du groupe LFI-NUPES.) Eh oui ! Et c’est tant mieux ! Mais je voudrais vous demander de clarifier vos positions, car il y a une différence entre la position de Mme Chikirou, qui a bien expliqué que le peuple kanak, s’il est un peuple premier, est au moins mélangé avec les Kabyles et les communards français envoyés en Nouvelle-Calédonie, et celle de M. Léaument, pour qui le peuple kanak est celui d’avant cette invasion.
C’est honteux, ça n’a rien à voir !
Vous avez tout confondu, collègue Millienne ! Nous allons vous réexpliquer !
La parole est à M. Philippe Gosselin.
On va éviter de remettre cent balles dans la machine, pour parler trivialement. (M. Arthur Delaporte applaudit.) Des choses intéressantes se disent aujourd’hui – je ne vais pas en faire la synthèse, nous ne sommes pas au bout de nos débats ni de nos peines. Mais, quand les uns ou les autres se laissent un peu aller, et je reprends les propos de Mme Chikirou, l’approche devient binaire. Oui, il y a un peuple autochtone, personne ne le nie.
Oui, il y a eu des ombres et des lumières, personne ne le nie. C’est ce qui fonde même une partie de nos débats et de nos interventions depuis vingt-six à trente ans. Personne ne le conteste aujourd’hui. Nous sommes à la fin d’un processus, l’application du titre XIII de la Constitution arrivant à son terme. Cela ne veut pas dire pour autant que la méthode elle-même doit changer. Il faut encore avancer. Quand vous dites, madame Obono, que la France nie ce processus républicain et, d’une certaine façon, s’assoit sur la démocratie, c’est faux.
Non pas la France, mais le rapporteur !
C’est au contraire ce qui nous réunit depuis vingt-cinq ans. C’est le rééquilibrage politique, c’est le rééquilibrage économique.
Ça n’a pas marché !
C’est le rééquilibrage des élites, avec la création de plus de 400 cadres. Il s’agit d’une communauté particulière, mais la Nouvelle-Calédonie est désormais un peu à l’image de la France moyenne. Les gens ne gagnent plus leur vie de la même manière qu’avant. Les sangs se mêlent, puisque le taux de mariages mixtes est passé de 6 ou 7 % à 14 ou 15 % – c’est peut-être encore trop peu, mais c’est un exemple concret. Une grande partie des Kanaks habite à Nouméa, dans des quartiers qui ne sont pas uniquement des quartiers populaires ou en difficulté. Il faut avoir conscience de tout ce processus. Or, si l’on vous écoute, sans mauvais jeu de mots ni référence raciste à la couleur de peau, c’est d’un côté noir et de l’autre blanc.
La réalité est beaucoup plus complexe que la vision très binaire et artificielle que vous proposez. Ayez la sincérité et la simplicité de le reconnaître, afin que les débats puissent avancer. (Applaudissements sur les bancs du groupe LR.)
Rappel au règlement
La parole est à Mme Sophia Chikirou, pour un rappel au règlement.
Je le formule sur le fondement de l’article 70, alinéa 3, du règlement : je ne veux pas qu’on me fasse dire ce que je n’ai pas dit. Les historiens et les Calédoniens risqueraient de m’en vouloir, s’ils prenaient à la lettre les propos que vous avez cru comprendre.
Je suis trop nul, j’ai toujours été un mauvais élève !
Je n’ai jamais été professeure et je suis certainement mauvaise pédagogue, mais je ne dis pas que le peuple calédonien est un seul peuple. Je dis que les Kanaks reconnaissent eux-mêmes, avec une capacité de résilience incroyable et selon moi admirable, qu’il y a des victimes de l’histoire et qu’elles doivent être prises en compte dans le processus et l’histoire que nous voulons bâtir. Je tenais à rectifier ces propos.
(L’amendement n o 109 n’est pas adopté.)
La parole est à M. Antoine Léaument, pour soutenir l’amendement n o 111.
Ce n’est pas la première fois dans notre histoire que la République – ou ce qui n’était pas encore la République, car il s’agissait à l’époque de l’Assemblée nationale sous la monarchie constitutionnelle en formation – proclame des principes qui s’opposent à une réalité matérielle. Lorsque nos ancêtres ont adopté la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen le 26 août 1789, les colons d’alors ont demandé qu’elle ne s’applique pas, notamment en Haïti, Saint-Domingue à l’époque. C’était pour eux une nécessité puisque cette Déclaration – et non pas la Constitution de la V e République comme vous l’avez dit hier – proclamait dans son article 1 er que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. L’esclavage était dès lors impossible. Notre histoire nationale, et même l’histoire de notre drapeau tricolore, a partie liée avec les luttes en Haïti. Ceux qui s’y sont battus pour l’application de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ont eu une influence directe sur ce qui s’est passé dans l’Hexagone. Le pouvoir politique a décidé d’envoyer des navires mater ceux qui se rebellaient au nom de ces principes. Les navires devaient partir sous un drapeau blanc, mais la question est arrivée à l’Assemblée nationale, et voici Mirabeau…
M. Bruno Millienne et M. Charles Sitzenstuhl
Ça n’a aucun rapport !
…qui prend la parole pour dire qu’il faut remplacer le drapeau blanc de la monarchie, celui de la gloire par la guerre, par le drapeau qui sera « celui de la sainte confraternité des peuples, des amis de la liberté sur toute la Terre, comme la terreur des conspirateurs et des tyrans ». Nous sommes le 21 octobre 1790 ; ce jour-là, l’Assemblée nationale décide pour la première fois que l’on adoptera le drapeau tricolore – rouge, blanc, bleu, pour la petite histoire –, sur les navires de la marine française.
Ce n’est pas de l’obstruction ?
Voilà comment le drapeau tricolore lui-même vient d’un conflit entre des principes, comment il vient d’une grève antiraciste des marins bretons…
M. Jimmy Pahun
Ah, les Bretons !
…qui ont refusé de partir mater les Haïtiens. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NUPES.)
Je vous remercie, monsieur Léaument.
Je voudrais juste finir ce point important, madame la présidente… (Mme la présidente coupe le micro de l’orateur.)
Certes, mais cela fait plus de deux minutes que vous vous exprimez.
La parole est à M. Charles Sitzenstuhl, pour un rappel au règlement.
Nous avons des débats très importants et très intéressants, et nous sommes plusieurs ici à apprécier l’histoire. Mais nous sommes dans le cadre de travaux parlementaires, et l’article 54, alinéa 6, du règlement indique : « L’orateur ne doit pas s’écarter de la question, sinon le président l’y rappelle. »
M. Ugo Bernalicis et M. Antoine Léaument
C’est bon, on l’a déjà lu hier !
Pour que les débats puissent avancer sereinement, il faudrait au moins que les rappels historiques concernent la Nouvelle-Calédonie.
La colonisation, c’est le sujet !
Ce qui a été dit était intéressant, mais très éloigné de la question dont nous débattons. (M. Daniel Labaronne applaudit. – Exclamations sur les bancs du groupe LFI-NUPES.)
Je n’ai pas pu finir, c’est pour ça ! (Sourires.)
La parole est à Mme Aude Luquet.
Mme Aude Luquet
Je voudrais en appeler à la responsabilité de nos collègues du groupe La France insoumise.
C’est peine perdue !
Nous avons envie de débattre, mais nous n’avons pas envie d’examiner des amendements qui sont complètement hors sujet. Notre responsabilité commune est d’accompagner le peuple calédonien. Or, une fois de plus, en cette fin de journée, ce n’est pas ce que vous faites. Je ne pense pas que, si l’on nous regarde de Nouméa, du Grand Nouméa, du Mont-Dore, de Koné, de Maré, des îles Loyauté, on ait le sentiment que ces amendements nous permettent d’avancer sur la question du dégel du corps électoral et sur les questions qui nous importent. (Mme Maud Petit applaudit.) Nous devons, en notre responsabilité de parlementaires, avancer sur ce texte, en évitant de tels amendements, totalement hors sujet, qui ne servent qu’à vous faire plaisir.
Ce n’est pas à vous qu’il revient de juger de nos amendements !
Je tenais à dire à notre collègue Luquet que nous aurions été ravis de discuter de ses amendements… si elle en avait déposé.
Mme Maud Petit
C’est nul !
C’est tout petit !
M. Matthias Tavel
C’est la vérité !
Oui, c’est la vérité. Monsieur Gosselin, je n’ai pas l’impression que nous ayons une vision binaire des choses.
Vous nous parlez de l’accord de Nouméa, du rééquilibrage politique, économique, etc.
C’est une réalité !
La réalité, c’est que cela figure dans le texte de l’accord de Nouméa. Mais quel est le résultat du rééquilibrage économique, vingt-cinq ans après ? Sept chômeurs sur dix, 71 % des pauvres, 69 % des jeunes sans emploi ni formation (M. Antoine Léaument applaudit) et 90 % des détenus de la prison de Nouméa sont kanak, alors que les Kanaks ne représentent que 40 % de la population. Si le rééquilibrage a commencé, il est loin d’être arrivé à son terme.
Nous n’avons pas dit le contraire !
Quel rapport avec le texte ?
La situation coloniale perdure, tout simplement parce que le rééquilibrage – qu’elle a rendu nécessaire – n’est pas allé à son terme. Vous estimez que nous sommes arrivés à la fin d’un processus. Certes, les trois référendums ont eu lieu, même si le troisième est contesté, mais que dit l’accord de Nouméa ? Il dispose que tous les acquis sont irréversibles.
Ils sont irréversibles et garantis constitutionnellement. Or le gel du corps électoral est inscrit dans l’accord de Nouméa, donc garanti par la Constitution. C’est un principe irréversible tant que les parties n’ont pas validé un nouvel accord. C’est pourquoi le projet de loi constitutionnelle viole l’accord ! (Applaudissements sur les bancs des groupes LFI-NUPES et GDR-NUPES.) Nous sommes en train de tordre le cou à l’accord de Nouméa, alors que nous devrions créer les conditions d’un nouvel accord en envoyant une mission du dialogue. Je sais que vous y êtes favorable, monsieur Gosselin. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes LFI-NUPES et GDR-NUPES.)
(L’amendement n o 111 n’est pas adopté.)
Je vous indique le résultat du scrutin pour l’élection d’un juge suppléant à la Cour de justice de la République – le suspense est intenable. Nombre de votants : 147 Nombre de suffrages exprimés : 125 Majorité absolue : 63 Mme Blandine Brocard a obtenu 125 voix. (Applaudissements sur les bancs des groupes RE, Dem et HOR. – M. Arthur Delaporte applaudit également.)
Quelle surprise !
Elle a donc obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Je la proclame juge suppléante à la Cour de justice de la République. La conférence des présidents a fixé sa prestation de serment à demain, mercredi 15 mai, à quinze heures.
M. Julien Bayou
En attendant la suppression de la Cour de justice de la République…
8. Modification du corps électoral pour les élections au Congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
La parole est à Mme Danièle Obono, pour soutenir l’amendement n o 110.
Il s’agit encore d’un amendement rédactionnel. La question posée est celle du dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, territoire toujours en situation de décolonisation. Il faut continuer à parler de décolonisation, puisque plusieurs collègues ne comprennent pas bien et confondent un certain nombre de choses. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe Dem.) Madame Luquet, peut-être n’étiez-vous pas là hier, mais nous avons présenté des amendements relatifs à un dégel partiel, qui reprenaient d’ailleurs les propositions de partis calédoniens. Ils ont été rejetés.
C’est la démocratie !
Acceptez la démocratie parlementaire !
Mais ils l’ont été sans que vous exprimiez le moindre avis sur le sujet. Vous conviendrez que votre participation au débat parlementaire est limitée. Pour notre part, nous réfléchissons à différentes perspectives et nous voulons débattre car, je le répète, le débat est important. Relisez ceux qui ont eu lieu dans cette assemblée sur le même sujet, il était déjà question de citoyenneté, et du peuple calédonien ! Monsieur Gosselin, relisez également la déclaration finale de Nainville-les-Roches, acceptée par les indépendantistes mais refusée par les non-indépendantistes, dits loyalistes. Elle représente un précédent par rapport aux autres processus de décolonisation ou de lutte de libération nationale.
Dans cette déclaration, et dans une perspective d’émancipation, le peuple kanak, peuple autochtone – le terme est précisément défini par l’ONU –, reconnaît les oubliés de l’histoire dont parlait ma collègue Chikirou. Il reconnaît l’appartenance de toutes ces communautés et populations à un destin commun. C’est la force de ce processus, et l’un des points sur lequel les acteurs se sont appuyés pour aboutir à l’accord de Nouméa. Cela justifie aussi le périmètre du corps électoral référendaire et celui des élections au Congrès et aux assemblées de province. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NUPES. – M. Marcellin Nadeau applaudit également.)
La parole est à M. Antoine Léaument.
Je vais finir ma petite histoire (Exclamations sur quelques bancs des groupes RE et Dem), que j’aurais préféré conter d’une traite, précisément parce qu’elle a un rapport avec nos débats.
Il fallait être précis !
Les événements dont je vous ai parlé ont abouti à la création du drapeau tricolore – c’est une bonne chose, nous en conviendrons tous, d’autant qu’il affirme des valeurs antiracistes.
Cela n’a aucun rapport avec le texte !
Chacun d’entre nous doit se souvenir qu’on ne peut pas défendre le drapeau tricolore en prônant des valeurs racistes.
Ni antisémites !
En Haïti, donc, avec la cérémonie du Bois-Caïman et les révoltes contre l’esclavage, la lutte a abouti à une abolition de fait de l’esclavage. En 1794, en abolissant l’esclavage pour la première fois, sans indemnisation des propriétaires, la République française n’a donc fait que reconnaître une situation de fait, issue de la lutte.
Madame la présidente, cela n’a rien à voir avec le texte !
Dès le début de la Révolution, les débats avaient fait rage, car l’esclavage était en contradiction avec les principes fondamentaux proclamés dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – celle-là même qui est reproduite autour de la boule située dans la cour d’honneur de l’Assemblée nationale.
Plusieurs députés de la majorité
Mais arrêtez !
J’essaie simplement de vous expliquer que la République se retrouve parfois dans une situation de fait qui la met en difficulté vis-à-vis de ses principes. Or c’est exactement la situation dans laquelle nous sommes en Nouvelle-Calédonie ! (Applaudissements sur quelques bancs du groupe LFI-NUPES. – M. Marcellin Nadeau applaudit également.) C’est pourquoi nous devons analyser les choses avec beaucoup de finesse.
C’est votre cas ?
C’est vrai que c’est votre marque de fabrique !
C’est ce que nous essayons de faire, en dépit de vos cris d’orfraie. Monsieur Millienne, après avoir dit que vous n’y connaissiez rien, vous nous donnez des leçons de démocratie ! C’est un peu saoulant, si vous me passez l’expression.
Merci de bien vouloir conclure.
Il faut étudier les principes et aller au fond de ces principes. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe LFI-NUPES. – Protestations sur quelques bancs du groupe Dem.)
(L’amendement n o 110 n’est pas adopté.)
La parole est à Mme Sophia Chikirou, pour soutenir l’amendement n o 113.
Monsieur le ministre, revenons…
Aux communards ?
…au processus et à ce que ce projet de loi constitutionnelle provoque en Nouvelle-Calédonie depuis quarante-huit heures. J’imagine que personne ici n’affirmera qu’il faut obliger le peuple calédonien à renoncer à son droit fondamental à l’autodétermination. Je vous rappelle que la résolution onusienne du 4 décembre 1987 « déclare que, pour progresser vers une solution politique à long terme en Nouvelle-Calédonie, il faut un acte d’autodétermination libre et authentique – j’insiste sur ces deux termes – qui soit conforme aux principes et pratiques suivis par l’Organisation des nations unies en matière d’autodétermination et d’indépendance. » Or, en l’espèce, l’autodétermination semble entravée par le troisième référendum, qui a eu lieu à un moment où le peuple kanak était en deuil, selon sa tradition, à la suite de l’épidémie de covid-19, épidémie la plus grave du XXI e siècle, qui a coûté de nombreuses vies en Nouvelle-Calédonie. En raison de cette période de deuil coutumière, il ne pouvait ni faire campagne, ni prendre part à ce référendum. Pourtant, qu’a fait l’État français ? Il a décidé de violer la coutume du peuple kanak. Il n’a pas respecté ce peuple premier en lui imposant un référendum auquel il ne pouvait décemment pas participer. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe LFI-NUPES.) Autrement dit, dans la situation actuelle, le principe d’un processus d’autodétermination libre n’est pas respecté. C’est pourquoi les tensions sont d’une telle ampleur en Nouvelle-Calédonie. Depuis quarante-huit heures, vous avez rallumé la mèche avec ce projet de loi constitutionnelle ! (Exclamations sur quelques bancs du groupe Dem.) Le Président de la République dit… (Mme la présidente coupe le micro de l’oratrice.)
Les amendements doivent normalement être défendus en deux minutes. Vous débordez à chaque fois.
Parce que c’est passionnant !
Je vous laisse largement la parole.
Merci, madame la présidente ! (Mme Sophia Chikirou s’incline en joignant les mains.)
Défavorable. Madame Chikirou, votre exposé n’a aucun lien avec le dispositif de l’amendement. En outre, nous en avons déjà débattu en commission sur le projet de loi organique et je vous avais expliqué que votre présentation est erronée. Le covid-19 s’est propagé dans le monde – donc sur les territoires français – à partir du début de l’année 2020. Le premier tour des élections municipales a eu lieu, mais pas le second, chacun s’en souvient. Le confinement a suivi. Contrairement à ce que vous avez affirmé, madame Chikirou, ce n’est pas l’État qui a déclenché le troisième référendum ; ce sont les indépendantistes qui l’ont demandé, au Congrès de la Nouvelle-Calédonie,…
Ça, c’est vrai !
…où un vote des trois cinquièmes était nécessaire. Ce vote a été postérieur à la période du covid-19.
Ne confondez pas la date de la demande et la date du scrutin !
D’ailleurs, au lendemain du covid-19, quand les indépendantistes ont constaté que M. Metzdorf pouvait être battu dans sa circonscription aux élections législatives, ils se sont mobilisés – sans succès. C’est normal en démocratie, mais ils sont ainsi revenus sur leur refus de participer aux élections. Ne dites pas que nous avons déclenché le référendum car ce n’est pas vrai, et ceux qui nous écoutent pourraient croire que nous avons profité du covid-19 pour convoquer un scrutin. Je le répète, c’est après l’épidémie de covid-19 et après les vagues de confinement que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, où les indépendantistes sont majoritaires, a demandé la tenue du référendum. Il n’est pas utile de dire des contrevérités pour avoir raison. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe RE.)
M. Jean-René Cazeneuve
Nous allons compléter vos vérités, monsieur le ministre. À l’issue du XIX e et dernier comité des signataires, dispositif créé par l’accord de Nouméa pour « veiller au suivi de l’application de l’accord » selon les termes de son article 6.5, M. Édouard Philippe, alors Premier ministre, avait déclaré : « Nous avons exclu que cette troisième consultation puisse être organisée entre le milieu du mois de septembre 2021 et la fin du mois d’août 2022. Il nous est collectivement apparu qu’il était préférable de bien distinguer les échéances électorales nationales et celles propres à l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. »
Quel rapport ?
Tout le monde peut retrouver cette déclaration sur internet ; elle date du 19 octobre 2019. Il y avait donc un accord sur cette base. Pourtant, vous avez choisi d’organiser le référendum à la période précise où il ne devait pas avoir lieu !
Ce sont les indépendantistes qui l’ont demandé !
Ensuite, une partie à l’accord a exprimé son avis : en période de deuil kanak, il n’était pas possible d’organiser décemment un tel référendum, nécessitant des déplacements et prenant du temps.
Je le répète, ce sont les indépendantistes qui ont plaidé en ce sens !
En 2019, le Premier ministre, donc l’État français, s’était engagé sur un calendrier, mais celui-ci a été remis en cause.
Remis en cause par qui ?
Malgré l’avis d’une partie essentielle à l’accord, vous avez maintenu une date qui a ensuite complètement délégitimé le processus. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe LFI-NUPES.)
La parole est à M. le rapporteur.
Je me permets de répondre puisque j’ai été directement concerné à l’époque. Le ministre a raison, le troisième référendum a été demandé par les indépendantistes. Ensuite, pour obtenir la suspension de ce troisième référendum, ils ont argué du deuil kanak, qui devait durer un an, de novembre 2021 à novembre 2022. Pourtant, à l’approche des élections législatives de juin 2022, les indépendantistes ont déclaré que le deuil serait finalement plus court. D’ailleurs, beaucoup de Kanaks ont contesté cette instrumentalisation de la coutume à des fins politiques. En effet, en Nouvelle-Calédonie, coutume et culture kanak doivent être absolument séparées du champ politique. Malheureusement, les indépendantistes ont utilisé la coutume kanak pour mobiliser au moment des élections législatives…
C’est hallucinant !
…alors même qu’ils l’avaient utilisée auparavant pour demander le report du référendum ! (Protestations sur les bancs du groupe LFI-NUPES.) C’est mon histoire politique, et personnelle. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je la connais mieux que vous. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RE.)
Vous êtes de parti pris !
C’est de la provocation !
(L’amendement n o 113 n’est pas adopté.)
Sur l’article 1 er , je suis saisie par les groupes Renaissance, Rassemblement national et La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale d’une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. La parole est à M. Bastien Lachaud, pour soutenir l’amendement n o 114.
Il faut revenir sur la chronologie : les indépendantistes demandent la tenue d’un troisième référendum ; à l’issue du XIX e comité des signataires de l’accord de Nouméa, le Premier ministre Édouard Philippe annonce que le référendum aura lieu en 2022 pour que la politique nationale, en particulier l’élection présidentielle, ne s’immisce pas dans ce référendum local – très bien. C’est sur cette base que les indépendantistes ont déclenché le troisième référendum. Ensuite, le Gouvernement a décidé de l’avancer à 2021 – pourquoi pas, si tout le monde avait été d’accord.
Mais le covid-19 est arrivé en Nouvelle-Calédonie en 2021 – non pas en 2020 comme dans l’Hexagone, où il a entraîné un report de deux mois des élections municipales. Les indépendantistes ont alors demandé que l’on repousse le référendum en revenant au calendrier initial annoncé par Édouard Philippe. Pourquoi le Gouvernement a-t-il refusé ? Cela aurait été beaucoup plus simple d’accéder à cette demande, il n’y aurait pas eu de contestation. Vous avez décidé de refuser. Dès lors, vous devez assumer le fait que 56 % de la population calédonienne n’est pas allée voter et que, par conséquent, le résultat du référendum est contesté. Par ailleurs, le covid-19 ne peut pas faire l’objet du même traitement en Nouvelle-Calédonie et dans l’Hexagone. J’ai déjà évoqué l’hécatombe océanienne : entre 70 % et 95 % de la population océanienne a été décimée par des épidémies. Dans un pays qui a connu de telles pertes, une épidémie a une résonance culturelle plus forte qu’ailleurs. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LFI-NUPES.)
Évidemment !
Organiser un référendum à ce moment-là était incohérent. Le scrutin qui s’est tenu en 2021 ne peut tenir lieu de troisième référendum prévu par l’accord de Nouméa. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NUPES.)
Avis défavorable.
Nous connaissons et reconnaissons tous l’histoire et l’identité calédoniennes du rapporteur. Cependant, son positionnement politique pose problème.
Mais oui, évidemment !
C’est l’un des éléments qui ont alimenté la défiance des indépendantistes. Vous avez présenté les raisons qui, d’après vous, ont conduit ceux-ci – qui ne sont pas tous kanak – à demander que l’on respecte le deuil. Il ne s’agit que de votre interprétation, qui repose sur votre positionnement de loyaliste, de non-indépendantiste. Vous avez évoqué une histoire qui est aussi la vôtre. Or, précisément, vous vous trouvez dans une situation de conflit d’intérêts : vous ne pouvez pas incarner l’impartialité qui était jusqu’ici la position tenue par l’État, et qui consistait à ne favoriser aucune partie aux dépens des autres. La nomination de Mme Backès au Gouvernement – qui a eu lieu après le maintien du référendum en 2021, autrement dit après une première remise en cause du consensus qui était jusqu’alors de mise –, l’annonce du présent projet de loi constitutionnelle et votre propre nomination comme rapporteur posent problème. Deux interprétations de la coutume kanak et du rapport de ce peuple au deuil sont en concurrence : la vôtre, qui s’entend, et une autre, qui explique pourquoi la période choisie n’était pas propice à l’organisation du référendum. En outre, contrairement à ce que vous dites, les Kanaks eux-mêmes font le lien entre leur coutume et l’identité politique de leur peuple. Permettez-moi de citer une personnalité kanak – et non des moindres –, Jean-Marie Tjibaou, répondant à une question sur le peuple kanak, entendu au sens politique : « C’est une notion née de la lutte contre la colonisation, née de l’adversité. C’est une réaction collective, une réalité qui s’organise. » Il s’agit donc bien d’une expression politique, que vous niez lors même que vous prétendez l’interpréter. Votre point de vue est partisan. (Applaudissements sur les bancs des groupes LFI-NUPES et GDR-NUPES).
(L’amendement n o 114 n’est pas adopté.)
Je mets aux voix l’article 1 er .
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 208 Nombre de suffrages exprimés 205 Majorité absolue 103 Pour l’adoption 135 Contre 70
(L’article 1 er est adopté.) (Applaudissements sur quelques bancs des groupes RE, Dem et HOR.)
Article 2 (appelé par priorité)
L’article 2 contient la principale bizarrerie juridique de ce texte. Notre assemblée est appelée à voter une réforme constitutionnelle qui entrera en vigueur de façon différée ou n’entrera jamais en vigueur – en l’occurrence, il y a un précédent. Mais c’est la première fois que l’on prévoit qu’un accord local puisse remettre en cause une réforme constitutionnelle déjà entrée en vigueur et inscrite dans le dur de la Constitution !
Voilà ! C’est n’importe quoi !
Il s’agit d’une absurdité, d’une incohérence juridique absolue. Le Conseil d’État ne s’est prononcé que sur la première caducité, qui interviendrait avant l’entrée en vigueur de la réforme constitutionnelle. La seconde caducité, qui frapperait la réforme après son entrée en vigueur, est en effet un ajout du Sénat. Cet article est la preuve que vous mettez la charrue avant les bœufs. Le présent texte est un objet constitutionnel dur, qui fait peur et crée des tensions, lesquelles inquiètent tous les Calédoniens – je salue les députés calédoniens présents dans cet hémicycle.
Cet objet constitutionnel qui a provoqué le désordre pourrait, qui plus est, ne pas advenir. C’est le principal problème du texte : en créant des peurs et en cristallisant les tensions, il nous éloigne de l’accord qu’il était censé favoriser.
Bien parlé !
Votre stratégie s’est d’ores et déjà soldée par un échec : ce texte constitutionnel, qui comporte cette bizarrerie juridique, n’a réussi qu’à provoquer les tensions que nous connaissons. Il devait faciliter un retour au dialogue – comme l’expliquait Édouard Philippe lors de son audition –, mais c’est l’inverse qui s’est produit. Pour toutes ces raisons, le groupe Socialistes et apparentés est hostile à l’article 2, comme à l’ensemble du projet de loi constitutionnelle, qui ne fait que semer le désordre. (Applaudissements sur les bancs des groupes SOC et Écolo-NUPES. – M. Marcellin Nadeau applaudit également.)
En examinant cet article, on se rend compte que rien ne va dans ce texte. Il met à terre non seulement l’accord de Nouméa, dont il ne respecte ni l’esprit ni la lettre, mais aussi la hiérarchie des normes. À chaque réforme constitutionnelle, il y a toujours quelqu’un pour rappeler la même citation – je crois que, la dernière fois, c’est le Premier ministre qui l’a prononcée lors du Congrès : « Il ne faut toucher à la Constitution que d’une main tremblante. » Or, à la lecture de l’article 1 er , j’ai l’impression que la main du Gouvernement ne tremble pas du tout. D’autre part, le Sénat, habituellement réputé pour sa sagesse – on se demande ce qui lui a pris –, a décidé que la Constitution pourrait être balayée par un accord conclu entre partis politiques. Sommes-nous toujours dans une république ? (Applaudissements sur quelques bancs du groupe LFI-NUPES.) Il faut redevenir sérieux : nous ne pouvons pas accepter qu’une réforme votée par le constituant soit balayée par un accord politique. (Mêmes mouvements.)
En revanche, nous étions prêts à accepter que le constituant entérine un accord politique – c’est ce qui a eu lieu après l’accord de Nouméa.
Vous fonctionnez à l’envers : au lieu d’agir dans le cadre de l’accord de Nouméa pour obtenir un nouvel accord, vous préférez imposer et espérer. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe LFI-NUPES. – M. Arthur Delaporte applaudit également.) J’ai évoqué le comité des signataires de l’accord de Nouméa. La dernière réunion de ce comité a eu lieu en 2019, à l’initiative d’Édouard Philippe. Pourquoi n’a-t-il pas été réuni depuis ? Pourquoi n’avez-vous pas choisi ce cadre pour travailler à un accord politique global entre les parties calédoniennes ? Vous auriez pu aboutir à un consensus et nous ne serions pas dans la situation que nous connaissons ce soir dans cet hémicycle, et ces derniers jours à Nouméa et dans le reste de la Nouvelle-Calédonie. Vous êtes irresponsable, monsieur le ministre… (Mme la présidente coupe le micro de l’orateur, dont le temps de parole est écoulé. – Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LFI-NUPES. – M. Marcellin Nadeau applaudit également.)
Je suis saisie de trois amendements identiques, n os 16, 49 et 213, tendant à supprimer l’article 2. Sur ces amendements, je suis saisie par le groupe Socialistes et apparentés d’une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. La parole est à M. Jérôme Guedj, pour soutenir l’amendement n o 16.
M. Jérôme Guedj
Non seulement l’article 2 comprend une bizarrerie juridique, mais il porte aussi atteinte à la hiérarchie des normes, constitutive de notre république. Hier, lors de la discussion générale, j’ai rappelé que j’étais un universaliste républicain, mais que j’étais conscient que nous devions emprunter un autre chemin quand il est question de la Nouvelle-Calédonie. Depuis 1988, nous avons tenu compte des accords construits localement, ce qui nous a conduits à nous montrer moins exigeants en matière d’universalisme républicain. La reconnaissance de communautés et celle du peuple kanak, les dispositifs de discrimination positive ou de préférence territoriale vont en effet à rebours de ce principe. Avec l’article 2, vous inversez la hiérarchie des normes, au sommet de laquelle se trouve la Constitution, puisque vous introduisez la possibilité qu’un accord politique remette en cause le travail du constituant. Cela va à l’encontre de ce que vous psalmodiez en permanence, à savoir qu’il faut garantir le respect des principes républicains. Nous vous invitons à accepter que la bonne méthode, ce n’est pas le pistolet sur la tempe, mais le dialogue, le consensus, la production d’une convergence des positions que l’État républicain consacre a posteriori . En Nouvelle-Calédonie, aucune négociation n’a abouti sous la contrainte. (M. Arthur Delaporte applaudit.) C’est pourtant ce que vous essayez de faire aujourd’hui, ce qui entraîne immanquablement une crispation, des tensions et des violences. Monsieur le ministre, vous avez dit lors des questions au Gouvernement que vous souhaitiez le retour à la paix civile. Si tel est vraiment le cas, commencez par retirer ce texte et donnez le pouvoir aux négociateurs en vue d’aboutir à un accord global, qui est à portée de main. Ensuite, vous pourrez revenir devant nous pour que nous consacrions cet accord en l’inscrivant dans la Constitution. (Mme Sandra Regol applaudit.)
La parole est à Mme Danièle Obono, pour soutenir l’amendement n o 49.
Nous nous opposons à la méthode du Gouvernement qui, dans l’article 2, pose un ultimatum aux acteurs politiques calédoniens, en particulier aux indépendantistes. Cet article prévoit en effet que l’article 1 er , qui modifie le corps électoral, entrera en vigueur le 1 er juillet 2024, sauf s’il est constaté qu’un accord portant sur l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie est conclu entre les partenaires de l’accord de Nouméa. Initialement, le Gouvernement avait laissé à ceux-ci jusqu’au 1 er juillet 2024 pour aboutir à un tel accord ; le Sénat leur a donné une marge de manœuvre un peu plus grande en leur laissant jusqu’au dixième jour avant les prochaines élections provinciales. Si un accord était conclu dans le délai imparti, la présente réforme constitutionnelle n’entrerait pas en vigueur ou deviendrait caduque, et les élections seraient reportées afin de permettre l’adoption des mesures nécessaires à la mise en œuvre dudit accord. Malgré la souplesse introduite par le Sénat, nous ne pensons pas que l’article 2 soit nécessaire. Cela vaut pour la forme comme pour le fond. Il en va d’ailleurs de même de l’ensemble du projet de loi constitutionnelle. L’article 2 est surtout l’illustration de tout ce qu’il ne faut pas faire. Les précédents gouvernements et parlementaires s’en étaient jusqu’alors tenus à leur rôle de garants des conditions du dialogue entre les acteurs calédoniens. Emmanuel Macron a décidé de provoquer une rupture en prenant parti, dans ce débat, pour l’un des acteurs. Cela a été dit hier par l’un de nos collègues : sans tout comprendre à ce texte, il avait saisi que son objet était de mettre la pression. Or on ne peut pas faire une réforme constitutionnelle pour exercer une pression sur un acteur politique. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LFI-NUPES.) C’est l’expression d’un mépris non seulement pour notre norme suprême, qui doit instituer des principes de fond, mais également pour le peuple calédonien. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NUPES. – M. Jean-Victor Castor applaudit également.)
La parole est à Mme Sandra Regol, pour soutenir l’amendement n o 213.
Mme Sandra Regol
Puisque tout le monde est un peu fatigué et que les explications de mes collègues étaient excellentes, je serai relativement brève.
M. Pascal Lavergne
Depuis plusieurs heures, même plusieurs jours, nous vous répétons qu’il est nécessaire de laisser du temps au dialogue. Ce soir, en Nouvelle-Calédonie, la situation est tendue, pour ne pas dire explosive. Tout ce que demande ce peuple, c’est que vous ayez la dignité de laisser du temps supplémentaire. C’est la seule chose que nous vous demandons, depuis des heures, de façon répétée. Or, systématiquement, nous nous heurtons à un mur : celui du refus, du déni et de l’absence de réponse. Au moment où nous entamons l’examen de l’article 2, peut-être est-il temps, monsieur le ministre, de faire preuve de respect pour ce qui est en train de se passer et d’œuvrer à une désescalade, afin d’instaurer une meilleure communication et de progresser enfin. Ce serait tout à l’honneur de la France.
Quel est l’avis de la commission sur ces amendements de suppression ?
Permettez-moi de profiter de la présence de notre collègue Jean-Victor Castor, à l’égard duquel j’ai eu hier un mouvement d’humeur, pour lui présenter mes excuses. J’ai eu l’occasion, un peu plus tôt, de le faire de manière personnelle, mais puisque mon mouvement d’humeur était public, je tenais à ce que mes excuses le soient également. (Applaudissements sur les bancs des groupes RE, LFI-NUPES et SOC.) J’ai du mal à comprendre ces amendements de suppression, compte tenu de vos propos depuis le début de l’examen du texte.
C’est totalement incohérent !
Que vous soyez opposés à l’article 1 er , je l’entends, bien que je ne sois pas d’accord avec vous, mais l’article 2 consacre ce que vous revendiquez, à savoir un accord entre les Calédoniens avant le dégel du corps électoral. L’article 2 prévoit – c’est exceptionnel – que l’article 1 er serait caduc, même après la promulgation de cette loi constitutionnelle, si les Calédoniens, non indépendantistes et indépendantistes, trouvaient un accord au plus tard dix jours avant les élections provinciales. Vous vouliez un accord, vous vouliez du temps ; c’est précisément ce que prévoit cet article. Vous parlez de la hiérarchie des normes. Or vous avez défendu des amendements prévoyant un avis conforme du Congrès de la Nouvelle-Calédonie sur des projets de loi organique, ce qui pose également un problème de hiérarchie des normes. Soyez cohérents avec vous-mêmes ! Si vous souhaitez un accord et du temps supplémentaire, si vous voulez donner aux Calédoniens, jusqu’au bout, la possibilité de privilégier le dialogue, le consensus et les équilibres politiques, vous devez soutenir mordicus l’article 2. Avis défavorable sur ces amendements de suppression. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RE.)
À l’instar du rapporteur, j’ai du mal à comprendre les arguments présentés, mais je vais essayer d’y répondre. (Exclamations sur quelques bancs du groupe LFI-NUPES.) Monsieur Delaporte, à la tribune, vous avez dit que cette réforme constitutionnelle était particulièrement originale, ne connaissait pas de précédent et n’était pas cohérente avec le droit constitutionnel.
Encore une fois, ce n’est pas ce que j’ai dit !
Je résume, monsieur Delaporte, mon esprit est moins éclairé que le vôtre ! (Applaudissements sur quelques bancs du groupe LFI-NUPES.)
Enfin un peu de sincérité !
Heureux les simples en esprit ! Monsieur Delaporte, le droit constitutionnel est par lui-même créateur de choses très originales, comme l’a montré l’accord de Nouméa. C’est tellement vrai que M. Lachaud a défendu tout à l’heure un amendement tendant à inscrire le nom de Lionel Jospin dans la Constitution ! Certes, il s’agissait de lui rendre hommage, puisque l’accord de Nouméa avait été signé sous son égide. Vous avez vous-même proposé de nombreuses originalités dans vos différents amendements. Si nous avions adopté tous les amendements déposés par les groupes de la NUPES, nous n’aurions pas modifié la Constitution, mais créé le monstre de Frankenstein ! (M. Pascal Lavergne rit. – Mme Sophia Chikirou s’exclame.) Monsieur Delaporte, vous nous reprochez de faire preuve d’originalité, alors que vous avez vous-même défendu de nombreux amendements dénués de tout rapport avec la Constitution.
Une caricature de plus !
C’est le débat habituel entre ceux qui peuvent agir sur la Constitution et ceux qui ne le peuvent pas, parce qu’ils sont dans l’opposition. Plus sérieusement, le droit constitutionnel a prévu des choses très étonnantes. C’est précisément pour cela que nous sommes réunis, puisqu’il a notamment constitutionnalisé des tableaux électoraux pour des élections locales. Avouez qu’en matière d’originalité, le constituant de 1998 a été plus loin que nous.
M. Jérôme Guedj et M. Arthur Delaporte
Sans toucher à la hiérarchie des normes !
D’autre part, de même que M. Guedj, vous dites que l’application d’une disposition constitutionnelle n’a jamais été conditionnée. Or c’est tout à fait faux ! Je vous renvoie à la loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1 er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution, qui conditionnait le texte – pourtant voté par le Parlement réuni en Congrès – à l’entrée en vigueur d’un traité international. De précédentes réformes constitutionnelles prévoyaient donc déjà une conditionnalité. Nous aurons également ce débat à propos de la Corse, si nous allons au bout de la discussion constitutionnelle, ce que je souhaite, de même que pour la Nouvelle-Calédonie. En effet, les populations intéressées seront consultées postérieurement à la réforme constitutionnelle – ce que ne comprennent pas toujours les interlocuteurs avec lesquels j’ai le bonheur de discuter, qu’il s’agisse de mes amis calédoniens ou de mes amis corses.
Vous n’avez pas de vrais amis !
Ils suggèrent d’organiser la consultation de la population avant l’adoption de la réforme constitutionnelle, mais ce n’est pas ce que prévoit la Constitution. Depuis 1958, il y est écrit que nous devons d’abord modifier la Constitution, en conditionnant la pérennité de ces dispositions constitutionnelles à leur approbation, lors d’un référendum local, par les populations dites intéressées. Je le répète, la conditionnalité existe. En 2005, un texte a été conditionné à l’entrée en vigueur d’un traité européen.
Vous avez vu le résultat ! C’est ça, votre référence ? Ça inspire confiance !
D’autres textes l’ont été à l’approbation des populations intéressées. Tel a été le cas pour l’accord de Nouméa. Tel serait également le cas pour d’autres dispositions, relatives à tel ou tel territoire, qui nécessiteraient une modification de la Constitution. Quant au Conseil d’État, reconnaissez qu’il a sa petite expérience et sa petite utilité – comme le chantait Georges Brassens, « [Chacun] a quelque chose pour plaire / [Chacun] a son petit mérite ». (M. Gilles Le Gendre sourit.) Il est évidemment intéressant de s’y référer lorsqu’il conseille le Gouvernement à propos d’une modification de la Constitution. Je vous renvoie au point 10 de son avis sur le présent projet de loi constitutionnelle : « Afin de continuer de privilégier la recherche du consensus entre les parties prenantes comme mode principal de définition de l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, dont le Conseil d’État a rappelé l’importance dans son avis du 7 décembre 2023 […], le projet de loi constitutionnelle soumet l’entrée en vigueur de la révision constitutionnelle à l’absence de conclusion de l’accord, mentionné au point 2, entre les partenaires politiques de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998. » « Le Conseil d’État rappelle qu’il n’appartient qu’au pouvoir constituant de décider de la date et des conditions d’entrée en vigueur d’une loi constitutionnelle ». En l’espèce, c’est vous qui exercez le pouvoir constituant, le Gouvernement ne faisant que proposer. Je poursuis : « Il estime que si le constituant subordonne l’entrée en vigueur d’une disposition constitutionnelle à la survenance d’un événement extérieur, cet événement doit avoir un caractère matériellement certain permettant d’en constater l’occurrence sans ambiguïté ni marge d’appréciation. » C’est pour cette raison, madame la présidente, que nous avons accepté l’amendement sénatorial visant à ce que le président du Sénat et la présidente de l’Assemblée – non pas le Gouvernement ni les parties calédoniennes – constatent qu’un accord a été conclu. Nous répondons ainsi point pour point à la remarque formulée ab initio par le Conseil d’État. Celui-ci a d’ailleurs précisé, expressis verbis : « Il en allait ainsi pour la loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1 er mars 2005, qui prévoyait que son entrée en vigueur serait subordonnée à celle d’un engagement international. » Non seulement la solution que nous proposons a déjà existé, mais elle est conseillée par le Conseil d’État et a été modifiée pour que le juge de paix chargé de constater l’élément matériel soit une instance plus objective que ne le serait, peut-être, le Gouvernement. Contrairement à ce que j’entends, celui-ci est un partenaire et l’a toujours été. Étant signataire de l’ensemble des accords, il est évidemment impartial, mais pas neutre. Par ailleurs, permettez-moi de reprendre l’excellent argument du rapporteur : hier, pendant la première partie des débats, vous nous avez reproché de ne pas conditionner la réforme à un accord ; à présent, vous voulez supprimer l’article 2, qui prévoit une telle condition. Il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. L’article 2 prévoit un véritable temps d’écoute, voulu par le Gouvernement et par ceux qui adopteront, je l’espère, ce projet de loi constitutionnelle. Nous prévoyons les mécanismes qui nous permettront, à tout moment, de suspendre la réforme constitutionnelle à la suite d’un accord global – que nous avons toujours souhaité et continuons à souhaiter. Je préférerais qu’on n’utilise pas la métaphore du pistolet sur la tempe : compte tenu de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, elle ne me paraît pas très heureuse. Il n’y a que des femmes et des hommes de bonne volonté. Nous n’empruntons pas tous le même chemin pour parvenir au but, mais vous ne pouvez pas caricaturer ce projet de loi constitutionnelle, qui répond non seulement aux canons du droit constitutionnel, mais aussi à l’avis du Conseil d’État, puisqu’il prévoit une procédure objective permettant de constater l’existence matérielle d’un accord. Supprimer l’article 2, mesdames et messieurs les députés, ce serait compromettre les chances d’un accord ; c’est tout le contraire de ce que nous voulons. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe RE et sur quelques bancs du groupe Dem.)
Je ne reviens pas sur la méthode, dont nous avons déjà beaucoup parlé depuis hier. Je vais simplement essayer de vous répondre, monsieur le ministre, à propos de la forme. Vous dites que le Conseil d’État a validé la possibilité de différer l’entrée en vigueur de l’article 1 er ou de le rendre caduc. Le Conseil d’État a effectivement estimé que l’on pouvait procéder comme en 2005 : si une circonstance donnée intervient avant la date prévue pour l’entrée en vigueur de la réforme constitutionnelle, celle-ci n’entre pas en vigueur, même si elle a été votée. Voilà ce qu’a dit le Conseil d’État, vous êtes d’accord avec moi ?
Poursuivez…
Ce que n’évoque pas le Conseil d’État, parce qu’il n’a pas été saisi à ce sujet, c’est le point qui a été ajouté par le Sénat : la possibilité d’une caducité a posteriori , après l’entrée en vigueur de la réforme. C’est bien ce qui figure à l’article 2 : « L’article 1 er entre en vigueur le 1 er juillet 2024. Toutefois, il n’entre pas en vigueur ou, le cas échéant, devient caduc si les présidents des deux assemblées du Parlement […] constatent qu’un accord […] a été conclu au plus tard dix jours avant la date des élections […]. » Il s’agit d’une caducité qui interviendrait après l’entrée en vigueur de la réforme, c’est-à-dire après le 1 er juillet 2024, une fois qu’elle aura été inscrite dans le marbre de la Constitution. On peut considérer qu’à partir du moment où une réforme constitutionnelle est inscrite dans la Constitution, avec une date d’entrée en vigueur, elle doit s’appliquer à cette date. En l’espèce, il y a une incohérence juridique très forte qui, pour le coup, est une véritable nouveauté. La réforme constitutionnelle de 2005 ne prévoyait rien de tel, puisqu’elle fixait simplement une condition à son entrée en vigueur, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État. L’ajout du Sénat vient perturber le raisonnement du Conseil d’État. Je constate que vous n’avez pas saisi ce dernier au sujet de cet ajout. Nous sommes donc confrontés à une innovation, qui est en outre contraire à la hiérarchie des normes, comme l’a expliqué mon collègue Jérôme Guedj. Pour la première fois, un accord conclu entre des parties pourrait rendre caduque une disposition de la Constitution, ce qui est pour le moins déconcertant.
Nous ne sommes que des greffiers !
Il est vrai que nous avons déjà constitutionnalisé des accords, mais donner une valeur constitutionnelle à un accord préexistant, ce n’est pas la même chose que de permettre à un accord de remplacer la Constitution.
Le Didier Maus du Parti socialiste !
Je vais tenter de convaincre MM. Guedj et Delaporte. Certes, une rédaction plus baroque et plus exceptionnelle serait difficile à imaginer, mais comme l’a rappelé le ministre, c’est le principe en Nouvelle-Calédonie : nous avons deux statuts des terres, deux statuts civils, trois corps électoraux… L’expression sui generis a été inventée pour la Nouvelle-Calédonie ! Le texte ne dit pas qu’un accord global remplacera la Constitution. Si un accord global est trouvé, ainsi que je l’appelle de mes vœux, comme tous les Calédoniens, cet accord devra ensuite être soumis à un processus permettant sa constitutionnalisation. À cette fin, nous serons appelés à adopter un projet de loi constitutionnelle, ici même, au Sénat et en Congrès à Versailles. Malgré toute la valeur qu’il revêt à mes yeux, un accord global n’est pas constitutionnel par nature. Il le deviendra seulement au moment où il sera repris par une loi constitutionnelle. Il n’y a donc pas ici de bouleversement de la hiérarchie des normes. (Mme Sophia Chikirou s’exclame.)
Cela suspendra l’application de cette loi constitutionnelle !
En effet. C’est pourquoi – sur ce point essentiel, je rejoins les interventions précédentes et j’exprime ce que je ressens, conscient de la situation en Nouvelle-Calédonie – c’est la chance, la seule chance qui nous est donnée d’obtenir un accord global, or tout le monde reconnaît qu’il faut le privilégier à tout prix. Donnons-lui donc toutes les chances d’aboutir. En règle générale, un accord peut-il rendre caduc un texte de loi adopté ? Non, mais en Nouvelle-Calédonie, c’est possible. Il faut voter ce dispositif, car si nous ne le votions pas, en nous contentant de l’article 1 er , nous n’aurions aucune solution politique et institutionnelle pour sortir de la situation actuelle. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RE.)
Nous avons atteint des sommets de surréalisme. Nous sommes réunis pour voter une réforme afin – je reprends les termes du rapporteur – de démocratiser la Nouvelle-Calédonie et de faire en sorte que les élections se tiennent rapidement avec – toujours selon le rapporteur – le bon corps électoral. Aux termes du texte que nous avons voté il y a deux mois, « rapidement » signifierait avant le 15 décembre 2024. Qui, ici, croit que les élections provinciales se tiendront avant cette date ? Il y a toutes les raisons d’en douter. Toutefois, nous abordons l’article 2 qui prévoit que, si un accord survient jusqu’à dix jours avant la tenue des élections, il faudra – je reprends l’argumentation de M. Dunoyer – l’inscrire dans la Constitution, tenir un Congrès, etc. Pour ma part, je ne sais pas quand se tiendront les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie ; dans très longtemps, en tout cas. Donc l’argument de l’urgence pour la démocratie, dont on use pour nous dire d’aller vite, ne tient plus.
Dès lors, nous sommes ici réunis pour une seule raison : imposer un dégel du corps électoral à la partie indépendantiste qui ne le souhaitait pas dans ces termes en dehors d’un accord global. Il s’agit donc de mettre la pression sur les négociateurs pour parvenir à un accord. Sinon, je ne vois pas l’intérêt de ce texte. Finalement, nous sommes en train d’embraser la Nouvelle-Calédonie.
En effet, il n’est pas possible de parvenir à un accord et de tenir des négociations en Nouvelle-Calédonie sous la contrainte. Nous sommes, je le rappelle, dans une situation coloniale. Ni la répression ni la contrainte ne parviendront à résoudre ce problème et à construire le nécessaire vivre-ensemble et le destin commun du peuple premier et des victimes de l’histoire. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe LFI-NUPES.)
L’article 2 est inséparable de l’article 1 er . Si vous amputez le projet de loi constitutionnelle de l’article 2, tout l’équilibre que vous dénoncez cependant par ailleurs s’écroule ; les conséquences négatives seront plus générales encore. M. Dunoyer l’a dit : il existe en Nouvelle-Calédonie une méthode, une approche sui generis depuis près de trente ans. Jusqu’à présent, le Parlement français était en quelque sorte le greffier qui constatait l’état des accords passés entre les différentes parties. Le texte dont nous débattons constitue certes une exception, mais en réalité cette proposition de loi constitutionnelle, qui porte sur une question particulière mais importante pour la démocratie, le dégel du corps électoral, ne fait que prolonger cette méthode. En effet, nous permettons aux différentes parties, presque jusqu’au dernier moment, dix jours avant les élections, de trouver un accord pour étendre le corps électoral. Vous savez très bien que, si la date du 15 décembre devait être reculée, le Conseil d’État a déjà, dans l’avis du 7 décembre 2023, indiqué que les élections pourraient se tenir jusqu’à l’automne 2025. (Exclamations sur les bancs du groupe LFI-NUPES.)
Alors, pourquoi cette précipitation ?
Nous donnons un peu de temps au temps. Nous marquons une étape. Je sais bien que vous voudriez brûler les étapes. (Protestations sur les bancs du groupe LFI-NUPES.)
Mme Sophia Chikirou et M. Bastien Lachaud
Non, c’est vous qui brûlez les étapes !
Commençons par cette étape afin de poursuivre.
Les troubles durent déjà depuis quarante-huit heures !
Vous savez très bien que le processus en cours ne sera pas exactement celui qui était envisagé. Le Président de la République a déjà dit que le Congrès ne serait pas réuni immédiatement. Il est presque certain qu’une mission de bons offices sera nommée. On peut penser que le Premier ministre, assez rapidement, reprendra les choses en main. Nous devons donc aller au bout de l’étape actuelle sans rester au milieu du gué. On ne peut pas supprimer l’article 2 sans mettre à mal l’article 1 er et donc l’ensemble du projet de loi constitutionnelle.
Après ces longues explications sur l’article 2, qui le méritait, le Gouvernement sera moins disert lors de l’examen des amendements. Monsieur Delaporte, soyons clairs. Premièrement, je constate que votre argumentation ne correspond pas à l’amendement n o 16. En effet, vous ne proposez pas une nouvelle rédaction de l’article 2, mais sa suppression.
L’amendement n o 16 est l’amendement de suppression. Ensuite, à travers les amendements suivants, on discute !
Ça s’appelle le travail parlementaire !
Je constate simplement les faits : si l’Assemblée adoptait l’amendement n o 16, le dégel du corps électoral aurait lieu sans accord. Deuxièmement, vous dites que le Conseil d’État n’a pas été saisi de la rédaction actuelle concernant la caducité prévue par l’article 2, car celui-ci a été ajouté par le Sénat. C’est faux, car le texte initial du Gouvernement, sur lequel nous avons saisi le Conseil d’État, évoquait la caducité, même si la rédaction était différente. Je cite l’article 2 dans la rédaction initiale : « L’article 1 er entre en vigueur le 1 er juillet 2024. Toutefois, il n’entre pas en vigueur ou, le cas échéant, devient caduc si le Conseil constitutionnel saisi à cette fin par le Premier ministre constate qu’un accord portant sur l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, négocié dans le cadre des discussions prévues par l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, a été conclu […] ».
Citez la fin : « avant le 1 er juillet 2024 entre les partenaires de cet accord » !
Nous sommes d’accord. Vous avez soutenu que nous n’avions pas saisi le Conseil d’État sur la question de la caducité ; mais bien sûr que si.
Ce qui a été modifié, c’est la saisie de deux tiers de confiance, la présidente de l’Assemblée nationale et le président du Sénat, afin de prendre en considération les remarques du Conseil d’État concernant l’instance qui constate la matérialité de cet accord.
Dix jours avant !
Troisièmement, vous faites usage de sophismes. Vous avez expliqué au sujet des listes électorales que, comme le Conseil d’État ne disait pas explicitement que les élections seraient annulées mais que leur tenue était très incertaine, il ne fallait pas surinterpréter l’avis du Conseil d’État, mais désormais vous interprétez les silences du Conseil d’État comme s’ils appuyaient votre argumentation.
Avouez que ces arguments sont désormais réversibles. Quatrièmement, des articles de la Constitution peuvent devenir caducs ; en tout cas, il en a existé. C’est le cas des articles écrits par le père fondateur de la Constitution sur la communauté française. Le général de Gaulle, Michel Debré et le constituant ont accepté des articles relatifs à la communauté française englobant des territoires qui ont été décolonisés. Or vous savez que certains d’entre eux, à commencer par la Guinée, ont choisi de ne pas rester dans la communauté française ; pourtant, les dispositions en question sont demeurées dans la Constitution pendant plus de quarante ans, sans servir à rien. Je vous prie d’emblée de m’excuser si je me trompe d’organe car je cite de mémoire, sans l’avoir sous la main, le remarquable ouvrage, que nous avons tous beaucoup consulté, La Constitution introduite et commentée par Guy Carcassonne et l’excellent Marc Guillaume – qui sera heureux d’être cité dans cet hémicycle et qui ne pourra rien dire puisqu’il est préfet sous l’autorité du ministre de l’intérieur. (Sourires.) Ils commentent les articles sur la communauté française imaginés par le général de Gaulle et par Michel Debré et qui n’ont finalement pas servi car ils sont devenus caducs à l’aide de la comparaison suivante. Certains articles de la Constitution seraient comme l’appendice dans le corps humain : ils ne servent pas à grand-chose car on ne peut pas les usiter. Peut-être y a-t-il chez certains d’autres organes qui ne servent à rien, mais je n’en dirai pas davantage sous peine de susciter sinon des rires, du moins des vengeances. (Sourires.) En somme, les amendements étant inutiles, je propose qu’ils soient rejetés.
Je mets aux voix les amendements n os 16, 49 et 213.
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 161 Nombre de suffrages exprimés 160 Majorité absolue 81 Pour l’adoption 42 Contre 118
(Les amendements identiques n os 16, 49 et 213 ne sont pas adoptés.)
Je suis saisie de neuf amendements, n os 96, 218, 120, 119, 118, 117, 17, 116 et 39, pouvant être soumis à une discussion commune. Les amendements n os 96 et 218 sont identiques, tout comme les amendements n os 17 et 116. La parole est à M. Bastien Lachaud, pour soutenir l’amendement n o 96.
Depuis le début du débat, je vous demande des chiffres, monsieur le ministre. Il y a une raison à cette demande. Dans ce projet de loi, toute personne inscrite sur les listes électorales en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans est considérée d’office comme y résidant. Cependant, vous le savez, en Nouvelle-Calédonie, des commissions administratives spéciales (CAS) se réunissent tous les ans pour vérifier que les personnes inscrites sur les listes électorales sont bien des résidents. Il ne suffit pas d’être inscrit sur les listes électorales pour le prouver : il est nécessaire de fournir des justificatifs précis, qui démontrent la présence effective sur le territoire calédonien. Cependant, les listes électorales de Nouvelle-Calédonie ne sont pas indexées au registre électoral unique, de sorte qu’il y a une possibilité de double inscription. En outre, certaines personnes restent inscrites sur des listes électorales en Nouvelle-Calédonie alors qu’elles sont venues en Hexagone, par exemple pendant un an ou deux pour étudier ; de ce fait, elles ne remplissent pas le critère de dix ans de résidence. Il est donc nécessaire, avant d’appliquer ce projet de loi constitutionnelle, de passer au peigne fin les listes électorales, afin de s’assurer que les personnes inscrites depuis plus de dix ans sur les listes électorales générales de Nouvelle-Calédonie y ont effectivement résidé pendant dix ans.
L’amendement n o 218 de Mme Sabrina Sebaihi est défendu. La parole est à M. Antoine Léaument, pour soutenir l’amendement n o 120.
À travers ces amendements, nous rejetons ce que vous avez appelé « mettre un pistolet sur la tempe » de telle ou telle partie aux négociations, monsieur Darmanin. Quant à nous, nous n’utilisons pas cette expression ; nous préférons parler d’épée de Damoclès. La manière dont le débat est amené devant l’Assemblée nationale, nous pouvons le constater, provoque de grandes tensions en Calédonie, dont le Congrès a demandé de reporter les débats sur ce texte. Les institutions légitimes de la Calédonie nous ont donc proposé de faire un geste pour renouer le dialogue. Je ne doute pas que, comme ministre de l’intérieur, vous en avez eu connaissance, mais je voudrais évoquer la proposition de M. Moetai Brotherson, président de la Polynésie française, qui se propose pour être médiateur sur ce sujet afin de permettre qu’un accord soit trouvé entre les différentes parties. Cette voie doit être étudiée. Or, pour le faire de manière sereine et permettre que les différents acteurs se réunissent, il faut que le texte soit retiré. J’ai bien compris que ce n’est pas votre intention à cette heure. Toutefois, les amendements que nous défendons dans cette discussion commune visent à parvenir à un accord par des voies plus diplomatiques qu’une épée de Damoclès via notre Constitution, dont il serait ainsi fait une mauvaise utilisation.
La parole est à Mme Sophia Chikirou, pour soutenir l’amendement n o 119.
Nous comprenons bien que tout ce projet de loi constitutionnelle ne répond qu’à une seule et unique volonté : mettre la pression sur les indépendantistes. L’article 2 et les arguments que vous nous présentez démontrent que vous n’avez que cet objectif, qui vous a peut-être été soufflé par une personne que je ne nommerai pas mais qui est assise à côté de vous, monsieur le ministre.
M. Sacha Houlié , président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
Moi, je n’ai rien dit !
Il semblerait que, finalement, certains vous aient convaincu que la meilleure façon de procéder était de mettre la pression sur les indépendantistes. Je veux dire à tous les Français qui nous regardent – en particulier ceux qui vivent dans l’Hexagone – que cette pression n’aura pas permis d’accélérer le dialogue pour aboutir à un accord global qui permette la tenue des élections provinciales avant la fin de l’année. Non : le résultat du projet de loi dont nous sommes en train de débattre, c’est quarante-huit heures de troubles en Nouvelle-Calédonie. Allumer la mèche pour ensuite réprimer les troubles, c’est une anomalie, mais c’est une pratique très macroniste, finalement : vous vous dites sûrement que l’image des indépendantistes sera dégradée, et qu’ils seront plus faibles dans la négociation. Mais je tiens à rétablir les faits : ce ne sont pas les indépendantistes qui sont à l’origine des troubles qui agitent la Nouvelle-Calédonie en ce moment – la manifestation des indépendantistes qui s’est tenue hier s’est d’ailleurs très bien déroulée. Les responsables de ces troubles, ce sont bien ceux qui, derrière le rideau, s’arrangent, manigancent, et se sont organisés pour que, finalement, ce soit la décision que l’Assemblée nationale est en train de prendre qui provoque des troubles en Nouvelle-Calédonie. (Applaudissements sur les bancs des groupes LFI-NUPES et GDR-NUPES.)
Puis-je considérer que les amendements n os 118, 117 et 116, qui ne visent qu’à proposer différentes dates d’entrée en vigueur, sont défendus ?
M. Jean-Philippe Nilor
Non, je vais défendre l’amendement n o 118, madame la présidente.
Très bien, vous avez la parole pour le soutenir.
C’est la première fois que j’interviens dans ce débat crucial, madame la présidente. J’espère que mon intervention ne vous dérange pas par principe.
Jamais, monsieur Nilor, et vous le savez bien. (Sourires.)
Vous l’entendre dire me rassure.
Allons ! Je sais que vous n’étiez pas inquiet.
Mon intervention ne se placera pas sur le plan de la légalité ni de la constitutionnalité, mais sur celui de la légitimité. Que cherchez-vous à faire exactement : à embraser la situation ou à l’apaiser ? Voilà la question qu’il faut se poser. On peut discuter, mais la réalité, c’est qu’avant même qu’on en connaisse le résultat, l’imminence du vote sur ce projet de loi constitutionnelle met déjà le feu à la Nouvelle-Calédonie et déclenche des violences. Une seule fois dans l’histoire – c’est assez rare pour le souligner –, le colonialisme s’est montré intelligent : avec la signature de l’accord de Nouméa, sous Lionel Jospin, la France s’était montrée à la hauteur de l’image qu’elle veut se donner sur la scène internationale. Vous n’aimez pas l’expression « avoir un fusil sur la tempe », alors je vais le dire autrement : vous êtes en train de mettre un couteau sous la gorge des parties aux négociations. C’est bien mal connaître la culture kanak – ou peut-être la connaissez-vous si bien, au contraire, que vous savez qu’aucun accord ne pourra être trouvé dans les conditions de pression inacceptable que vous leur imposez, et que c’est là votre but ? Car alors, sans accord, Paris décidera de tout, comme toujours ! Ce qui se passe aujourd’hui doit nous amener à réfléchir. Vous avez une tendance à la « messmerisation » ; nous devons préférer la position des élus et représentants français qui ont su faire preuve de dignité et de hauteur d’esprit. (Applaudissements sur les bancs des groupes LFI-NUPES et GDR-NUPES.)
L’amendement n o 117 de M. Bastien Lachaud est défendu. La parole est à Mme Cécile Untermaier, pour soutenir l’amendement n o 17.
Mme Cécile Untermaier
L’article 2 s’inscrit dans la droite ligne de l’article 1 er , que nous avons déjà contesté. Il est donc logique que nous nous y opposions. Si l’élargissement du corps électoral est un objectif tout à fait démocratique, ce n’est pas le cas de la méthode que vous employez pour y parvenir – et le fait qu’elle ait déjà été utilisée en 2005 ne doit pas nous empêcher de questionner sa légitimité. J’ai le sentiment que le Parlement est, d’une certaine manière, piétiné et instrumentalisé : son vote sur ce texte un peu artificiel – on peut d’ailleurs s’interroger sur la sincérité du scrutin – sera-t-il un outil de pression, un soutien pour le Gouvernement dans sa volonté de dialogue ? Est-ce vraiment le rôle du Parlement de voter ce genre de dispositif ? Pour que ce texte ne soit pas immédiatement source de pression pour la population, ce qui ferait perdre tout son sens à la réflexion que nous menons ensemble aujourd’hui, il nous semble plus sain de reporter d’un an son entrée en vigueur. (Applaudissements sur les bancs des groupes SOC, LFI-NUPES et GDR-NUPES.)
La parole est à M. Antoine Léaument, pour soutenir l’amendement n o 116.
Monsieur Darmanin, mon collègue Jean-Philippe Nilor vous a interrogé sur la légitimité de votre démarche. Si les événements en cours en Nouvelle-Calédonie se poursuivent, que ferez-vous ? Imposerez-vous le texte, au motif qu’il a été adopté ici et qu’il a pour lui la force de la loi, même si une partie du peuple calédonien ne se reconnaît pas dans les décisions que l’Assemblée nationale aura prises ? Il est prévu qu’une compagnie de gendarmerie de Nouvelle-Calédonie soit envoyée dans l’Hexagone pour contribuer à assurer la sécurité pendant les Jeux olympiques, qui auront lieu bientôt. Que ferez-vous si la situation actuelle se poursuit ? Nous vous appelons à faire un geste pour rétablir le dialogue, ce qui nécessite avant tout de rétablir la paix civile en retrouvant la concorde. Les amendements que nous défendons posent la question de la mal-inscription, voire de la non-inscription des citoyens sur les listes électorales –– ce sujet touche d’ailleurs l’ensemble du territoire de la République Française, puisqu’on y compte 7,7 millions de mal-inscrits. Avec l’amendement n o 96 et les suivants, nous vous demandons un toilettage complet des listes électorales de Nouvelle-Calédonie, pour que le corps électoral soit réellement conforme. En effet, rien ne dit qu’une personne inscrite sur les listes électorales calédoniennes y habite réellement depuis au moins dix ans : comme dans l’Hexagone, certains sont inscrits sur les listes électorales d’un territoire alors qu’ils y habitent depuis moins de dix ans, tandis que d’autres ne s’y sont jamais inscrits alors qu’ils y résident depuis plus de dix ans. C’est d’ailleurs pour cette raison que j’avais proposé d’automatiser l’inscription sur les listes électorales du lieu de résidence, mais vous m’avez envoyé promener, pour le dire poliment !
L’amendement n o 39 de M. Davy Rimane est défendu. Quel est l’avis de la commission ?
Défavorable. Je n’incrimine pas directement vos interventions précédentes, mais depuis tout à l’heure, on parle beaucoup de ceux qui manifestent – à juste titre, d’ailleurs, parce que cela a engendré des dégâts. Je voudrais qu’on parle aussi de ceux qui ne manifestent pas (Mme Sophia Chikirou rit) , ceux qui, depuis quarante-huit heures, subissent violences et exactions, ceux dont l’entreprise ou la maison a été brûlée, et qui ont parfois été eux-mêmes blessés. Tous ceux-là nous demandent de tenir bon malgré tout, pour la démocratie en Nouvelle-Calédonie ! Et même s’il ne doit pas être facile pour eux de voir tout ce qu’ils ont construit être détruit en quarante-huit heures, ils font le dos rond, et continuent de demander à la représentation nationale de leur redonner le pouvoir de voter en Nouvelle-Calédonie. En ce moment, on reçoit beaucoup de messages de soutien de ces Calédoniens qui subissent la situation, et je voudrais qu’on pense à eux aussi, parce qu’on les oublie trop souvent. Tout ce qu’ils veulent, c’est pouvoir voter à nouveau. (Applaudissements sur les bancs des groupes RE, Dem et HOR. – M. Frédéric Cabrolier applaudit également.)
C’est dommage que le débat n’ait même pas lieu sur ce sujet important, faute d’une réponse sur le fond du rapporteur, qui préfère mentionner les messages qu’il a reçus de la part des Calédoniens. Il se trouve que j’en ai moi-même reçu un, il n’y a même pas une demi-heure, dans lequel on me fait part de l’inquiétude de toutes les personnes qui, à cette heure, sont terrées chez elles, avec un sac, prêtes à partir – mais pour aller où ? Alors oui, à l’heure où nous parlons, des dizaines, des centaines de milliers de Calédoniens vivent dans la peur. Mais la peur de quoi ? La peur de la suite et de l’absence de perspective, la peur de l’incertitude politique que créera l’article 2, dont le cœur se résume à l’alternative suivante : peut-être, mais peut-être pas. Comment voulez-vous rassurer une population dont l’avenir, le destin, sont suspendus à un accord qui sera peut-être conclu, ou peut-être pas ? Tout à l’heure, monsieur le ministre, vous n’avez pas lu le texte initial de l’article 2 jusqu’à la fin. Celui-ci dispose : « L’article 1 er entre en vigueur le 1 er juillet 2024. Toutefois, il n’entre pas en vigueur ou, le cas échéant, devient caduc si […] un accord […] a été conclu avant le 1 er juillet 2024 entre les partenaires de cet accord. » Le projet de loi que vous avez soumis au Conseil d’État prévoyait donc bien, dès le départ, que le texte n’entrerait pas en vigueur, ou qu’il deviendrait caduc si un accord était trouvé avant le 1 er juillet 2024. Je ne dis pas que l’avis du Conseil d’État vaut parole d’évangile : le constituant est souverain, et rien ne l’empêche, si c’est ce qu’il souhaite, de prévoir un article baroque. Je soulignais simplement qu’inscrire dans la Constitution une disposition qui pourrait ne pas s’appliquer une fois entrée en vigueur au motif que des tiers auront conclu un accord, serait une première. D’un point de vue juridique, cette décision serait exceptionnelle et inédite.
Vous faites bien de rappeler la situation dans laquelle se trouvent la Nouvelle-Calédonie et ses habitants : depuis deux jours, ils sont inquiets et ils ont peur. Mais il faut aussi rappeler pourquoi ils sont dans cette situation : sans ce projet de loi constitutionnelle, qui en est l’unique cause, la Nouvelle-Calédonie n’aurait pas renoué avec la violence qu’elle avait abandonnée depuis plus de quarante ans. Aujourd’hui, c’est vrai, il y a des pilleurs, des incendies, des hommes armés tirent sur des gendarmes, et tout cela fait peur. Mais la peur règne des deux côtés ! Et ce que vous oubliez de dire, c’est que des milices s’auto-organisent, et que leur action vise les indépendantistes. Vous êtes donc en train de créer les conditions d’une guerre civile en Nouvelle-Calédonie. C’est terrible. J’en appelle au Président de la République : quand on sait ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie depuis quarante-huit heures, on ne peut pas continuer à discuter de ce projet de loi, article après article, dans l’entre-soi parlementaire, en étant totalement déconnectés de la réalité. Et je tiens à dire aux habitants de Nouvelle-Calédonie qui vivent dans la peur, s’enferment, envisagent peut-être un départ précipité, que ce n’est pas parmi les indépendantistes et les Kanaks qu’il faut chercher les responsables de cette situation, mais ici, à Paris, à l’Élysée et au Gouvernement !
Quelle modération dans vos propos !
Nous demandons qu’une mission soit dépêchée de toute urgence en Nouvelle-Calédonie pour rétablir le dialogue, et que l’examen du projet de loi constitutionnelle soit suspendu. Monsieur le ministre, ce n’est pas perdre avec déshonneur que de décider de suspendre le projet de loi pour préserver la sécurité, la paix, la santé, la vie même des Calédoniens : au contraire, cela vous honorera. (Applaudissements sur les bancs des groupes LFI-NUPES et GDR-NUPES.)
Ce serait même du courage !
Et ce soir, au journal télévisé, on vous félicitera, on louera une décision sage qui aura épargné bien des malheurs aux Calédoniens.
(Les amendements identiques n os 96 et 218 ne sont pas adoptés.)
(Les amendements n os 120, 119, 118, et 117, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
(Les amendements identiques n os 17 et 116 ne sont pas adoptés.)
(L’amendement n o 39 n’est pas adopté.)
Je suis saisie de deux amendements identiques, n os 50 et 214. La parole est à M. Bastien Lachaud, pour soutenir l’amendement n o 50.
Il vise à ce que l’accord ne soit valide qu’après avoir été ratifié par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Vous m’opposerez la hiérarchie des normes. Ma proposition n’est toutefois pas plus baroque que la vôtre. Nous démontrerions ainsi qu’un consensus en Nouvelle-Calédonie est nécessaire pour adopter le texte. Vous n’avez pas répondu à la question de la mal-inscription sur les listes électorales. Vous n’expliquez pas comment les CAS pourront vérifier précisément que toutes les personnes qui sont, selon vous, inscrites depuis dix ans sur les listes et qui devraient donc pouvoir, à ce titre, voter aux élections provinciales, ont bien apporté la preuve de leur résidence permanente durant cette période. Tant que cela ne sera pas démontré, nous reposerons la question, car elle est fondamentale. La situation en métropole, où 7,7 millions de personnes sont mal inscrites ou non inscrites sur les listes électorales, le prouve. C’est énorme. Pourtant, cela laisse le ministre de l’intérieur complètement indifférent : aucune campagne d’inscription digne de ce nom n’est menée. Quant à la campagne du Gouvernement, elle a été lancée deux jours avant la date limite d’inscription. Étant donné l’ampleur du problème, ce n’est pas sérieux. Or, pourquoi y aurait-il moins de personnes mal inscrites en Nouvelle-Calédonie que dans l’Hexagone ? Vous voulez inscrire des électeurs sur la liste provinciale alors qu’ils n’ont pas dix ans de résidence effective. Apportez-moi la contradiction sur ce point.
L’amendement n o 214 de Mme Sabrina Sebaihi est défendu. Quel est l’avis de la commission ?
Par cet amendement, nous cherchons un levier à même de garantir l’autodétermination des Calédoniens et de la Nouvelle-Calédonie. Le projet de loi risque d’être adopté ce soir. Cela ne me fait pas plaisir, mais si tel est le cas, nous proposons que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie l’adopte à son tour, à la majorité des trois cinquièmes. Le texte en tirera ainsi une légitimité. Cela peut d’ailleurs participer du processus de dialogue qu’il faut relancer absolument. Envoyer l’armée ou imposer un couvre-feu à Nouméa durant des semaines ne saurait être une solution, vous en conviendrez. Il faut une sortie de crise pacifique. Il faut, à tout prix, trouver le moyen de rassurer tout le monde, retrouver la voie du dialogue. Soyons clairs : ce que vous faites ce soir n’y contribue pas. À croire que vous avez le rôle du méchant dans cette histoire, de celui qui doit maintenir la pression.
Un peu comme vous, à La France insoumise !
J’imagine, j’espère, je souhaite de tout cœur que le Président de la République joue un autre rôle. Par cet amendement, nous démontrons que nous sommes une opposition constructive et soucieuse (M. Charles Sitzenstuhl s’esclaffe. – Rires sur quelques bancs des groupes RE, Dem et HOR) de donner au Congrès la possibilité de valider ou non le projet de loi et, ainsi, de calmer le jeu et de faire redescendre la température en Nouvelle-Calédonie.
(Les amendements identiques n os 50 et 214 ne sont pas adoptés.)
La parole est à Mme Danièle Obono, pour soutenir l’amendement n o 121.
Cet amendement rédactionnel me permet de revenir sur le débat précédent. Monsieur le rapporteur me contredira sans doute, mais je comprends qu’il considère que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, peut-être parce qu’il est composé d’une majorité d’indépendantistes, ne serait pas légitime ; que l’élection de ses représentants, selon des règles issues de l’accord de Nouméa – donc dans un cadre électoral restreint –, ne résulterait pas d’une expression démocratique. Serait-ce parce qu’en Nouvelle-Calédonie, vous appartenez vous-même à l’opposition ? Cette petite musique que j’entends me semble profondément discutable. Elle illustre le double jeu du Gouvernement, le problème de sa démarche : on ne peut prétendre garantir la reprise du dialogue, du compromis, du consensus, alors que le rapporteur du texte a un parti pris et considère que ses interlocuteurs sont illégitimes à rendre un avis – alors qu’ils sont démocratiquement élus, ne vous en déplaise – même a posteriori et après avoir dû accepter le coup de pression du Gouvernement. Je trouve cela contradictoire avec la volonté, affichée à plusieurs reprises, de rétablir la démocratie en Nouvelle-Calédonie. Cela n’a aucun sens. Vous voulez à présent reconsidérer le processus de décolonisation, la situation postcoloniale et la composition des trois corps électoraux…
Mme Caroline Parmentier
Que c’est long ! Cela paraît interminable.
…qui induisent des inégalités d’accès au suffrage, alors que vous les acceptiez quand vous étiez majoritaires au sein du Congrès. À l’époque, vous trouviez cela très démocratique. Votre point de vue est biaisé : la démocratie vous convient quand vous êtes majoritaires – ou quand vous avez la perspective de l’être –, puis cesse de vous convenir lorsque vous êtes dans l’opposition ; cela ne va pas.
Je ne dirai jamais qu’un élu est illégitime. Il est toujours légitime puisqu’il a été élu par le peuple.
Dites-le à Mme Backès !
Nous ne remettons pas en cause la légitimité des élus, mais le manque de représentativité du Congrès. Vous connaissez les chiffres, vous êtes allée sur place : les trois quarts de la population calédonienne – peut-être davantage après la fermeture de l’usine du Nord –, vivent dans la province Sud, contre 68 % lors de la signature de l’accord de Nouméa, et c’est aussi là qu’habitent la majorité des Kanaks, selon le recensement effectué en 2019. Or la province Sud n’est représentée que par 59 % des élus au Congrès. Autrement dit, elle est de plus en plus sous-représentée au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Nous n’évoquons que le manque de représentativité, pas l’illégitimité. Il faut faire attention aux mots que l’on emploie ; ils ont un sens. Encore une fois, je ne dirai jamais qu’un élu est illégitime. Enfin, je vous sais gré de votre attachement à l’avis du Congrès : c’est nous faire grand honneur. J’aurais néanmoins apprécié que vous suiviez effectivement son avis lors du vote du projet de la loi organique qui repoussait la date des élections provinciales ; malheureusement, vous n’aviez alors pas suivi la majorité des élus du Congrès, y compris des partis indépendantistes, qui avaient voté en sa faveur ; vous aviez voté contre. Vous manquez de cohérence : vous voulez tantôt suivre son avis, tantôt ne pas le suivre.
Personne ne remet en cause la légitimité des élus. Les critiques qui ont visé la légitimité de M. Metzdorf, au motif qu’il ne représenterait pas tous les Calédoniens, étaient en revanche choquantes. Ce n’est pas nous qui distinguons les élus en fonction de l’appréciation que l’on porte sur ce qu’ils disent. Lorsque l’État négocie avec les partis indépendantistes – c’est aussi vrai avec les partis dits loyalistes –, il ne négocie pas toujours avec des élus. Les partis politiques désignent aussi des interlocuteurs, qui sont respectables et légitimes, puisque l’article 4 de la Constitution mentionne le concours des partis politiques à l’expression du suffrage. Ce n’est pas une critique de ma part, mais j’ai parfois constaté des changements au sein des délégations envoyées pour négocier – décidés, par exemple, par le bureau du FLNKS – avec des membres qui ne sont pas toujours des élus. Nous sommes tous d’accord pour dire que l’amendement n o 121, défendu par Mme Obono, qui vise à remplacer un « toutefois » par un « néanmoins », est important pour la France et la Nouvelle-Calédonie.
Oui, c’est un amendement rédactionnel.
Nous répondons avec beaucoup d’écoute et de patience à vos questions, mais peut-être serait-il utile de passer à d’autres sujets et nous montrer responsables en n’obstruant pas le débat parlementaire. Nous avons eu une discussion constitutionnelle nécessaire sur l’article 2, mais le lien entre vos discours et le passage de « néanmoins » à « toutefois » ne me semble pas évident. Avis défavorable.
Toutefois, nous sommes libres de nos décisions !
« Toutefois » : en considérant toutes les raisons de ; « néanmoins » : malgré ce qui vient d’être dit. Ces deux mots signifient deux choses différentes. L’amendement rédactionnel permet de préciser les choses. Il importe que les mots de la loi soient bien choisis – ce n’est pas à vous qu’on l’apprendra. Je vous l’ai dit hier : il y a un problème avec ce texte, qui justifie, au-delà de l’esprit, d’en modifier la lettre, au moyen d’amendements rédactionnels. L’amendement n o 121 a donc du sens. Sa défense était brève. Aussi ma collègue a-t-elle profité de son temps de parole pour poursuivre son développement et répondre au rapporteur. Le droit d’amendement sert à cela : sans les amendements, nous n’avons pas de temps de parole. Voilà pourquoi nous les déposons.
M. Vincent Bru
Vous en abusez !
Voilà pourquoi nous profitons du temps de parole qu’ils nous offrent, pour développer nos arguments et répondre aux vôtres, comme vous répondez aux nôtres. Voyez comme vous avez très envie de me répondre à cet instant, monsieur le ministre : allez-y ! (Sourires.)
À quelques minutes de la pause du dîner – si le ministre de l’intérieur est bien renseigné –,…
…vous me faites penser, madame Chikirou, lorsque vous défendez les amendements de votre groupe, à cette phrase des Shadoks, selon laquelle la notion de passoire est indépendante de la notion de trou. ( Sourires sur les bancs du groupe RE.)
Excellent !
(L’amendement n o 121 n’est pas adopté.)
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Prochaine séance, ce soir, à vingt et une heures trente : Suite de la discussion du projet de loi constitutionnelle, adopté par le Sénat, portant modification du corps électoral pour les élections au Congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ; Discussion du projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture. La séance est levée.
(La séance est levée à vingt heures.)
Le directeur des comptes rendus Serge Ezdra

IMAGES
VIDEO
COMMENTS
L'article en bref Le report d'une assemblée générale (AG) est une décision qui peut s'avérer nécessaire pour diverses raisons, qu'elles soient stratégiques, organisationnelles ou en réponse à des imprévus. Cet article offre un éclairage sur les conditions et les procédures à suivre pour reporter efficacement une AG, en ...
Publié le : mercredi 29 avril 2020 - Modifié le : mardi 1er juin 2021. Les ordonnances prises en application de la loi d'urgence covid-19 ont permis aux responsables associatifs de reporter ou de modifier les modalités de tenue des réunions des instances associatives.
Au vu des mesures sanitaires relatives à l'épidémie de coronavirus, est-il possible de reporter une assemblée générale d'association ? Si oui, comment procéder ?
Le dépôt de ces comptes doit être fait dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale. Si l'assemblée n'a pu se réunir dans le délai légal, il est possible d'obtenir une prorogation de ce délai de six mois en adressant une requête au président du tribunal de commerce.
Qu'est-ce qu'une assemblée générale d'association loi 1901 ? Quelles sont les règles de convocation d'une assemblée générale d'association ? Comment organiser une assemblée générale d'association ? Quel est le déroulement d'une assemblée générale d'association ? Qui peut voter lors d'une assemblée ...
Pour la tenue de chaque assemblée générale (ordinaire ou extraordinaire), un ordre du jour doit être établi. Il correspond aux différents points, appelés « résolutions », qui seront soumis au...
Préparez une présentation des rapports accessibles en ligne pour tous les membres. Veillez à ce que chacun puisse s'exprimer lors des échanges. Prévoyez un vote électronique sécurisé pour les prises de décision. En suivant ces recommandations, votre AG à distance se déroulera sans accroc ! Comment convoquer une Assemblée Générale d'association ?
La tenue d'assemblée générale annuelle a pour objet d'approuver les comptes de l'association. La loi du 1901 n'oblige pas une association à se réunir lors d'une assemblée générale tous les ans, sauf si les statuts de l'association le prévoient.
L'Assemblée Générale d'une association loi 1901 permet aux dirigeants d'échanger avec les membres de l'association autour des activités de l'année passée et de l'avenir. La loi du 1er juillet 1901, qui régit les associations françaises, laisse une très grande liberté dans l'organisation des Assemblées ...
Fonctionnement d'une association. Fonctionnement de l'assemblée générale. Le fonctionnement de l'assemblée générale s'organise autour de 3 temps fort ; la convocation, la tenue de l'AG et les suites de l'AG. Chacune de ces étapes répond à des règles strictes qu'il faut impérativement respecter.
L'assemblée générale d'une société est un organe de décision collective qui réunit l'ensemble des associés ou des actionnaires. Il existe plusieurs types d' assemblées générales comme l'assemblée générale annuelle, ou l'assemblée générale extraordinaire pour certaines décisions. L'assemblée générale d'association.
Par exemple, les sociétés qui clôturent leur exercice au 31 décembre, ont jusqu'au 30 juin de l'année suivante pour déposer leur demande de report de délai de tenue de leur assemblée générale ordinaire annuelle. Que contient la demande de prorogation du délai d'approbation des comptes ?
Quel que soit le type d'assemblée générale, les dirigeants de la SARL doivent respecter certaines formalités et fournir certains documents grâce auxquels les associés sont informés de la gestion de la société. Il est important de respecter cette procédure, qui constitue la seule occasion des associés de s'investir dans la vie de la société.
Il s'agit d'une réunion de l'ensemble des associés. Le rôle de l'assemblée générale des actionnaires est de se prononcer sur les décisions de la société et notamment sur l'approbation des comptes et l'affectation du résultat de la société lors de l'assemblée annuelle. Toutefois, le vote des associés peut également ...
Le juge des référés peut reporter une assemblée générale si celle-ci est de nature à causer un dommage imminent à la société. En outre, bien qu'il n'ait pas le pouvoir d'annuler les décisions votées en assemblée, il peut en suspendre les effets. Cass. com. 13 janvier 2021, nos 18-25713 et 18-25730.
Une assemblée générale des copropriétaires doit obligatoirement avoir lieu au moins 1 fois par an. Chaque copropriétaire est convoqué individuellement par le syndic de copropriété. Un ordre du...
Définition du quorum d'une assemblée générale. Le quorum est le terme employé pour désigner le nombre minimum de votants (actionnaires présents ou représentés) requis pour valider légalement une décision. La réunion doit être reportée à une date ultérieure s'il n'est pas atteint.
Une assemblée générale des copropriétaires (AG) doit avoir lieu au moins 1 fois par an pour y voter notamment les futurs budgets et travaux de l'immeuble. 1re étape Élaboration de l'ordre du ...
La lettre de report de l'assemblée générale doit être envoyée lorsque : l'AG annuelle des copropriétaires ne peut pas se tenir à la date initialement prévue ; vous souhaitez informer les copropriétaires du report de l'AG. Si vous voulez en savoir davantage sur les obligations et les pouvoirs du syndic, lisez notre guide.
Cet article a pour objet de préciser 10 situations susceptibles d'obtenir l'annulation d'une assemblée générale par le Tribunal de Grande Instance.
Pour faire annuler une assemblée générale, il faut réunir une nouvelle assemblée générale dite rectificative. Au cours de cette nouvelle assemblée, les erreurs ayant eu lieu lors de la précédente assemblée générale pourront être rectifiées. Au cours de cette nouvelle assemblée générale, pensez à éviter toute irrégularité.
Les modalités pour le report des assemblées générales en copropriété - EGIM. La crise sanitaire du COVID 19 et la déclaration de l'état d'urgence qui s'en est suivie, ont entrainé l'impossibilité pour les syndics d'assurer les Assemblées Générales pendant cette période* et donc de renouveler leur mandat auprès des copropriétaires.
Un cas illustratif concerne une société anonyme où, lors d'une assemblée générale extraordinaire, le quorum requis n'a pas été atteint pour la modification des statuts. La première convocation n'avait réuni que 15% des actions, alors que la loi exigeait au moins 25% conformément à l'article L. 225-96 du Code de commerce. En conséquence, une deuxième assemblée a dû être ...
L'assemblée générale d'une SAS est une réunion de la collectivité des associés, pendant laquelle cette dernière doit adopter des décisions qui lui sont soumises au titre d'un ordre du jour.
La saison 2024 des assemblées générales - instant solennel, surveillé et médiatisé - confirme donc déjà cette tendance de fond qu'est la volonté d'appropriation de leur pouvoir par les actionnaires, désireux d'exercer une influence sur le projet d'entreprise des sociétés dans lesquels ils sont investis.
M. Gérald Darmanin, ministre de l'intérieur et des outre-mer. Consultez le compte rendu de la Deuxième séance du mardi 14 mai 2024 (Session ordinaire de 2023-2024 - 16e législature). Retrouvez également les dossiers législatifs, les textes liés et la vidéo de la séance.